| |
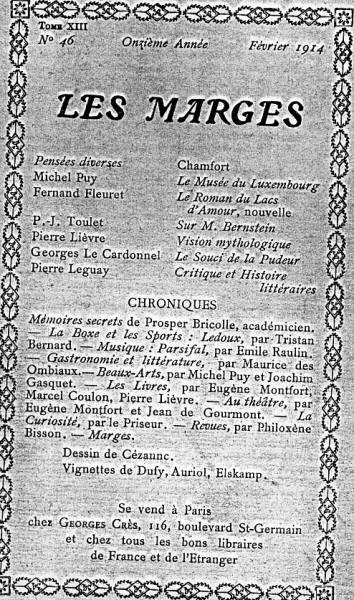
Promenades Littéraires, 5e série, par Rémy de Gourmont
On ne trouve pas dans ce livre les propriétés qui semblent (à lire tant de journaux) essentielles à l'article et que le mot « éphémère » résume. Cependant, comme la précédente, cette cinquième série se compose d'articles publiés dans le Temps et La Dépêche de Toulouse. Profitables à lire, ces articles le sont davantage a être relus. Je m'en aperçois notamment pour les chapitres sur Balzac et Sainte-Beuve, Henri Beyle dans sa famille, Alfred de Vigny et le Delille des Jardins. Mais j'ai pris plus de plaisir encore à retrouver le Roman de Guillaume de Machault et de Peronne d'Armentières. Ce n'est pas que ce volume offre ailleurs moins de substance, d'aisance et de nouveauté.
Jeanne Doré, de Tristan Bernard,
au Théâtre Sarah-Bernhardt.
Une sorte de Musée Tristan Bernard a été visible à Paris à la fin de 1913. Comme quatre théâtres le jouaient à la fois, un provincial aurait pu se former en quatre soirées une idée assez complète des talents de notre fécond ami. Ce biterrois ou ce chateauroussin serait allé entendre à l'Athénée une jolie comédie de caractère, au Palais-Royal un vaudeville, au Théâtre-Antoine une pièce très forte, un vrai Daumier, et chez Mme Sarah Bernhardt un drame pour grands enfants.
On a beaucoup dit que Jeanne Doré ressemblait à un spectacle de cinéma. Mais, je ne pense pas que ce soit là ce que Tristan Bernard ait voulu faire. Et devant son mélodrame simplifié, j'ai cru distinguer une intention, que ne pouvait pas réaliser Mme Sarah Bernhardt. Il existe un art que goûtent nombre d'amateurs, c'est l'art populaire, l'art des faïences rustiques et des images. Combien d'images d'Epinal sont d'un sentiment plus saisissant, et d'un choix de couleur plus hardi et plus amusant que telles grandes machines de savants peintres ! J'imagine que Tristan Bernard a désiré nous donner une sorte d'image d'Epinal. Et voilà une idée intéressante.
Mais la femme à la voix d'or pouvait-elle comprendre cela ! Elle aurait dû faire peindre le décor par Delaw. Mais Mme Sarah Bernhardt connaît-elle Delaw ? C'est la reine du chiqué, la personne qui représente le mieux pour nous ce que nous haïssons dans l'art dramatique. Elle n'a jamais connu au monde que le théâtre, ayant toujours ignoré l'art. C'est la Grande Sarah, l'idole du Chili et du Nicaragua !.. Le fils de l'auteur, Raymond Bernard, tient le grand rôle d'homme. Il est très jeune et fort doué.
J'espère que Jeanne Doré, dont l'idée est tirée de la Dernière Visite, une nouvelle d'Amants et Voleurs, fera lire et relire ce beau livre (1).
L'Échange, de Paul Claudel,
au Théâtre du Vieux Colombier.
Obstinément, en écoutant l'Echange de Paul Claudel, les vers de Mallarmé :
Fuir ! là-bas fuir ! je sens que des oiseaux sont ivres
D'être parmi l'écume inconnue et les cieux !
s'éployaient dans mon souvenir.
Et à propos de son drame, Claudel écrit : « C'est le drame de l'exil. » Fuir ! toujours fuir ce que l'on a atteint : l'amour, la fortune, la gloire, une fois acquis, qu'est-ce ? Fuir toute certitude.
Dans l'Echange, Laine symbolise [cet] attrait vers l'inconnu, et Marthe représente la tradition, le foyer, « les forces obstinées de conservation » la stagnation. Mais la vie peut-elle s'immobiliser ainsi ? Aura-t-on le temps de connaître toutes les émotions, toutes les sensations, tous les climats, tous les fruits, toutes les femmes.
Mais au bout de ces curiosités vaines, que reste-t-il ? la solitude, le dégoût, de soi et de la richesse, si on a mis son inutile effort à l'acquérir. Alors, revenir vers l'illusion du foyer, vers le mirage de l'identification avec un être fait de notre chair et de notre propre inquiétude. Marthe, que Louis Laine a fui, parce qu'elle entravait son rêve, devient un attrait pour Thomas Pollock qui a épuisé toutes les libertés et cherche une chaîne définitive. C'est l'Echange. Ce sont ici des personnages réels, mais alourdis de symboles et de métaphores. Otée, cette richesse métaphorique du style de Claudel, il reste un drame très simple, dans sa brutale simplicité.
Déjà dans cette pièce qui fut écrite voilà vingt ans, perce l'orthodoxie de M. Paul Claudel : il nous montre, dans l'épilogue de sa comédie, Louis Laine, le rêve, tué par l'amour qui est un élément de destruction (et la robe soufre infernal de Mlle Louise Marion en est bien le symbole). Tandis que la courtisane s'endort dans l'inconscience de son crime, devant le cadavre de Laine qu'elle a tué, Marthe se rapproche de Thomas Pollock, et l'on devine que les éléments de poésie, de fantaisie, de destruction, ayant disparu, ces deux êtres vont s'unir pour reformer l'éternelle et fugitive famille humaine, en attendant la mort.
Et tout de même, il y a là, pour ceux qui savent entendre quelque chose de plus que dans les habituelles histoires théâtrales : il y a la richesse d'une langue qui éclaire les choses et les idées et leur donne la clarté nette des galets que la mer a roulés dans son écume. Et c'est sans doute cette précision du verbe qui effare beaucoup de cervelles habituées aux tonalités vagues des mots usés par la vie. Paul Claudel a retaillé, selon sa propre imagination, les diamants de la métaphore, et c'est ce qui a fait dire à quelques-uns qu'il avait inventé une philosophie. Sa philosophie est toute verbale Claudel n'est pas un philosophe, mais un poète.
Un Grand Bourgeois, d'Emile Fabre,
au Théâtre Antoine.
Je croyais entendre une pièce à la Henry Becque, mais l'œuvre nouvelle de M. Emile Fabre m'évoque plutôt le théâtre d'Alexandre Dumas fils, par ses situations convenues, ses tirades et son intrigue sentimentale. De l'A. Dumas fils mâtiné de Georges Ohnet. La petite Matignon a sans doute lu, en effet, quelque Maître de forges, car elle s'est mis dans la tête l'idée singulière d'épouser une sorte de jeune chimiste sans fortune. La pièce roule sur cet amour qui n'est pas très intéressant. Ces deux amoureux sont comme deux pions sur un échiquier. Lui, surtout, n'a ni caractère ni personnalité ; il ne dit rien, il ne fait rien, il n'est rien que celui qu'on veut épouser. C'est tout à fait le cliché du roman-feuilleton. Elle, a souffert d'être négligée par son père, — qui ne reconnaît pas son sang dans cette enfant — et cela lui donne une triste petite personnalité douloureuse.
Qu'elle épouse ou n'épouse pas son petit chimiste, cela nous est absolument indifférent, mais il paraît que c'est très important, et sa mère et son grand-père en font une question vitale. Ils s'imaginent sans doute que la vie doit être basée sur l'amour. M. Matignon, le grand bourgeois, est d'une férocité bien médiocre : il a décidé de donner sa fille en mariage à un industriel millionnaire et très mûr, Elie Spaak, qui la prendra sans dot, et apportera encore au grand bourgeois toutes sortes d'avantages dans ses affaires de concessions et de chemins de fer algériens ; ces affaires industrielles qui constituent le fond de cette pièce sont très conventionnelles. Il ne reste donc que la question sentimentale, c'est-à-dire pas grand'chose.
Le ressort de l'intrigue est celui-ci : la fille du grand bourgeois n'est pas sa fille : il le sait, et il veut réserver toute sa fortune pour son fils.
Lorsqu'il annonce son projet de donner sa fille à Spaak, au parrain de la jeune fille, celui-ci s'indigne trop. C'est lui le père.
Alors, c'est la grande scène de ménage, entre Matignon et sa femme : « Je sais que vous m'avez trompé ; vous avez eu un amant ; votre fille n'est pas ma fille, etc. Et non seulement vous avez eu un amant, mais vous avez vendu vos bijoux, pour entretenir un rasta. » Elle récite un petit couplet sur son droit à la vie, à l'amour, au bonheur. Elle pleure.
Et c'est le marché. Ou bien vous m'aiderez a persuader votre fille d'épouser Spaak, ou bien c'est le divorce, et toutes vos ignominies seront dévoilées.
Non, pas cela, répond-elle ; et elle tombe à genoux aux pieds du grand bourgeois triomphant. Mais entre la fille, qui demande une explication, et prie sa mère d'intercéder pour qu'on lui donne son petit chimiste. Sa mère reste muette. Alors, la jeune personne comprend qu'il y a là un mystère pas très propre... et décide d'entrer au couvent.
Mais tout s'arrange. Ce serait trop long de dire comment. La moralité de la pièce pourrait se résumer dans cet adage : que le vice est toujours puni. Car le vrai père de la jeune Matignon est obligé — le grand bourgeois en fait une condition du mariage — de se retirer en Syrie, et il n'assistera pas aux noces folles de sa filiale filleule. Il est puni par où il a péché. Et la pauvre mère adultère est plus douloureusement punie encore, car on lui pardonne, ce qui est la plus cruelle des injures. Que tout cela est moral et d'un moralisme banal ! Ainsi ce petit hymne de la dame sur l'infamie de l'adultère. Oui, elle a eu des amants, mais elle s'en accuse, elle demande pardon. Elle sait bien que le mariage est sacré, ou devrait l'être ; et c'est pour cela qu'elle veut que sa fille épouse celui qu'elle aime. Si elle a trompé son mari, c'est que leur mariage, à eux, n'a été qu'une affaire... » et que son cœur avait besoin d'amour, d'amour, d'amour, etc.
Et sur ce point, l'observation de M. Emile Fabre est très juste : le bourgeois est instinctivement vertueux : et ce n'est que par une sorte de mimétisme aristocratique qu'il tente de se hausser à la liberté des mœurs. L'immoralisme est une vertu très difficile.
Très bourgeoise aussi, cette indignation de M. Matignon envers le fruit de l'adultère de sa femme. Mais ce n'est qu'une question de sentiment et presque d'imagination. On sait maintenant, d'après telle loi physiologique, que cette fille devait lui ressembler, être en réalité sa vraie fille, que la tendresse de l'amant n'avait fait que susciter. C'est là le cruel — ou consolant — résultat de l'adultère.
(1) Un ami de l'auteur, qui avait assisté à une lecture de la pièce en petit comité nous a assuré que Jeanne Doré produit alors une impression toute différente de celle que donne la représentation sur la scène du Théâtre Sarah-Bernhardt. Ce théâtre est beaucoup trop vaste pour la plupart des tableaux, et la mère devrait être jouée par une femme peuple, au lieu d'avoir cet air de femme, distinguée tombée dans la débine.
pp. 140-144.
[document communiqué par Franck Liebard]
|