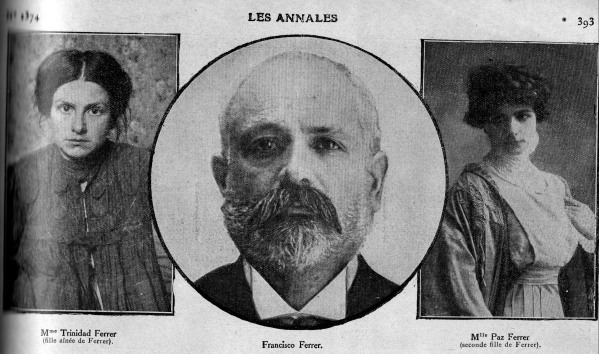|
1er janvier [1909]. La Justice M . DELARUE . — Eh bien ? M. DESMAISONS. —... M. DEL. — Eh bien ? M. DESM. — C'est logique. M. DEL. — Faut-il vraiment attribuer cela au juge ou n'est-ce que l'opinion d'un journaliste inconscient ? M. DESM. — Les juges sont capables de tout. Si l'opinion ne les surveillait pas, en quinze jours, le temps de la meubler convenablement, ils auraient rétabli la chambre de torture, avec chevalets, pinces rougies au feu, brodequins, coins, maillets à enfoncer lesdits coins, et autres instruments idoines à faire parler les muets, car ils ont plus que jamais « l'horrible manie de la certitude ». Je trouve donc relativement innocente l'idée d'arrêter un témoin et de le chambrer dans l'espoir que deux ou trois semaines de secret lui délieront la langue. D'ailleurs, voyez, la presse accueille ce projet avec sympathie. Pour moi, je trouverais plus pratique de faire avaler à ce témoin récalcitrant trente ou quarante pots d'eau fraîche, au moyen d'un entonnoir. S'il n'en crève pas du coup, on le laisse pisser tout son soûl, puis on lui propose de recommencer la beuverie. Alors, il y a tout à parier qu'il préférera dire la vérité, une vérité, plusieurs vérités, autant de vérités que l'on voudra. Le moyen est bon. M. DEL. — Ce juge est, en effet, en bonne voie. N'a-t-il pas inventé une sténographie connue de lui seul ? Il prend des notes avec ces signes secrets et comme il n'y a que lui à pouvoir les interpréter... M. DESM. — Vous avez vu que l'opinion accepte cela très bien. On a même, à ce propos, vanté le génie de cet homme qui, au lieu de perdre son temps à étudier la psychologie, à lire, par exemple, les enquêtes récentes sur « la valeur du témoignage », s'amuse à lutter d'ingéniosité avec feu M. Duployé, inventeur, lui aussi, d'une chose sténographique. Le jeu est innocent et peut même devenir lucratif; mais, appliqué à l'instruction criminelle, il en relève. Instruction secrète aggravée de sténographie mystérieuse ! Hein, ça nous rejette un peu loin dans le passé ! Pas trop, cependant, car, à l'époque lumineuse du droit romain, jamais la loi ne permit, jamais juge n'osa l'interrogation secrète d'un accusé. Les chroniqueurs chrétiens qui fabriquèrent tant de faux Acta martyrum n'y font aucune allusion à la scandaleuse instruction secrète. Parmi tant de forgeries, ils ne songèrent point à celle-là. La civilisation chrétienne, cependant, devait la réaliser et nous jouissons avec reconnaissance de ce bienfait indéracinable. M. DEL. — La complicité du peuple accompagne en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, chaque abus de la justice. Le pouvoir discrétionnaire du juge d'instruction excite au plus haut point son admiration d'esclave et les arrestations arbitraires ne sont pour lui que des incidents scéniques. M. DESM. — Il n'y a presque plus aucun sens de l'équilibre. N'a-t-on pas proposé froidement l'emploi de l'hypnotisme dans les instructions judiciaires ? On endort le patient, on lui fait des questions dont on lui suggère les réponses, et, en trois quarts d'heure, on obtient un criminel accompli. Arracher des aveux par tous les moyens possibles, tel est le principe des juges. L'hypnotisme leur convient à merveille : il suppléera à leur incapacité. M. DEL. — La chasse aux aveux, passe encore, puisque c'est dans notre tradition de peuple assoiffé de vérité, et pourvu qu'elle se fasse avec des armes loyales, mais la chasse au témoignage, voilà le grand abus, ne trouvez-vous pas ? M. DESM. — Je le trouve tellement qu'à mon avis c'est déjà un abus que de citer un témoin. Ce serait, il me semble, au juge à se déranger, tout au moins devrait-on prendre l'heure et le jour du témoin, le prier poliment, lui faire bien comprendre qu'on lui demande un service. On aurait d'ailleurs des témoins, si le témoignage était volontaire, que l'on n'a pas, du moment qu'il est obligatoire. Pour les êtres bornés qui administrent et distribuent ce qu'ils appellent la justice, en leur langage de bazoche, un témoin est un être suspect et traité comme tel. Malheur à qui ne sait plus au bout d'une année ce qu'il faisait le 17 du mois à 2 h. 40. Fumiez-vous un cigare ou une cigarette, lisiez-vous un volume bleu ou un volume jaune ? Vous étiez dehors ? Bien. Pleuvait-il ? Votre pantalon était-il relevé ? « J'insiste, dit Brid'oie, sur ce détail. Il est de la plus haute importance...Vous vous taisez ? C'est bien, je vous arrête. » Ces malheureux sont persuadés qu'un témoin sait toujours quelque chose. Comment leur démontrer que les hommes, au contraire, ne savent presque jamais rien, pas même s'ils vivent ? Quelques-uns parlent, cependant, et d'autres aussi, qui disent le contraire. Alors Brid'oie se fâche tout rouge. Comme il croit à la valeur des témoignages, il se met en colère pour cacher sa déconvenue. Il serait comique, mais il est revêtu d'un « pouvoir discrétionnaire ». On ne rit pas. Un signe de Brid'oie, et vous êtes à l'ombre. Si nous faisions une révolution ? Hein, qu'en pensez-vous, monsieur Delarue ? M. DEL. — Je pense que vous sortez un peu de votre caractère, monsieur Desmaisons. M. DESM. — Oui, et c'est pour cela que je n'aime guère à parler de justice ni d'affaires criminelles. Dès qu'un homme, quel qu'il soit, est aux mains du juge d'instruction, je me sens le frère du malheureux. Vous voyez quel doit être mon état d'esprit quand il s'agit d'une femme sur laquelle il n'y a encore que les soupçons les plus vagues et les plus incertains. Non pas que ma sensibilité soit excessive, je tâche au contraire qu'elle se tienne en de justes limites et que ma raison la guide. Mais j'ai un sens de la droiture que déroute la tortueuse justice. Et puis, je vous redis que je ne me passionnerai jamais pour la répression d'un crime domestique. On peut prévenir tous les crimes, excepté ceux-là. Or, un crime que l'on ne peut prévenir, même en théorie, n'est peut-être pas un crime. M. DEL. — Singulière proposition. Elle demanderait, je crois, quelques commentaires. M. DESM. — Je le crois aussi. p. 211-216. 16 janvier [1909]. Messine M. DESMAISONS. — Evidemment, c'est affreux. Seulement l'horreur prolongée finit par inspirer du dégoût, et les journaux s'y prennent de sorte qu'en moins de huit jours nous en sommes à ce point. A force de lamentations sottes, ils ont rapetissé le cataclysme et en ont fait, non pas même un grand, mais un large fait divers, où barbote une armée de reporters ahuris. M. DELARUE. — Vous êtes dur. M. DESM. Ces gens gâtent par leur verbiage télégraphique une belle tragédie. Vous souvenez-vous du récit de la mort du vieux Pline par son neveu ? M. DEL. — Oui. C'est beau. Le récit ennoblit encore la catastrophe. C'est une impression de fin du monde. Il n'y a de pareil dans toutes les littératures qu'un morceau de M. Rosny, intitulé « Tornades » et qui vous fait vraiment descendre le ciel sur les épaules. M. DESM. — La fin de Messine contée par Rosny... Quand donc les hommes comprendront-ils que les choses n'existent, que les événements ne furent que dans l'impression que nous en éprouvons ? Or, si, après le premier choc, les malheurs de Messine et de Reggio ne nous ont plus troublés que confusément, à qui la faute si ce n'est aux journaux qui ont délayé un cataclysme en mille petites anecdotes d'une signification médiocre ? Ils rendirent l'horreur saugrenue, et burlesque le désespoir. Voici des chiens affamés que l'on « assomme à coups de fusil », et des bandits sans cœur qui « achèvent les cadavres », Il y a des malheurs si grands que les hommes n'arrivent pas à les comprendre, pas même à les sentir. Pour en éprouver quelque émotion, ils sont obligés de les prendre par les petits côtés. M. DEL. — Vous croyez donc que Paris ait été indifférent ? M. DESM. — Presque. Il était bien trop occupé à se battre avec la boue. M. DEL. — Dame ! Vous ne sortez pas, vous, cela vous est égal. M. DESM. — C'est-à-dire que je trouve énorme cette prétention de ne pas ressentir les inconvénients de la neige, quand il tombe de la neige. Les enfants demandent la lune. Bientôt les Parisiens exigeront un printemps perpétuel. M. DEL. — Je vous assure que, si vous étiez sorti, vous ne prendriez pas la défense de l'Administration. M. DESM. — L'Administration est incapable, et je ne la défends pas, croyez-le bien. Mais je suis certain aussi que le public est un peu impatient. De là le conflit. M. DEL. — Je vous accorde le second point puisque vous m'accordez le premier. Cependant, si le public est incorrigible, l'Administration ne l'est peut-être pas, et... M. DESM. — ... et il faut protester, n'est-ce pas ? M. DEL. — Il me semble. M. DESM. — Vous croyez par des mots réformer des acte ? M. DEL. — Si tout le monde criait ? M. DESM. — Cela ferait du bruit, voilà tout. M. DEL. — Un journal a conseillé des réclamations, des procès. M. DESM. — A quoi bon ? Nous sommes dans un engrenage dont rien peut-être ne peut nous délivrer, pas même une révolution, car le lendemain la logique des choses reprend le dessus et donne à M. de Pontich un successeur qui est un autre Pontich. M. DEL. — Vous êtes désespérant. M. DESM. — Allons, pourquoi voulez-vous qu'un monsieur, inamovible de fait, assuré d'une belle pension de retraite, se contraigne à faire son métier ? Pontich a pris ses trois jours de vacances et les a peut-être passés à fouler, le fusil sous le bras, la neige vierge. Quand il est rentré, il a fait activer le feu dans son bureau et il a lu philosophiquement les journaux qui le traînaient dans la boue qu'il avait faite. Ensuite, il a donné la signature qui lui assure une noble gratification de fin d'année et une voiture l'a mené chez lui où il a déjeuné fort bien. Les injures dont on le couvre lui font un sujet de conversation, car il est jovial. M.DEL. — Vous le connaissez ? M. DESM. — Nullement, d'ailleurs il n'est rien qu'un symbole, mais je connais l'administration et les administrateurs. Rien ne les émeut. Les ordres sont donnés une fois pour toutes depuis Napoléon Ier,en de certains cas depuis Louis XIV, voire depuis Philippe-Auguste. La seule différence entre jadis et aujourd'hui, c'est que jadis une autorité les surveillait et qu'aujourd'hui ils sont l'autorité même. Une seule règle les guide, le « précédent ». Nous nous chinoisons de plus en plus, car ce n'est pas l'Europe, malgré ses prétentions, qui a de l'influence sur la Chine ; c'est la Chine, au contraire, qui nous donne ses institutions et, la première de toutes, le mandarinat. M DEL. — Et vous concluez ? M. DESM. — Rien du tout. Me croyez-vous assez simple pour demander des réformes ? Sans doute, on peut supposer un Etat où le fonctionnaire incapable serait aussitôt révoqué, mais cela amènerait d'autres abus. Résignons-nous et faisons, toujours comme les Chinois, des revenus à messieurs les mandarins. Il serait même de bon goût de les remercier de ne pas, comme leurs confrères jaunes, nous mener au bâton. Ils se contentent, en effet, de nous faire payer l'amende, de temps à autre, pour augmenter leurs pourboires du jour de l'an. M. DEL. — Vous n'êtes qu'un anarchiste. M. DESM. — Rien que cela ? Dieu vous entende ! Et il vous entendra, car il se connaît en anarchie, celui-là, dont « rien n'arrive en ce monde sans son ordre ou sans sa permission », dit le catéchisme chrétien. Si nous imitions l'exemple qu'il nous a donné à Messine ? Qu'en diraient messieurs les administrateurs ? Mais je n'irai pas jusque-là. Je reste dans mon coin, d'où je contemple, non sans émotion, les péripéties du désordre universel. Ah ! mon ami, que nous sommes privilégiés ! M. DEL. — C'est tout de même vrai. p. 216-221. 1er février [1909]. La Pucelle M. DESMAISONS. — Vous aussi ? M. DELARUE. — Oui, j'ai pour elle une vieille admiration sentimentale. M. DESM. — Eh bien ? M. DEL. — Eh bien, je la défends quand on l'attaque. M. DESM. — Soit, mais par qui a-t-elle été attaquée ? M. DEL. — Voyons ? M. DESM.— Je vous assure... M. DEL. — Alors, c'est que vous trouvez bénignes les injures de Thalamas ? M. DESM. — Quelles injures ? M. DEL. — Des injures telles que tous les honnêtes gens en sont révoltés. M. DESM. — Je répète : Quelles injures ? M. DEL. — Mais il a mis en prose, tout simplement, la Pucelle de Voltaire. M. DESM. — Et vous avez lu ce petit travail ? M. DEL. — Non, je l'ai négligé, étant peu curieux de cette sorte de littérature. M. DESM. — Vous avez eu tort. M. DEL. — Il y a tant d'autres choses à lire, plus attrayantes. M. DESM. — Hé ! Le travail de M. Thalamas n'est point méprisable. M. DEL. — Vous osez ?... M. DESM. — J'ose. M. DEL. — Je crains que cette fois nous ne puissions nous mettre d'accord. M. DESM. — Moi, je ne le crains nullement. M. DEL. — Est-ce à dire que vous méprisiez mon opinion ? M. DESM. — Calmez-vous, cher ami. Dans quelques minutes, mon opinion sera la vôtre. M. DEL. — Jamais. M. DESM. — Puisque je vous le dis. M. DEL. — Jamais. Je ne puis transiger. M. DESM. — Point de transaction, en effet. Adhésion totale, sincère et joyeuse : telle va être votre attitude. M. DEL. — Je vous vois venir : vous avez un secret. M. DESM. — Oui, j'ai un secret. M. DEL. — Soit. M. DESM. — Vous n'avez donc point lu, vous le reconnaissez, la brochure de M. Thalamas intitulée : « Jeanne d'Arc. L'Histoire et la Légende » ? M. DEL. — Non. M. DESM. — Eh bien, nous allons la lire ensemble. M. DEL. — Je me résigne. M. DESM. — Voulez-vous que nous commencions par le portrait psychologique de la Pucelle ? Après cela, vous serez probablement fixé. M. DEL. — Probablement. M. DESM. — C'est le seul endroit de la brochure, du reste, avec un bref passage vers la fin, qui contienne une appréciation un peu caractéristique. M. DEL. — Cela va être joli ! M. DESM. — Vous y êtes ? M. DEL. — Allez. M. DESM. — « Le savant doit donc reconnaître que Jeanne a eu des hallucinations olfactives, tactiles, visuelles et surtout auditives. Mais elle n'a nullement été une délirante vulgaire, à la merci d'impressions irraisonnées. Les voix ne furent point pour elle des obsessions annihilant sa volonté. Son robuste bon sens, sa finesse naturelle, son esprit d'à-propos ne l'abandonnèrent jamais ; les saints furent pour elle des conseillers qui renforcèrent de leur autorité morale les suggestions de sa raison, et non des maîtres qui annihilèrent son indépendance d'esprit... » M. DEL. — Il ne dit donc pas qu'elle était folle ? Mais, est-ce bien du Thalamas, ce que vous me lisez ? M. DESM. — Voyez vous-même, cher ami. M. DEL. — En effet. C'est bien singulier. M. DESM. — Je continue ? M. DEL. — Je vous en prie. M. DESM. — « Elle a discuté avec eux, leur a désobéi parfois. En même temps, l'exaltation causée en elle par la ferme croyance en sa mission divine n'a nullement changé la bonhomie ni la générosité de son caractère. Jusqu'au bout, elle est restée vaillante avec simplicité, soucieuse de ne compromettre qu'elle-même et de se sacrifier même pour des ingrats, puritaine au point de forcer des soudards à se confesser et de casser sur le dos de deux ribaudes l'épée rouillée de sainte Catherine, mais charitable aussi pour les prisonniers et compatissante à toutes les misères... » M. DEL. — Il ne l'accuse donc pas d'avoir été une débauchée ? Vous ne passez rien ? M. DESM. — Pas un mot. M. DEL. — Il ne lui prête pas un seul amant ? M. DESM. — Pas un seul. M. DEL. — Quoi ! Pas même d'Alençon ? M. DESM. — Fi donc ! M. DEL. — Pas même Dunois ? M. DESM. — Pas même. M. DEL. — Il est modéré. Une jeune fille seule dans un camp, entourée de galants gentilshommes... M. DESM. — Monsieur Delarue, c'est moi qui vous rappelle à l'ordre. Nous lisons la vie de Jeanne d'Arc par M. Thalamas, c'est-à-dire par un homme respectueux de son héroïne et peu enclin aux hypothèses galantes. M. DEL. — Je suis médusé. M. DESM. — Silence : « C'est là ce qui fait l'originalité et la grandeur de cette paysanne admirable... » M. DEL. — Il l'admire, maintenant ! M. DESM. — «... égarée au milieu des égoïsmes et des brutalités d'un âge anarchique ; c'est là ce qui expliquera supériorité sur les autres voyantes et l'enthousiasme qu'elle a soulevé dans les masses populaires, grâce à ses réponses toujours frappées au coin d'un bon sens toujours un peu gouailleur et à ses exemples d'un courage inlassable et communicatif... » M. DEL. — Je suis convaincu, je cède. J'avoue Thalamas pour un des chevaliers de la Pucelle. M. DESM. — Je veux vous accabler : « Elle a été pour les Français un signe de ralliement ; elle a provoqué, jusque chez Charles VII lui-même, des élans d'enthousiasme. C'est Jacques Bonhomme, s'élevant naturellement, par la notion du danger réel et l'ardeur des convictions fortes, jusqu'à un véritable héroïsme ; c'est un Socrate paysan dont le démon a pris, en raison du temps, des allures chrétiennes. Est-ce à nous, qui considérons le génie comme une névrose, de reprocher à Jeanne d'avoir objectivé en des saints les voix de sa propre conscience ? » M. DEL. — Vous me voyez stupéfait. Je cherche à comprendre, et en vain. Ma tête tourne un peu. Quoi, c'est là l'œuvre que l'on juge injurieuse pour Jeanne d'Arc ? C'est là l'homme que l'on accable d'outrages, que l'on voudrait mettre au banc de l'Université et de la société tout entière ? Savez-vous que cela va loin dans le mensonge et dans l'infamie... M. DESM. — Cela va loin, je le reconnais ; mais en serez-vous surpris ? M. DEL. — Si j'en suis surpris ? J'en suis tout dérouté. M. DESM. — En vérité, et moi aussi. Je veux rester calme, mais l'indignation me secoue intérieurement. Il me faudrait une explication pour m'apaiser un peu. La logique est pacificatrice. M. DEL. — Vraiment, je ne trouve rien. M. DESM. — La bêtise ? M. DEL. — Le fanatisme ? M. DESM. — L'ignorance ? M. DEL. — Au fait, se battre pour la Pucelle, en l'an 1909, vous ne trouvez pas cela un peu byzantin ? M. DESM. — Je trouve cela romantique, ce qui ne vaut guère mieux. Mais la question n'est point là. Une lutte académique sur les mérites de Jeanne d'Arc ne serait pas fâcheuse ; elle serait sans intérêt. Je crois qu'au fond la Pucelle n'est pour rien dans cette affaire. Battue sur le terrain des dogmes théologiques, l'Eglise porte la guerre sur celui des dogmes historiques. C'est en ce sens que nous sommes dans le byzantinisme, et tout cela serait vain s'il ne s'agissait aussi, sans qu'on y prenne garde, de la liberté scientifique. Mon ami, relisons encore une fois la dernière page de l'Ecce Homo. Nous avons le cinquième évangile, celui qui, de ses tons éclatants et sains, efface les pâles couleurs des quatre premiers. Ne voilà-t-il pas de quoi nous consoler des plus affligeants spectacles ? M. DEL. — Essayons toujours. p. 221-228. 16 février [1909]. La Messe M. DESMAISONS. — Il est certain que la piété fait en France les plus grands progrès. Nos meilleurs écrivains hantent les confessionnaux M. Bourget dit son chapelet dans les coulisses, pour dépister le Malin ; M. Jules Lemaître récite ses petites heures, à l'Imitation des pieux solitaires du grand siècle ; M. Barrès, l'enfant gâté des Jésuites, repasse les exercices du grand Loyola. Les moins avancés dans la vie spirituelle tombent à poings fermés sur M. Thalamas, ce qui est œuvre pie, et les plus avancés dans la vie politique profèrent le grand cri du ralliement socialiste : la Messe pour tous ! M. DELARUE. — Faites des phrases, cher ami, cela n'empêche pas que nous ne soyons en plein mouvement chrétien. M. DESM. — Mais puisque je suis de votre avis ! M. DEL. — Oui, mais cela ne vous indigne pas. M. DESM. — Cela m'amuse. M. DEL. — Franchement ! M. DESM. — Cela m'amuse, vous dis-je, cela flatte mon scepticisme historique, cela renforce ma vieille pitié pour l'humanité et cela me dispense de rêver à son bonheur, en me démontrant clairement l'inanité de tous les efforts. M. DEL. — Je ne trouve pas que cela soit un résultat merveilleux. M. DESM. — Au contraire. M. DEL. — Merveilleux, le découragement ? M. DESM. — Cela repose. M. DEL. — Cela endort. Il faut se défendre. M. DESM. — Pourvu que ma pensée reste libre, que m'importe le reste ? M. DEL. — Je ne crois pas que vous parliez très sérieusement. M. DESM. — Non, pas très sérieusement, mais je suis las, aujourd'hui, et nullement prêt à l'attaque. M. DEL. — Fichtre ! Ce n'est pas le moment de se reposer. L'ennemi nous entoure, il resserre son anneau. Il faut se battre ou se rendre prisonniers. M. DESM. Ils ne peuvent rien contre ma sérénité. M. DEL. — Mon cher, aujourd'hui, l'armée demande à aller à la messe; elle vous forcera d'y aller vous-même. M. DESM. — Hein ? M. DEL. — Dame ! Cela s'est vu. M. DESM. — Tout de même ! M. DEL. — Pourquoi pas ? M. DESM. — Pas encore demain. M. DEL. — Aller à la messe, ce n'est pas le diable. M. DESM. — Nous y sommes tous allés, plus ou moins, nous ne sommes pas huguenots, cela nous est bien égal. S'embêter au café ou s'embêter à l'église. Même, à l'église, le décor... M. DEL. — Oui, mais aller à la messe, c'est un symbole, et dont le contenu est assez riche. Je le résume en trois ou quatre mots : Soumission entière à l'Eglise et à ses enseignements. M. DESM. — Enfin, vous voulez me faire admettre qu'il y a un péril religieux. M. DEL. — Je ne pense pas que vous en doutiez. M. DESM. — J'en doute. M. DEL. — Vous êtes optimiste. M. DESM. — Quelquefois. M. DEL. — Ce n'est pas le moment. M. DESM. — Tenez, je me réveille et je vous concède qu'il y a péril. Mais le péril n'est pas grand, parce que l'ennemi est sans valeur. A quoi bon lui déclarer la guerre, quand la nature entière se dresse contre lui ? Est-il une science, et pas même une science, une connaissance positive qui soit conciliable avec l'idée religieuse ? Est-il un fait même où elle puisse s'insérer logiquement ? Essayez de trouver la place de la Providence dans la catastrophe de Messine, dans nos accidents coutumiers, dans nos vies quotidiennes. Essayez, en restant dans la logique, de découvrir un événement historique ou un fait de laboratoire où se voie l'intervention de Dieu. Mais pourquoi vous dire tout cela; ne le savez-vous pas comme moi-même ? M. DEL. — Oui, mais Ils ne le savent pas, eux, et ils ne le sauront jamais, et pourtant ils sont une force. Alors, il faut se garer contre cette force. M. DESM. — Elle se dissoudra d'elle-même. M. DEL. — C'est bien imprudent de compter là-dessus. Restons dans les contingences. Il n'y a qu'un moyen pour les sociétés modernes de rester libres, c'est de refuser la liberté aux Eglises. M. DESM. — Vous êtes radical. Encore faudrait-il trouver la méthode selon laquelle on pourrait leur refuser la liberté. M. DEL. — Sans doute, c'est difficile... M. DESM. — Résignons-nous à vivre avec ces contradicteurs débiles. Leur discours est invariable et monotone : un jour viendra où ils n'oseront plus le répéter, tant ils seront sifflés. Et puis, franchement, tout cela est pour moi de nul intérêt. Cela n'existe pas. M. DEL. — Autruche ! M. DESM. — Les hommes sont de faibles animaux qui, malheureusement, ont conscience de leur faiblesse. Alors ils cherchent un appui dans leur imagination. Alors ils inventent les religions, créations merveilleuses, entièrement imaginaires, bâties sur rien, avec rien ! Moi, je trouve cela très curieux. C'est pourquoi j'ai étudié plusieurs théologies, principalement la catholique, dont les matériaux abondent. Si les curés redevenaient dominants, je me révélerais théologien et l'un de leurs maîtres. Je me ferais casuiste. Mes arguties sur les péchés de la chair feraient oublier celles des Sanchez et des Liguori. Anatole France, qui est bien avec les socialistes, recevrait la pourpre. Il tiendrait académie comme Bembo et nous aurions de belles controverses. M. DEL. — Vous n'êtes pas sérieux. M. DESM. — Ne me l'avez-vous pas déjà dit ? Que voulez-vous. La religion pour moi, c'est une féerie. Voulez-vous que je disserte avec gravité du Chat Botté ou de Simbad le Marin ? M. DEL. — Moi, je suis voltairien. M. DESM. — Bien. Vous aurez une abbaye. p. 228-233. 1er mars [1909]. Juges M. DELARUE. — Vous n'avez jamais été juré ? M. DESMAISONS. — Non. M. DEL. — Ni moi. Vous seriez dur ? M. DESM. — Pour les professionnels, très dur. Pour les passionnels, très pitoyable. M. DEL. — Et pour les occasionnels ? M. DESM. — Ceux-là rentrent dans l'une des deux premières catégories. Il y a des hommes qui ne commettent qu'un crime, et tard dans leur vie. mais ils l'ont médité pendant vingt ans. Ce sont des professionnels, eux aussi. Quant à ceux qui n'ont agi qu'à l'improviste, tentés par l'occasion, ce sont des débiles, clients tout indiqués pour un régime roboratif. Je sais bien, au fond, que personne n'est ni responsable ni irresponsable, que les hommes ne sont que des balles dans la main du frondeur, mais il faut bien agréer quelques nuances, pour embellir nos discussion.. M. DEL. — Pourquoi le crime serait-il un symptôme de maladie ? N'est-il point naturel de vouloir conquérir un avantage par la violence, aussi bien que par la ruse, par la flatterie, par la servilité ? J'aime mieux le coup de couteau que la bassesse. Le tigre, pourvu que je n'aie point affaire à lui, me paraît plus beau que le chien. M. DESM. — « Pourvu que je n'aie point affaire à lui. » Voilà le nœud de la question. Mais, dans la vie, nous avons tous affaire les uns avec les autres, et je préfère le traître qui voudrait m'estamper au malandrin qui m'insère entre les côtes son couteau à virole. La violence ne peut se tolérer ; elle est toujours justiciable du conseil social. M. DEL. — Oui, mais du point de vue esthétique? M. DESM. — N'abusons pas des termes. Un beau crime demeure ce qu'il y a de plus laid au monde. Celui qui créa cette expression voulut prouver son romantisme, sans doute, plus que sa raison. J'ai vu dans un hôpital un médecin s'extasier sur de rares syphilides : « Que c'est beau ! La belle formation ! Les belles couleurs ! « Je crus qu'il allait baiser ces merveilleuses cuivrures. Mon ami, ne parlons pas comme des apaches. Si un crime n'est pas toujours criminel, il est toujours triste et toujours vilain. M. DEL. — Cependant vous admirez Christine ? M. DESM. — Hélas ! M. DEL. — Alors ? M. DESM. — D'abord, je l'aime moins depuis que j'ai appris qu'elle avait communément les mains sales, et le reste un peu plus, sans doute. Ensuite, nous sommes ici dans les crimes mal connus. Quel fut le vrai mobile du meurtre? J'ai toujours cru que Monadelschi était un grand bavard ou un terrible raseur. M. DEL. — Ah ! Comme avec un peu d'astuce je vous ferais vite fouler aux pieds vos principes ! M. DESM. — C'est fort possible, car je suis plein de contradictions, dont je rougis, mais dont je jouis aussi, ce qui me réconforte. M. DEL. — Vous serez juré. Cela vous embarrassera. M. DESM. — Cela m'embarrasserait beaucoup, vous dites bien, surtout en quelque affaire comme celle de la rue de la Pépinière. M. DEL. — Vous n'eussiez pas condamné Renard, je pense ? M. DESM. — Dame, et vous ? M. DEL. — Il serait curieux d'être juré, pour observer, dans son exercice, la mentalité des bonshommes révélés juges sur la minute. Quant, à juger, moi-même, jamais ! M. DESM. — Croyez-vous que ces mentalités soient si curieuses que cela ? M. DEL. — Peut-être. M. DESM. — Vous avez entendu des conversations de café, de cercle, de wagon de chasseurs ? M. DEL. — Sans doute. M. DESM. — Eh bien ! vous avez été juré. L'unanimité, ou quasi, dans le cas Renard, ne peut vous laisser aucune illusion sur les affres de ces braves gens. Ils jugent d'un crime comme d'un coup au billard, au bridge ou à la chasse, avec des certitudes, des entêtements pareils, mais beaucoup moins de compétence. Etre juge ! Comment peut-on consentir à être juge, quand on ignore ce que c'est qu'une preuve ? M. DEL. — Y a-t-il des preuves, en matière psychologique ? M. DESM. — Non. Il n'y a de preuves que les faits, non pas même avoués, mais contrôlés, tournés et retournés, vérifiés dix fois. Ensuite de quoi, on peut encore douter. Savez-vous ce qui a déterminé la condamnation de Renard ? M. DEL. — Oui, je le sais : ce sont ses mauvaises mœurs. M. DESM. — Ah ! cher Delarue, vous avez bien de l'esprit ! Je vois que nous avons goûté également tous les deux le raisonnement de Mme de la Pépinière : « Il a débauché mon neveu, donc il a assassiné mon mari. » Quel jury ne se laisserait prendre à tant de simplicité ! Notez que le ministère public n'a point raisonné autrement : « On commence par l'homosexualité, on finit par le crime. » M. DEL. — Je n'avais pas retenu cela. Est-ce possible ? On croit rêver. M. DESM. — Considérez encore comme cet enchaînement est rassurant. L'assassinat n'est point évident, mais il est rendu très probable par un état criminel antérieur et ancien, qui est la pédérastie. Tous les crimes se tiennent. Un péché en amène un autre. Et on conclut : « Cet homme est peu digne d'intérêt. S'il est innocent de ceci, il est coupable de cela. Qu'il expie ses mauvaises mœurs. » M. DEL. — Mais c'est un raisonnement digne du Saint-Office, cela. M. DESM. — Et le procureur a parlé comme un inquisiteur. On lui reproche un crime possible et un péché certain. Ce n'est pas la loi civile qui a jugé, c'est la loi religieuse. M. DEL. — Quel rapport peut-il y avoir entre l'aptitude à l'assassinat et une méthode d'exonération ? M. DESM. — Ce sont les mystères de la logique moraliste. M. DEL. — La méthode n'est pas belle, mais... M. DESM. — Mon cher, nous ne comprendrons jamais. A vouloir entrer dans une telle logique, on se donne la migraine, et voilà tout. M. DEL. — Je trouve cela idiot. M. DESM. — Signe que vous ne comprenez pas. Et après ? M. DKL. — Tout de même, c'est énervant. M. DESM. — Si vous êtes si délicat, cher ami, détournez vos yeux de la justice. Il faut un cœur solide pour contempler sans émoi... M. DEL. — Parlons d'autre chose. M. DESM. — ... les exercices... M. DEL. — Tiens, le soleil ! p. 234-239. 16 mars [1909]. Religions M. DELARUE. — Eh bien, nous voici dotés d'un nouveau professeur pour l'histoire des religions. M. DESMAISONS. — Il paraît. M. DEL. — Et vous êtes content ? M. DESM. — Enchanté. M. DEL. — C'est-à-dire que cela vous indiffère profondément. M. DESM. — Profondément. M. DEL. — Enfin, c'est un savant, dans son genre. M. DESM. — Oui, dans son genre. Il est de première force sur l'Evangile selon saint Jean. M. DEL. — Et sur l'Apocalypse ? M. DESM. — Sur l'Apocalypse, pareillement. M. DEL. — Et sur la guitare ? M. DESM. — Sans doute. M. DEL. — Quel est le résultat de ses études ? M. DESM. — Rien. M. DEL. — Comment, rien ? M. DESM. — Rien qui puisse nous intéresser. M. DEL. — Mais encore ? M. DESM. — Mon cher ami, les Loisy, les Tyrrell, les Houtin, tous ces fameux exégètes, sont des relavures de Calvin, de madrés compagnons qui émondent le dogme pour lui faire porter de plus solides fruits ; d'un autre mot, des chrétiens exaspérés. M. DEL. — Mais on dit que M. Loisy n'admet pas la divinité de Jésus-Christ. M. DESM. — Ne vous y fiez pas. Et puis, ne voilà-t-il pas une belle audace, et neuve ! M. DEL. — Ce n'est pas mal pour un curé. M. DESM. — Curés, en effet, car ils le demeurent, et logiquement. Le christianisme est une doctrine, avant d'être un dogme, et l'on est chrétien, encore que l'on rejette même l'essentiel du dogme. Arius ne croyait pas à la divinité du Christ, et il n'en fut pas moins un fougueux apôtre. Le monde d'Europe fut arien, à un moment de l'histoire, sans cesser d'être chrétien. Que Jésus soit Dieu, qu'il participe seulement à la divinité, qu'il soit le fils réel, ou spirituel, ou figuratif de Dieu, qu'il ne soit que son envoyé, son ambassadeur près de l'humanité ; qu'il soit moins encore, un sage, tout bonnement, inspiré de l'esprit divin, comme Moïse, comme les prophètes, et le christianisme subsiste toujours. Au contraire, plus on le simplifie, plus ou le taille, plus on le rapproche de la raison, et plus on le rend vénéneux pour ces intelligences moyennes qui, répugnantes au dogme, sont avides de doctrine, comme le boiteux est avide de béquilles. M. DEL. — Hé ! hé ! Vous aussi, vous avez un joli petit talent sur la théologie. Vous auriez fait un hérétique appréciable. M. DESM. — Rien ne m'aurait plus répugné. Je pense, avec Pascal, que si l'on se mêle de croire, il faut croire tout, en commençant par le plus bête. Je ne déteste pas les religions, je les tiens au contraire pour des monuments infiniment curieux, et le catholicisme, en particulier, m'agrée pour la richesse de ses mystères, de ses rites, de ses pratiques. Quoi de plus intéressant qu'un exorcisme ? Et les prières pour faire pleuvoir ? Et les scapulaires ? Et la messe, ce triomphe de l'idéalisme verbal ? Quoi de plus tragique que le sérieux du prêtre qui croit détenir l'infini dans un gobelet ou dans une botte à pastilles ? Il me semble que j'étudierais éternellement, sans jamais me lasser, toutes ces merveilles ; je ne suis donc pas surpris que les simples s'y laissent prendre. L'absurde a sa beauté et aussi son aimant. Je tiens beaucoup à ma religion ; il n'en est point de telle au monde, et le bouddhisme même, encore qu'il ne soit à dédaigner, n'en approche pas. Ah ! si les prêtres n'étaient, comme les Saliens ou les Galles, que des danseurs, des tubistes et des cymbaliers ! M. DEL. — Oui, mais ils sont autre chose encore. M. DESM. — Hélas ! M. DEL. — Ou du moins ils en ont la prétention. M. DESM. — Que voulez-vous dire ? M. DEL. — Que, parmi toutes leurs extravagances, ils veulent paraître raisonnables. M. DESM. — Ce n'est pas aux vrais prêtres que je ferais ce reproche. Si merveilleusement absurde que soit une religion, il faut bien qu'elle se croie raisonnable et qu'elle impose cette créance. L'homme le plus fou ne peut vivre qu'en se croyant doué de raison, et ce n'est que par la raison qu'on lui accorde, qu'il possède crédit et pouvoir près des autres hommes. Un fou vint me voir un jour et me démontra avec d'excellents arguments qu'il possédait toute sa raison. Les religions ne font pas autrement, et cela complète, cela souligne leur physionomie. M. DEL. — Mais le fou réussit-il à vous convaincre ? M. DESM. — Nullement, et j'y vis une preuve nouvelle de son état. Si les religions évoluaient en conformité avec la raison humaine, avec cette logique générale qui guide, même dans l'inconscience, nos actions pratiques, elles ne sentiraient aucunement le besoin d'une permanente apologie. Chaque semaine, cependant, voit naître quelque traité où l'Eglise se réclame de cette logique générale qu'elle transgresse et que sa logique particulière est de transgresser. Cette manie apologétique est un symptôme de la conscience même qu'elle a de son excentricité, mais rien de plus. Ce n'est pas en ce sens et en cette circonstance que je blâme le mot « raisonnable» appliqué aux religions et à la nôtre en particulier ; je le blâme, et, pour tout dire, il me dégoûte profondément, quand je le vois servir, non pas d'argument, mais d'instrument; quand, manié par un réformateur, il devient les cisailles avec quoi on élague les frondaisons du merveilleux. Je vous ai déjà parlé, je crois, d'un petit livre du XVIIIe siècle appelé le Christianisme raisonnable. M. DEL. — Je ne me souviens pas. M. DESM. — Eh bien ! il n'en est pas qui me soit plus odieux, car il n'en est point de plus corrupteur. Non, laissez, que le christianisme, au contraire, demeure une déraison. C'est ainsi qu'il doit vivre pour être relativement inoffensif. Réduit à un sage déisme, à une honnête morale, il vous tenterait peut-être, comme un joli champignon blanc et rose avec, sous son chapeau frais, de délicates lamelles transparentes, et, dans le cœur, une charge de poison. M. DEL. — M. Jules de Gaultier a dit à ce propos, je crois, des choses très sensées ? M. DESM. — Il ne saurait dire que des choses très sensées. Je crois, en effet, que son argument n'est pas éloigné du nôtre, car vous m'approuvez, n'est-ce pas ? M. DEL. — À demi, car si les superstitions, vues de l'extérieur, sont curieuses... M. DESM. — Mais quand on est entré dans leur cercle, on les sent comme vérités, et non comme superstitions. M. DEL. — C'est cela précisément qui est fâcheux. M. DESM. —. Faut-il donc chercher à déconvertir les gens ? M. DEL. — Non, non, l'indifférence. M. DESM. — Cela serait-il digne d'un philosophe ? M. DEL. — Point. M. DESM. — Eh bien, voilà pourquoi je ne suis point moderniste. Tenons-nous-en aux décisions trois fois saintes du vénérable père Letailleur, pape sous le nom de Pie X. C'est à lui, et non à M. Loisy, que je veux m'en rapporter pour le dogme, non moins que pour la doctrine et pour la pratique. Si vous aviez à étudier le bouddhisme, n'auriez-vous pas plus de confiance dans le Grand Lama ou dans le Sacré Collège des Lamas, qu'en tel pauvre hérétique dépouillé de la robe jaune ? M. DEL. — Et maintenant, si nous lisions un peu de Voltaire, pour nous débarbouiller la cervelle ? M. DESM. — J'ai quelque chose de mieux. M. DEL. — De mieux ? Fichtre ! M-, DESM. — De plus neuf, si vous voulez. M. DEL. — Je devine : c'est l'Orpheus de Salomon Reinach. J'ai le mien dans ma poche. M. DESM. — C'est sa place. Avec ce gros petit livre, on met toutes les religions dans sa poche. M. DEL. — Vous l'avez donc lu, déjà ? M. DESM. — Oui, et j'en ai été fort satisfait. Enfin, nous avons une histoire des religions. M. DEL. — Moi, je n'ai pas encore osé y entrer. Les religions, j'aime à regarder cela d'un peu loin. p. 239-246. 1er avril [1909]. Postes M. DELARUE. — Eh bien, cher ami, notre curiosité ne chôme pas. Tous les jours du nouveau. Cette grève des postes m'excite infiniment. Et vous ? Vous ne dites rien. M. DESMAISONS. — Je crains que cela ne rate encore. M. DEL. — Cela marche. M. DESM. — Quand je dis : je crains, c'est par politesse pour votre enthousiasme, car il est bien évident qu'il ne peut sortir de là quelque chose de vraiment intéressant. Révolution ? se sont demandé quelques journaux. Mais pour faire une révolution il faut le désir et la foi d'une nation tout entière. Nous en sommes loin. Ce débat entre des employés et leur chef est peu passionnant, d'autant plus qu'on en ignore la cause. Une seule chose est claire, c'est que les Postes, qui marchaient mal, ne marchent plus du tout. Elles étaient malades, elles sont mortes. Cela arrive. M. DEL. — Et vous ne sentez pas combien cela est terrible et beau en même temps, c'est-à-dire tragique ? M. DESM. — Non, je trouve cela ennuyeux. M. DEL. — C'est passionnant ! M. DESM. — Mettons que c'est triste. Une grande construction s'écroule. M. DEL. — Nous sommes presque d'accord. M. DESM. — On rebâtira, mais cela ne sera jamais bien solide. C'est l'histoire de toutes les institutions. Arrivées à l'état presque parfait, elles déclinent, disparaissent. La perpétuité d'un organisme qui n'est point vital ne peut être assurée. Or, les hommes se sont passés si longtemps de la poste et au milieu des civilisations les plus brillantes, qu'ils s'en passeront bien encore. M. DEL. — Vous voulez rire. M. DESM. — Presque pas, je prétends que ce que les bourgeois et les ouvriers dégourdis appellent « les conquêtes du progrès » est fragile au point de pouvoir disparaître en deux jours. N'en avez-vous pas la preuve pour les postes, télégraphes, téléphones ? Demain, il peut en arriver de même pour les chemins de fer. M. DEL. — Sans doute, et je m'étonne même que les deux syndicats ou associations n'aient point marché d'accord, mais il s'agit d'interruptions volontaires et non de destructions fatales. M. DESM. — Mon cher, rien n'est volontaire, tout est déterminé. La recherche des causes n'est que la recherche des fatalités. Ni les télégraphistes, ni les postiers de tout genre ne savent ce qu'ils font. Ils croient travailler pour eux et ils travaillent pour le désordre universel qui est la conséquence nécessaire d'un siècle d'ordre et d'obéissance. Pourquoi une machine s'arrête-t-elle ? Parce qu'elle a marché. M. DEL. — On la remplace. M. DESM. — Rien n'a remplacé pendant douze cents ans les voies romaines qui recoupaient l'Europe occidentale et l'Orient, du Caucase à la Nubie et à l'Atlantique. Qui vous dit que nous n'entrons pas, par la force même de logique des civilisations, dans une phase d'anéantissement ? M. DEL. — Oh ! oh ! M. DESM. — Je maintiens que tout peut sombrer en deux jours. Maintenant, quand un pan de mur chancelle, on recourt à l'armée qui l'épaule, mais l'heure n'est pas loin où l'armée elle-même fera grève, et alors il faudra bien que le mur tombe, et avec lui le reste de l'édifice. M. DESM. — Et c'est vous qui arrangez ainsi l'histoire future ? M. DESM. — L'histoire de demain, cher ami. C'est-à-dire que je ne prédis pas, je constate. Ce n'est pas prédire le temps que d'annoncer pluie ou grêle quand le ciel est noir, c'est tirer la conséquence d'un fait visible et certain. M. DEL.— Diable ! Ce ne serait pas tragique, alors, cela serait affreux. M. DESM. — Cela serait affreux, d'abord. Ensuite on s'arrangerait. Erasme a écrit autant de lettres que Voltaire, à une époque où les routes n'étaient que des pistes, et Voltaire en a écrit plus que quiconque d'aujourd'hui, à une époque où la poste fonctionnait, en temps normal, comme chez nous en temps de grève. Il est très possible qu'une corporation autonome des Postes assurât le service mieux que l'Etat. M. DEL. — Ce serait très possible. Après tout, ce sont d'analogues corporations qui ont bâti les cathédrales. M. DESM. — L'étatisme a peut-être donné toute sa valeur et peut-être que le syndicalisme est le mode social qui doit nous préserver de l'anarchie. M. DEL. — L'anarchie aurait du bon pour un curieux comme moi. Ne jamais savoir ce qui va arriver, éprouver mille inquiétudes, donc mille désirs à la fois. H. DESM. — Vous n'êtes pas seulement anti-social, monsieur Delarue, vous êtes anti-humain. L'homme, au contraire de vous, est un animal qui veut toujours savoir ce qui va arriver, qui souffre à la moindre inquiétude et qui veut ses désirs réglés comme une horloge. Voyez les Postiers. Ils auraient été contents d'être assurés d'avancer en fortune tous les trois ans, à jour fixe. Cela réglé, on délivre des mandats, on joue à la manille et on dort. Moi, je n'ai jamais été assuré de rien dans la vie, jusqu'à ces derniers temps, et encore ? Mais j'aurais été bien content de l'être, j'aurais travaillé avec plus de goût et je serais moins ignorant. M. DEL. — Il me faut de l'inquiétude, que voulez-vous ? C'est pourquoi je me plais à cette grève des Postes. Je halète vers un dénouement que je ne souhaite pas trop proche, cependant. Je désire qu'il arrive quelque chose, et pourtant ce qui arrivera ne peut, selon mes prévisions, m'intéresser beaucoup. M. DESM. — Vous feriez mieux de vivre en vous-même. M. DEL. — Non, je suis l'homme qui regarde par la fenêtre. M. DESM. — Et vous ne vous ennuyez jamais ? M. DEL. — Jamais, quoique j'éprouve bien des déceptions. Il se passe trop peu de choses. M. DESM. — Et encore sont-elles toujours les mêmes. M. DEL. — Hélas ! Même la grève des Postes, si je réfléchis bien, il me semble que je l'ai déjà vue. M. DESM. — Rassurez-vous, c'est tout de même assez nouveau. M. DEL. — Ah ! tant mieux. M. DESM. — Et, dans ce genre-là, je crois que le nouveau ne vous manquera plus jamais. M. DEL. — Vous me comblez. p. 246-252. 16 avril [1909]. L'Académie M. DEL. — Eh bien, vous êtes content de l'Académie, je pense. M. DESMAISONS. — Assez content. Le lendemain de chaque élection, elle existe un peu moins que la veille. Elle s'éteindra ainsi tout doucement, un jour que le poète Paul Déroulède recevra le poète Théodore Botrel, et ce sera un grand avantage pour les lettres françaises. M. DEL. — Comment cela. M. DESM. — En sauvant les écrivains de talent soit des palinodies que leur impose aujourd'hui la candidature, soit de l'humiliation d'être mis en balance avec tel domestique de lettres. M. DEL. — Mais quel besoin un homme de valeur a-t-il de postuler l'entrée de cette maison de retraite ? M. DESM. — Non pas un besoin, cher ami, mais parfois le besoin, tout court. Plus souvent, une vanité de coterie ou de famille. On souhaite cela comme une décoration. M. DEL. —— Souhaiter une décoration ! C'est se dégrader. M. DESM. Nous ne devrions point parler de ces choses. Nous sommes si en dehors de toutes ces joies, de tous ces motifs d'agir ! M. DEL. — Si peu sociaux. M. DESM.— C'est le mot. Si peu sociaux, donc, que nous ne pouvons rien comprendre à tout cela. Alors nous parlons à côté, sans une véritable investigation psychologique. Nous dédaignons. Mauvais moyen de pénétration. M. DEL. — Cependant, nous sommes tout à fait désintéressés dans la question. M. DESM. — Nous le sommes trop. Etre ou n'être pas décoré, cela compte pour un journaliste, pour un membre des Gens de lettres. Etre ou n'être pas de l'Académie, cela a une importance énorme dans certaines salles à manger mondaines. Doumic, du jour au lendemain, passe du bas au haut bout. Pour nous, n'est-il pas toujours le même néant ? (1) M. DEL. — Assurément. M. DESM. — Choquée qu'il eût qualifié Baudelaire de « maniaque obscène », la maîtresse de maison maintenant approuve. Et même elle a fait acheter et relier en veau les œuvres malheureuses de l'humble secrétaire. La voilà qui compare Scribe à Ibsen et Doumic à Sainte-Beuve. Or, je ne pense pas que les circonstances présentes nous invitent à lire une ligne de ce régent bien pensant (2). M. DEL. — Avouez que l'Académie ne pouvait faire un autre choix, car enfin son concurrent... M. DESM. — Il aurait eu toutes mes préférences. Ce n'est pas un écrivain, c'est un philanthrope, et quand il serait un marchand de bois, je le préférerais à un Doumic. Le philanthrope n'a d'ailleurs eu qu'une voix de moins que le cuistre. Quelque nouveau venu aura voulu faire du zèle en faveur d'une illustre revue où il espère glisser de la copie. C'est d'autant plus fâcheux que cela contrarie un projet très cher à la majorité ducale de l'Académie française : ne plus nommer d'hommes de lettres. J'ai ouï dire qu'un académicien, auteur fort apprécié de la publication des mémoires de sa grand'mère, avait posé assez nettement la question : « Nous en avons assez de tous ces écrivailleurs, sans naissance, sans manières et sans fortune. L'Académie est un salon où il faut de la décence. Il y en a qui viennent à nos séances à pied. Passe encore, mais d'autres s'amènent en fiacre, oui, Monsieur, en fiacre à quinze sols ! (3) Vous voyez l'effet de ce véhicule de pauvre parmi les sévères automobiles de nos jeunes marquis et les nobles équipages de nos vieux ducs ! Plus d'hommes de lettres, plus de gueux : nous les remplaçons par des représentants de la grande industrie, de la philanthropie, des sports, par de riches historiens, par d'aristocratiques généraux, par de magnanimes auteurs dramatiques. On a dit que l'Académie française devait être un salon. Soyons modernes, comme disait ce pauvre et noble dévoyé, le comte de Villiers de l'Isle-Adam. L'Académie française doit être un club, le France-Club. » Hélas ! ce curieux projet vient d'aboutir à Aicard et à Doumic. M. DEL. — Savez-vous à quoi je pense, cher ami ? M. DESM. — Dites. M. DEL. — A ceci, que l'Académie nous intéresse bien plus que nous n'osons l'avouer. M. DESM. — C'est peut-être vrai. Sans quoi, ses choix nous laisseraient indifférents. M. DEL. — Nous souffrons de sa déchéance. M. DESM. — Par la mauvaise habitude d'associer l'idée d'Académie française à celui de littérature française. Il faudra nous en défaire. Il n'y a plus entre les deux idées que des rapports très vagues et qui s'effacent de jour en jour. M. DEL. — C'est peut-être dommage. M. DESM. — Je ne le crois pas. Il faut que les institutions meurent, afin que de nouveaux organismes puissent naître, mieux adaptés au milieu. L'Académie agonise, elle n'a plus d'autorité que celle que lui confère, en telle occasion, l'un ou l'autre de ses membres. Comme corps, elle n'est plus qu'une ombre. N'ayant pas su se transformer, elle mourra. Voyez, au contraire, l'Académie des Sciences : sa force grandit chaque jour. Elle domine les partis scientifiques. Une idée neuve, une observation, une découverte y trouvent assez facilement une tribune (4). Elle se préoccupe beaucoup moins de juger que d'écouter et de faire connaître au monde savant ce qu'elle a entendu. C'est, dans l'ordre de ses travaux, un merveilleux organe de transmission (5). Mais quels rapports y a-t-il entre l'Académie française et les écrivains français ? Ils ne la connaissent que par les intrigues des élections. Peut-être en recevront-ils quelque prix, d'un seul intérêt pécuniaire. C'est tout. Elle n'est aux hommes de lettres d'aucune utilité. Parfois, elle a pris l'air d'une parure. C'était encore quelque chose. Aujourd'hui, il y a des saisons où elle semble une injure. II vaudrait mieux qu'elle ne fût pas. M. DEL. — Cela manquerait à Paris. M. DBSM. — Oui, mais à Paris, seulement, et une telle institution, qui n'est plus que parisienne, est bien près de n'être plus. M. DEL. — Croyez-vous qu'elle ait encore du prestige à l'étranger ? M. DBSM. — Comptez les écrivains « européens » qu'elle contient, et vous serez renseigné. M. DEL. — Je le suis. p. 252-257. (1) Pour nous, n'est-il pas toujours le même cuistre ? (2) une ligne de ce bien pensant (3) en fiacre à quinze sous ! (4) Toute idée neuve, toute observation, toute découverte y trouve une tribune. (5) un merveilleux organe de transmission. Il n'est pas un jeune savant de quelque mérite qui n'ait « communiqué » à l'Académie des sciences ; aussi n'en est-il aucun qui ne la considère comme un organe bienfaisant et nécessaire.
1er mai [1909]. Le Gouvernement M. DESMAISONS. — Savez-vous ce qui est en péril, à cette heure ? C'est l'idée même de gouvernement, — et je m'en réjouis. M. DELARUE. — Anarchiste ! M. DESM. — Soit, mais vous l'êtes comme moi, et tout homme un peu intelligent d'aujourd'hui est pareillement anarchiste. Pouvez-vous lire sans rire des phrases sur l'urgence de restaurer le principe d'autorité ? M. DEL. — Une autorité très sage... M. DESM. — N'essayez pas de m'exciter par la contradiction. Je vous connais. M. DEL. — Mais si nous disons tous les deux la même chose, ce n'est point la peine de dialoguer. Et puis, il y a les nuances. Croyez-vous Vraiment, qu'un groupe de quarante millions d'humains puisse vivre en paix sans gouvernement ? M. DESM. — Sans un certain gouvernement, non. Il faut s'entendre d'abord sur le sens des mots. M. DEL. — Trouveriez-vous tyrannique le gouvernement présent ? M. DESM. — Non point tyrannique, mais tatillon. Il se mêle d'un tas de choses qui ne regardent point un gouvernement. Lisez le Journal officiel. Vous y verrez des décrets délibérés au Conseil d'Etat qui autorisent tel village à établir un octroi, telle compagnie de chemin de fer à acheter une locomotive. A quoi sert, à de certains jours, le ministère de l'Intérieur ? A permettre aux baigneurs de Dieppe ou de Dinard de jouer le bridge au Casino. Une ville veut-elle emprunter pour refaire son pavage ou établir des fontaines ? Il y faut une loi. Mais tout ceci, du moins, se passe au grand jour. Il y a ensuite la décision secrète qui promeut, promène ou arrête, au hasard des recommandations, le fonctionnaire, hier encore apeuré devant le minotaure central. Il y a tous les petits abus électoraux, les petites tracasseries, les petits privilèges. Mon cher, on n'imaginera jamais qu'un bon gouvernement, celui qui trouverait l'art de laisser les gens tranquilles. M. DEL. — Le meilleur gouvernement est celui qui ne gouverne pas. M. DESM. — Telle est la formule. Mais ainsi elle est négative. On la rendrait positive en ajoutant que le gouvernement a tout de même une fonction : il doit protéger la liberté absolue des individus et des groupements, veiller à la sécurité générale et assurer les travaux publics d'intérêt commun. Quoi ! Nous avons un gouvernement qui me défend de jouer au baccarat et qui permet que l'on m'assassine dans la rue ! C'est une dérision. Quoi ! Il prohibe le nu au théâtre et autorise des bandes de chauffeurs ! Car c'est les autoriser que de ne pas les anéantir à leur premier crime. M. DEL. — En somme, vous ne réprouvez que la violence, et vous vous en remettez au gendarme. M. DESM. —C'est à peu près cela, pour commencer. La civilisation, c'est d'abord la sécurité matérielle. Mais pourquoi ensuite ce gouvernement n'aurait-il pas l'ingéniosité d'assurer leur vie à tous ceux qui veulent travailler ? La charité est une grande honte. M. DEL. — Diable ! Cela va tourner au socialisme. M. DESM. — Voilà ce que c'est que d'entrer dans l'utopie, on ne sait jamais jusqu'où on ira, ni comment, on sortira du labyrinthe. Enfin, il est certain que l'idée de gouvernement perd de son prestige et que les hommes cherchent le moyen de se passer de leurs derniers maîtres, le dernier de tous fût-il la loi. Un syndicat est un organisme qui tend à se gouverner soi-même. M. DEL. — Que de conflits en perspective ! M.-DESM. — Moins peut-être que vous ne pensez. Que le syndicat des Postes se partage les bénéfices de l'exploitation et il a intérêt à la perfection du service. Que le syndicat des mines de charbon fonctionne dans les mêmes conditions et nous n'aurons pas à nous plaindre. M. DEL. — Vous voilà collectiviste, maintenant ? M. DESM. — Ne confondez pas le collectivisme, qui ne peut fonctionner que par une tyrannie centrale, avec le syndicalisme, qui est au contraire la décentralisation universelle. Qui sait si, un de ces jours, le gouvernement sera autre chose que le conseil général des syndicats ? M. DEL. — Je fais l'avertisseur, comme dans le Voyage à Laputa : vous versez encore une fois, cher ami, dans l'utopie. M. DESM. — Merci, mais que diriez-vous, si je n'avais pas quelques notions, même vagues et utopiques, sur les idées du jour ? M. DEL. — Oui, il faut bien s'intéresser un peu aux discussions du moment. Sans cela, on aurait vraiment trop la sensation de vivre dans ce Laputa d'où je reviens. M. DESM. — Il fait bon voyager avec Jonathan Swift. Rien n'est mieux fait pour guérir de la manie utopique. M. DEL. — Son désenchantement était tel que, las d'espérer inutilement dans les hommes, il avait imaginé une société d'honnêtes chevaux et de candides cavales. M. DESM. —Ah ! le beau livre, et qui nous mène jusqu'au bout du monde, jusqu'aux temps où les hommes, devenus singes comme les autres primates, leurs fils, il faut, pour réaliser une civilisation propre, en appeler à une autre espèce animale. M. DEL. — Vous approuvez ces vues nouvelles qui feraient des singes les descendants de l'homme, des hommes animalisés ? M. DESM. — Pas absolument. Pourtant, j'estime l'homme très antérieur aux autres primates. Si, comme je le crois, la nature, depuis les mammifères, marche vers la simplification, les quatre mains du singe sont évidemment postérieures aux quatre membres de l'homme, si nettement différenciés de l'avant à l'arrière. L'homme me semble si ancien, quand je parcours la galerie d'ostéologie, au Muséum, que je ne le place pas très loin du kangurou. Il n'y a guère que le kangurou et l'homme qui aient des bras si petits et des jambes si longues et si charnues. M. DEL. — Et la gerboise ? M. DESM. — La gerboise est notre cousine, cher ami. M. DEL. — Jolie famille ! M. DESM. — Cela vaut bien l'humanité, allez ! p. 257-262. 16 mai [1909]. Marines M. DELARUE. — Merveilleuse, cette marine française, qui n'a ni bateaux, ni hommes, ni canons, ni approvisionnement, ni arsenaux. Merveilleuse, en vérité. M. DESMAISONS. — Mais, cher ami, rien n'a jamais marché dans aucune marine, en aucun temps. M. DEL. — Vraiment ! M. DESM. — Pas même la flotte de Xerxès, qui fut sans doute la mieux organisée de toutes. M. DEL. — Il ne s'agit pas de ce satrape, mais de l'Angleterre, mais de l'Allemagne. M. DESM. — Ni l'Angleterre, ni l'Allemagne n'ont beaucoup plus de marine que nous... M. DEL. — Oh ! M. DESM. — Seulement ces pays, mieux avisés, se gardent bien de le dire. Ils ne chargent pas leurs messieurs Brousse et Bienaimé de faire des enquêtes scandaleuses. Ils gémissent en comité secret, construisent tout haut de monumentales carcasses, et gémissent encore, avec encore plus de secret. Quoi ! Ne savez vous pas que les « dreadnought » anglais et allemands sont ratés, ou à peu près, que la manœuvre de ces monstres est fort malaisée et qu'il leur faut des quarts d'heure pour passer de la marche en avant à la marche en arrière ? Et puis, tant d'hommes pour les manœuvres, tant de charbon et, en conséquence, tant d'argent pour les faire remuer qu'on hésite à s'en servir. Mais, et ceci va vous étonner encore plus, si la marine anglaise épargne les marins, c'est moins encore pour leur chèreté que pour leur rareté. L'Angleterre a des bateaux et de moins en moins d'hommes à mettre dessus. Pendant une récente croisière, l'escadre anglaise rentrait tous les soirs au mouillage parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes pour faire le quart, la nuit. On en est souvent réduit à embarquer des équipages entiers qui n'ont jamais vu la mer, et, l'autre jour, le « Boadicea » faisant ses essais, les deux tiers des hommes avaient le mal de mer ! M. DEL. — Vous m'étonnez ! M. DESM. — Cela n'empêche pas la marine anglaise d'être la première entre toutes ; mais si elle ne fonctionne que médiocrement, que voulez-vous demander aux autres ? Auriez-vous la moindre confiance dans les bateaux allemands ? M. DEL.— On en dit du bien. M. DESM. — Leurs équipages doivent être disciplinés, mais incompétents. Une brillante aristocratie les commande. C'est de la parade. D'ailleurs à quoi peut bien lui servir sa flotte, à l'Allemagne ? M. DEL. — A faire peur à l'Angleterre. M. DESM. — Vous plaisantez. Uniquement à donner à l'Angleterre le prétexte d'avoir l'air d'avoir peur, d'où des constructions continuelles qui, malgré les difficultés du recrutement, la maintiendront toujours bien au-dessus de sa rivale. La flotte allemande a servi jusqu'ici à justifier l'augmentation de la flotte anglaise et il ne paraît pas qu'elle puisse jamais servir à autre chose. On manque d'ailleurs de renseignements critiques sur ces bateaux. Ce que l'on sait, c'est que l'Allemagne, reconnaissant sa folie navale, demande à capituler et, pour la première fois, fait appel à la limitation des armements. M. DEL. — Les Anglais vont rire à leur tour. M. DESM. — Ils accepteront, et, au lieu de construire en Angleterre, ils construiront à Melbourne. On dit même que c'est commencé. M. DEL. — Vous ne croyez donc pas qu'il soit possible d'avoir une belle marine, bien en ordre ? M. DESM. — Non, parce que, dans la marine, tout est toujours à recommencer. J'avoue même que les nations en retard sur ce point ont des avantages. En faisant un grand effort, elles se mettent d'un coup au niveau des plus vieilles et même les surpassent, déchargées qu'elles sont d'un tas de vieux modèles que les marines anciennes n'osent pas détruire, et qui les encombrent, et qui les ruinent. Mais alors ce sont les équipages qui manquent, la tradition maritime. En somme, les marines de guerre sont, encore avant les armées, peut-être, le grand fléau de l'humanité. Que l'Allemagne, qui pourrait s'en passer, soit tombée dans cette vanité cruelle, ce n'est pas très bon signe. Ce délire de l'imitation indique une diminution de l'activité utile. M. DEL. — Ne craignez-vous pas que nous ne parlions de choses sur quoi nous ne sommes guère compétents ? M. DESM. — Il faut faire comme si nous l'étions. Pourquoi nous distinguer par une modestie exagérée ? J'entends tenir tête à M. Brousse, lui-même, que dis-je ? à toute la commission d'enquête. M. DEL. — Vous êtes bien belliqueux, aujourd'hui. M. DESM. — C'est peut-être le sujet qui veut cela. Vous connaissez les préceptes de l'éloquence ? M. DEL. — Mais je vous assure que je n'ai nul besoin d'être persuadé. Mon opinion en ces matières est vague et le restera toujours. J'aime à voir passer des bateaux, voilà tout. Et encore, d'après les anciennes estampes, j'eusse préféré les bateaux à voiles. Je voudrais une flotte esthétique. Ah ! ces grandes ailes ! Est-ce que l'homme n'est pas très bête, ayant trouve cela, de l'avoir méprisé ? M. DESM. — Mais la vitesse, cher ami, la vitesse ! Tout pour la vitesse ! Notre esthétique, à nous, c'est la vitesse. M. DEL. — A nous aussi ? M. DESM. — Oh ! non. Moi je suis le monsieur qui prend le train omnibus pour aller à Dijon, afin de mieux voir le paysage et, aux petites gares, les types indigènes. La vitesse ? C'est bon pour les gens qui n'ont rien à faire. Moi, j'ai à observer, à classer, à penser. Cela ne m'empêche pas d'admirer profondément les riches personnages qui, en de fulgurants automobiles et parmi les nobles et opaques nuages de poussière, sillonnent, tels de mystérieux météores, les routes de France et d'Europe. Ce sont, en leur genre, des héros, d'impassibles ascètes que ne troublent pas un instant la beauté de la nature ni l'odeur énamourée des forêts. Je les vois pareils à ce saint (un homme bien intelligent), qui avait fait vœu de ne boire que de l'huile et de coucher le nez dans la cendre. Vous voyez que je ne-méprise pas l'esthétique moderne. M. DEL. — Tout cela ne nous donne pas une conclusion sur la marine. M. DESM. — Ah ! Conclure ! Quelle faute de raisonnement ! Conclure ! Mais c'est se crever les yeux ! Non, il faut que les portes et nos yeux restent ouverts. Il faut que la lumière y puisse entrer toujours. M. DEL. — Très bien. Mais ne souhaitez-vous pas que la France ait une belle marine ? M. DESM. — Bien en ordre ? M. DEL. — Oui. M. DESM. — A voiles ? M. DEL. — Adieu ! p. 262-268. 1er juin [1909]. Grèves M. DESMAISONS. — Ah ! cher ami, vous me voyez bien ennuyé. La grève... M. DELARUE. — Quoi ! Cela vous émeut tant que cela ? M. DESM. — On était si tranquille... M. DEL. — Que voulez-vous ? Il faut s'habituer à un peu d'incertitude. M. DESM. — Et voilà que cela recommence ! M. DEL. — Croyez-vous ? M. DESM. — Tenez, ce paquet de lettres... M. DEL. — Eh bien ! mais... M. DESM. — Zut ! Je fais grève à mon tour.. M. DEL. — Que voulez-vous dire ? M. DESM. — Qu'il était doux d'avoir un prétexte pour ne plus écrire de lettres ! M. DEL. — Ah ! Je ne comprenais pas. Tout à fait de votre avis, cher ami. Nous écrivons trop. Cela est devenu une manie. M. DESM. — A en juger par ce que nous recevons, jaugez la boîte d'un facteur ! M. DEL. — Non merci. Les conversations surprises en omnibus me suffisent. Et dire qu'il y a des statisticiens qui voudraient hiérarchiser les peuples selon le nombre de lettres qu'ils écrivent ! M. DESM. — Pourquoi pas selon le nombre de paroles échangées ? Mais la lettre est un bavardage plus grave ; c'est un bavardage conscient et prémédité. M. DEL. — Pas chez les femmes. Elles écrivent comme jase le pinson. M. DES. — C'est quelquefois agréable. M. DEL. — Oui, quand on aime la dame. Les chères petites pattes de mouche ! Pourquoi pattes de mouche ? Elles écrivent toutes comme des notaires royaux. C'est propre, bien aligné et cela va, cela va. M. DESM. — Vous êtes bien content d'en recevoir. M. DEL. — De quoi ? M. DESM. — De cette écriture alignée et brodée. M. DEL. — Heu ! Heu ! M. DESM. — Allons, ne boudez pas contre vos plaisirs. Rien de plus vilain. M. DEL. — On se blase. M. DESM. — Jamais là-dessus. M. DEL. — C’est si menteur. M. DESM. — Le mensonge est un hommage, toujours, et quelquefois un aveu. M. DEL. — Vous avez des idées ! M. DESM. — Que penseriez-vous de votre amie… M. DEL. — Ici, amie veut dire maîtresse ? M. DESM. — Naturellement. Au contact des femmes, tout mot sentimental devient sexuel. M. DEL. — Alors ? M. DESM. — Je reprends : Que penseriez-vous de votre amie si elle vous disait franchement qu'elle vous aime, non pas en proportion, non, restons dans la psychologie honorable, mais en raison des petits cadeaux dont vous êtes prodigue ? M. DEL. — Diable ! M. DESM. — Mais enfin ! M. DEL. — Ce que je penserais ? M. DESM. — Oui. M. DEL. — Rien. M. DESM. — Comment rien ? M. DEL. — Je prendrais mon chapeau et je ferais un grand salut. M. DESM. — C'est cela même. Aussi vous dit-elle, sans conditions : « Je vous aime beaucoup ami. » M. DEL. — Oui, ou à peu près. M. DESM. — Et vous êtes content ? M. DEL. — Oui, à peu près ; content, quoique sans illusions, que momentanées... M. DESM. — Ah ! momentanées, cela suffit. Le moment rayonne, Ses ondes rejoignent les ondes du moment suivant. M. DEL. — Vous êtes bien socratique, aujourd'hui. Voyons, concluez. M. DESM.. — Je conclus que vous n’avez aucun moyen de savoir si votre amie est sincère… M. DEL. — Il n'y a pas que les paroles. M. DESM. — Sans doute, sans doute. Croyez bien, mon cher Delarue... Notez aussi que je pense à moi comme à vous, à tous. Je vous prends comme une abstraction, une figure (Fig.I)… Donc la sincérité est ou n'est pas, nous n'en savons rien. Notez encore que, pour moi, je crois à la sincérité, parce que le mensonge continuel est une acrobatie, un jeu de cirque, un travail de clown savant dont peu de femmes sont capables. M. DEL. — Heureusement. M. DESM. — Comme vous le dites, heureusement. Mais je me place au point de vue scientifique, si j'ose. Le sentiment est inconnaissable. Vous pouvez sentir que vous êtes aimé, vous ne pouvez le savoir. Or, et nous revoici à la question, par les paroles délicates qu'elle profère votre amie suppose qu'il y a chez vous un sentiment pareil à celui qu'elle avoue. Elle reconnaît votre tendresse et elle y répond : c'est l'hommage. En second lieu, il peut arriver que, hantée par l'amour qu'elle sent chez vous, elle le ressente à son tour, par contagion: alors c'est l'aveu. M. DEL. — L'aveu de quoi, si elle ment ? M. DESM. — L'aveu qu'elle est sous votre domination. M. DEL. — Oui... mais ce n'est pas très clair. M. DESM. — J'aurais voulu prendre un exemple plus facile, plus vulgaire aussi, mais il vous eût choqué. M. DEL. — Du tout. M. DESM. — Eh bien, supposez qu'elle vienne de vous tromper. M. DEL. — Hein ? M. DESM. — Si elle vous le laisse entendre, c'est qu'elle se moque de vous... M. DEL. — Hein ? M. DESM. — Si elle vous conte une histoire... M. DEL. — Hein ? M. DESM. — C'est qu'elle ne veut pas vous faire de peine. M. DEL. — Quelle bonté ! M. DESM. — J'appelle cela un hommage. M. DEL. — Merci. M. DESM. — Et si elle vous embrasse plus doucement, qui sait ? ce sera peut-être l'aveu. M. DEL. — De sa faute ? M. DESM. — De son amour. C'est quelquefois après une telle fugue qu'une femme se met à adorer son mari ou son amant. M. DEL. — Et vous prétendez n'admettre presque toujours que la sincérité ! M. DESM. — Je ne me suis pas contredit. Le jeu de simuler un sentiment est très difficile et très rare. Cela ne se voit guère qu'au théâtre, ce pays du factice. Mais le mensonge n'est pas une simulation ; le mensonge est presque toujours aussi sincère que la sincérité. Mentir, la plupart du temps, c'est obéir à un état d'esprit inconscient. M. DEL. — Monsieur Desmaisons, vous sapez les bases de la morale. M. DESM. — La morale, quel meilleur volant pour jouer à la raquette ? Monsieur Delarue, une autre fois vous serez un partenaire plus galant ! M. DEL. — Aujourd'hui... M. DESM. — La poste vous a laissé sans nouvelles de… M. DEL. — Tenez, je vous laisse. Adieu. M. DESM. — Adieu, victime de la grève. p. 268-274. 16 juin [1909]. Les Cousins de Jésus-Christ M. DELARUE. — Est-ce que vous prenez cela au sérieux, vous, le sionisme ? M. DESMAISONS. — Hélas ! j'ai bien peur que cela ne réussisse pas. Pourtant, ce serait beau. La reconstruction du royaume de Jérusalem, quelque Salomon peut-être, le Temple... M. DEL. — Le Veau d'or. M. DESM. — Seriez-vous antisémite, cher ami ? M. BEL. — Non, c'est démodé, et puis c'est inutile... M. DESM. — C'est peut-être parce que c'est inutile que c'est démodé ? M. DEL. — En effet, l'antisémitisme n'a guère d'autre résultat que de révéler, à nous et aux Juifs eux-mêmes, leur puissance. Mais si le sionisme était sérieux, j'aimerais à être sioniste. M. DESM. — C'est une idée à propager. Si les Juifs, par hasard, avaient la nostalgie de la terre de Chanaan, il serait malséant de les décourager d'un si noble sentiment. M. DEL. — Oh ! très malséant. Puissent-ils retrouver enfin une patrie, sous la protection de Jéhovah et de son tonnerre ! Le souvenir de Jésus-Christ ne les gênera pas ? M. DESM. — Non, il était de la famille, quoiqu'il n'ait probablement jamais existé, et sa pendaison ne fut qu'un épisode comme les Juifs devaient en connaître tant d'autres. Je vous dirai même qu'ils en sont fiers. M. DEL. — Comment cela ? M. DESM. — N'est-ce rien pour ce petit peuple que d'avoir donné un dieu au monde, à la moitié de la terre ? Quelle réclame ! La force des Juifs vient de là. Les Chrétiens eux-mêmes sont forcés de reconnaître qu'ils furent le peuple élu de Dieu, que Dieu se voulut pour premier temple terrestre une matrice juive, pour première outre, des mamelles juives. Les croyez-vous assez bêtes pour renier tout cela ? M. DEL. — Pourtant, ils en ont l'air. M. DESM. — Ils n'en ont que l'air. Et le saint Paul, pensez-vous qu'ils n'en aient pas également quelque fierté ? M. DEL. — C'est déjà moins compromettant, et moins mythique. M. DESM. — Leur opposition au catholicisme n'est que de la jalousie. Ils en veulent à l'Eglise de donner au nouveau Testament, empreint d'hellénisme, le pas sur l'ancien, d'une juiverie plus pure. Mais ils ne détestent pas le Nazaréen, et la preuve c'est la tendresse réciproque qui règne entre eux et les protestants. La Bible est leur commun biberon et ils sucent alternativement, avec une joie égale, l'antique tétine de Sara. Le protestantisme n'est qu'un judaïsme modernisé. Au fond, tous cousins de Jésus-Christ, les uns par la foi, les autres par le sang. M. DEL. — Tout cela est très bien, mais ne fait pas beaucoup avancer la question du sionisme. M. DESM. — Malheureusement. M. DEL. — Malheureusement. M. DESM. — Nous sommes unanimes. M. DEL. — S'il suffisait d'une bonne petite souscription ? M. DESM. — Oui, j'apporterais volontiers mon obole à cette pieuse et patriotique entreprise. M. DEL. — Nous ne sommes pourtant pas antisémites. M. DESM. — Au contraire, puisque nous sommes disposés à contribuer à la grandeur et au bonheur d'Israël régénéré. M. DEL. — Vous n'avez aucune arrière-pensée ? M. DESM. — Aucune. M. DEL. — Ni moi non plus. M. DESM. — Très bien. M. DEL. — Mais s'en iraient-ils tous ? M. DESM. — Y pensez-vous ? Ne voudriez-vous pas retenir les Juifs de science, d'art, de lettres ? M. DEL. — Sans doute, mais ils illustreraient leur patrie retrouvée, lui donneraient notre langue, notre goût. Cela simplifierait... M:, DESM. — Bien, mais si on nous enlevait les autres, peut-être les regretterions-nous aussi. M. DEL. — Comme sujet de conversation ? M:, DESM. — D'abord. M. DEL. — Oh ! nous en parlons bien rarement. M. DESM. — Nous ne sommes pas seuls au monde, cher ami, et je puis vous assurer qu'il est peu de familles, peu de cercles, peu de groupes où l'on ne conte, une fois au moins par jour, quelque bonne histoire juive. M. DEL. — Il est de fait que, depuis quelques années, ils prêtent à la causerie avec une certaine abondance. M. DESM. — Ils multiplient les feux d'artifice. La marine, l'armée en sont tout illuminées. M. DEL. — Dites éblouies. M. DESM. — Et pendant qu'on cligne les yeux... M. DEL. — Mais ils sont bien maladroits. M. DESM. — Croyez-vous ? Pour un que l'on prend... M. DEL. — Peut-être allez-vous trop loin. M. DESM. — Mettons qu'ils n'ont pas de chance. M. DEL. — C'est cela. M. DESM. — Pauvres gens sur lesquels une fatalité s'acharne ! M. DEL. — Parfait. M. DESM. — Ils font des bêtises, mais bien plutôt par ignorance de nos mœurs que par méchanceté. M. DEL. — Ils ne sont pas encore tous très bien acclimatés. M. DESM. — Non. Ainsi, tenez, parmi les nombreux Juifs qui collaborèrent à la loi de séparation, il y en avait un pour qui la sacristie, dans les églises, c'était le maître autel. M. DEL. — Ah ! pièges de l'étymologie ! M. DESM. — Mais si nous avions à inventorier une synagogue, nous ferions peut-être de pires bévues. M. DEL. — Seulement, nous ne nous mêlons pas d'inventorier ou de réglementer les synagogues. M. DESM. — Cela m'amuserait peu. J'aime mieux relire Rabelais... M. DEL. — Ou Voltaire... M. DESM. — Ou Renan... M. DEL. — Renan, non, cela sent trop la vieille église bretonne. M. DESM. — Ah ! que les religions sont laides ! M. DEL. — Et sottes. M. DESM. — Et qu'elles nous inspirent mal ! M. DEL. — Oui, nous avons dit bien des bêtises. M. DESM. — Car les Juifs, au fond, nous indiffèrent. M. DEL. — Complètement. M. DESM. — Et nous ne demandons qu'à oublier qu'ils sont juifs. M. DEL. — A condition qu'ils commencent par l'oublier eux-mêmes. M. DESM. — Vous avez raison. Ils se souviennent trop qu'ils sont une race. M. DEL. — Et ils se comportent trop comme une secte. M. DESM. — Comme une famille. M. DEL. — Ah ! que les anciens Japonais avaient raison qui, avant de commercer avec les Européens, leur faisaient piétiner la croix. M. DESM. — Oui, c'est un beau symbole. Celui-là n'est pas un être social, qui ne sait pas s'élever au-dessus de la famille, au-dessus de la secte, au-dessus de la race, et il sera toujours un danger pour la communauté où il exerce quelque fonction. Ce qui me répugne le plus dans Napoléon, c'est son népotisme. M. DEL. — La promiscuité primitive... M. DESM. — Les Juifs ont beaucoup de mal à en sortir. Donnez une direction à un Juif, l'année suivante tous les employés seront juifs. M. DEL. — La religion a les mêmes effets que la race. Mettez un catholique à la tête d'une maison, il en aura bientôt fait une capucinière ; ou un bon calviniste, et l'esprit de Dieu soufflera à travers les murs. M. DESM. — C'est la morale de la secte, une morale que Paul Adam a oubliée dans sa collection de morales. p. 274-281. 1er juillet [1909]. Le Magistrat M. DESMAISONS. — C'est vrai, ce qu'on dit de l'attitude du président Pujet ? M. DELARUE. — Elle étonne. M. DESM.— Mais vous, qu'en pensez-vous ? M. DEL. — Qu'elle est inintelligente. M. DESM. — Alors elle ne vous étonne pas ? M. DSL. — Elle me rassure. M. DESM. — Hein ? M. DEL. — Oui, elle me prouve que la France va son train et que nous sommes bien toujours au pays où les hommes se fabriquent d'avance une opinion dont rien ne les fera démordre. Ce président rentre dans la moyenne. Il y a l'avocat. Il est le contre-avocat. M. DESM. — Et vous croyez que c'est là le rôle d'un magistrat ? M. DEL. — Oh ! si nous entrons, comme disait le théologien de Kœnigsberg, dans la catégorie de l'idéal ! M. DESM. — Mais l'impartialité n'est pas située dans la région des chimères. C'est une qualité pratique. C'est quelque chose comme de la propreté morale. M. DEL. — Donc un luxe, cher ami, donc catégorie de l'idéal. Et puis cela prend du temps. Et puis il faut réfléchir, ce qui fait mal à la tête. Et puis, dans la vie, quand on n'apporte pas des opinions nettes, tranchées, on fait figure d'imbécile. M. DESM. — Mais vous disiez tout à l'heure que le public s'étonne ? M. DEL. — Oui, le public a un idéal. Pas moi. Je regarde, j'écoute, je classe et je ne dis oui ou non qu'après de sérieuses confrontations entre tous les petits faits que j'ai recueillis. M. DESM. — Mais vous seriez le magistrat idéal ! M. DEL. — Idéal, encore ? M. DESM. — Je le retire, je ne suis pas plus métaphysicien que vous. Mettons parfait ; mettons même tout bonnement : excellent. M. DEL. — Du tout, car, la plupart du temps, je ne saurais conclure. M. DESM. — Oui, voilà le malheur des magistrats, c'est qu'ils doivent conclure. M. DEL. — C'est cela, et alors, pour aller plus vite, il y en a qui concluent d'abord. M. DESM. — J'avoue que si je devais conclure, comme eux, à chaque fois, j'éprouverais une sorte de désespoir. Conclure ! Mais on ne sait presque jamais rien. Vous souvenez-vous de cette femme qui, pour échapper aux obsessions de la justice, finit par avouer un crime imaginaire ? M. DEL — Quel triomphe ! M. DESM. — Je crois que cet état d'esprit, assez général en France, comme vous le disiez bien, a été créé, ou du moins entretenu, par ce féroce enseignement de la vérité auquel on soumet les enfants. On ne leur apprend pas à observer, on leur apprend à démontrer. Pas de dispute littéraire ou géométrique qui ne doive aboutir à une preuve. Et on leur cache soigneusement l'au-delà de la preuve, ce champ où la dispute recommence. On les borne à un affreux deux et deux font quatre, au moyen de quoi leur esprit s'habitue à l'affirmation perpétuelle. Il portera cette méthode dans tous les ordres, même dans ceux où on ne manipule que des doutes, des hypothèses ou des conjectures. M. DEL. — Ce qui surprend tout de même un peu, dans le cas de M. Pujet, c'est que, n'ayant pas besoin d'opinion, il en ait tout de même acheté une au bazar de la Vérité. Qu'a-t-il à faire, président d'assises ? Poser des questions, écouter les réponses, donner successivement la parole à l'accusation et à la défense, protéger la liberté du témoignage, recevoir la déclaration des jurés, la traduire en langage pénal. En tout cela, aucune responsabilité. Nous parlions d'impartialité, il n'est même pas le chef d'orchestre, il est le mécanicien qui a fait tout son devoir, quand il a obéi aux règlements, déplacé à temps les leviers, tourné, en temps utile, les robinets. Que le train contienne des danseuses ou des rosières, des bandits ou des philanthropes, va-t-il s'en soucier ? M. DESM. — Ne vous y fiez pas. M. DEL. — Oui, peut-être, parce qu'on lui a intercalé un idéal entre les lobes du cerveau. Mais avouez au moins que son opinion ne doit pas troubler l'exercice de son métier. M. DESM. — Sans doute, mais écartons les métaphores et les comparaisons. Autrement, il est difficile de s'entendre. Eh bien, je ne pense pas qu'on puisse demander à l'un de nous un tel désintéressement. A prix égal, le cocher aimera toujours mieux trimballer une belle madame qu'une cuisinière. M. DEL. — Et les métaphores ? Et les comparaisons ? M. DESM. — Diable ! M. DEL. — Tirez au moins de votre faute un bénéfice. M. DESM. — Lequel ? M. DEL. — Cela peut vous servir à démontrer qu'on revient toujours à sa nature, à la tournure de son esprit, et qu'un juge, juge toujours, même quand il ne doit pas juger. M. DESM. — Et les plus graves discussions finissent toujours par des calembours. M. DEL. — Je n'y pensais pas. M. DESM. — Ce sont les meilleurs. L'équivoque fait aussi d'excellents raisonnements et le quiproquo a infiniment d'esprit. A Versailles, un seigneur, cocu notoire et impavide, cause, adossé à la cheminée; sa perruque prend feu aux bougies, il la retire, l'éteint, la remet ; le roi entre, hume l'air, dit innocemment : cela sent la corne brûlée. Voilà l'esprit de la vie. M. DEL. — A moins que ce ne soit celui de Chamfort. M. DESM. — Je suis surpris qu'au procès Renard ou n'ait pas fait quelque sinistre plaisanterie sur le couteau à dessert. M. DEL. -— En effet, j'aurais conseillé un couteau à découper. M. DESM. — La voilà, M. DEL. — Aimeriez-vous savoir la vraie vérité sur cette histoire ? M. DESM. — A quoi bon ? Nous ne rendons pas la justice et nous faisons de la psychologie et non de la criminalité. M. DEL. — Précisément, pour la psychologie. M. DESM. — Qu'en pourrions-nous tirer ? M. DEL. — Supposons-le coupable, et voilà que les accents du mensonge égalent ceux de la vérité. M. DESM. — Ou les surpassent. Point très rare. Le coupable a, autant que l'innocent, besoin et désir de se défendre et de vivre. L'un et l'autre doivent convaincre et pour cela employer les mêmes moyens. M. DEL. — Au point de vue sentimental... M. DESM. — Il me serait fort désagréable qu'un innocent fût condamné. Et puis, n'étant pas tout à fait anarchiste, j'ai un intérêt social à ce que la justice s'épargne l'erreur. Elle est par la suite forcée de réhabiliter, et rien ne la déconsidère davantage. M. DEL. — Vous protégez cette institution ? M. DESM. — Provisoirement. Il faut quelque chose dans ce genre, et tant qu'on n'aura pas rétabli le sort des dés… M. DEL. — Rétabli ? M. DESM. — Mais oui, Rabelais, souvenez-vous. C'est dans Rabelais que j'ai appris l'histoire de la justice. M. DEL. — Ce n'est pas cela que je voulais dire. Croyez-vous qu'on l'ait jamais aboli, le sort des dès ? p. 281-287. M. DESMAISONS. — Je pense que cela vous intéresse, ces entrevues diplomatiques ? M. DELARUE. — Enormément. Je ne rate pas la lecture, ni la méditation d'un menu. Nous n'avons plus de marine, soit, mais nous ayons une cuisine. M. DESM. — On ne peut pas tout avoir. M. DEL. — Cependant, vous le dirai-je, il m'a semblé que la cuisine elle-même... M. DESM. — Pas possible ! M. DEL. — J'ai relevé dans les derniers menus un rien de vulgarité. M. DESM. — Vraiment ? M. DEL. — Oui, une tendance aux nourritures banales, sans accent. M. DESM. — Ne trouvez-vous point que ce sont les meilleures ? Un morceau de bœuf jeté sur les charbons ? M. DEL. — Barbare ! Non, nous n'en sommes pas encore là ; non, on ne sert pas encore aux têtes couronnées le chateaubriand aux pommes (tout ce qui reste de René), mais la tendance est naturaliste, il n'y a pas à se le dissimuler, et le vocabulaire, tout au moins, manque d'éclat. M. DESM. — Savez-vous qu'on pourrait prendre vos remarques au sérieux et voir dans ce que vous critiquez un retour à la simplicité et à la franchise ? M. DEL. — Peut-être. C'est un point de vue. Il est certain que, sous les noms les plus singuliers des grands menus, il ne se cache souvent qu'un mets bien ordinaire, mais le prestige du mystère en relevait, pour, les imaginations, la saveur. J'ai dîné une fois avec un menu dont tous les mots posaient un problème philologique. Ces lignes inégales semblaient un poème de M. de Souza ou de M. René Ghil. C'était plaisant, à l'esprit. M. DESM. — Et au goût ? M. DEL. — Beaucoup moins. Mais on avait, avant d'arriver au port, un peu bourbeux, navigué en plein rêve. M. DESM. — C'est cela, il se passe en cuisine le même phénomène qu’en amour. On a commencé par donner aux choses leur nom. puis on les a dissimulées sous des noms mystérieux, et remplacées à mesure que ceux-ci devenaient connus de tout le monde. Et savez-vous pourquoi ? Pour en pouvoir parler à l'aise. De sorte que ce phénomène, qui semble de pudeur, est au contraire un signe d'impudicité. Appelez les tripes des timbales caennaises et vous pouvez en servir dans le monde. Il y a cent et une périphrases pour dire à une femme : J'ai envie de coucher avec vous. Mais il est possible qu'après le détour on se rapprocha enfin de la nature, qu'on appelle tripes des tripes et qu'on demande à une femme, sans qu'elle en soit choquée : Quand couchons-nous ensemble ? Car un fait est un fait et on pourrait encore poser la question sous des formes moins honnêtes. M. DEL. — Et que faites-vous de la civilisation ? Sans mensonge, pas de civilisation. M. DESM. — Dites que la nôtre a pour base le mensonge, mais qu'on en pourrait peut-être bâtir une autre sur la franchise. M. DEL. — J'en doute. M. DESM. — Et vous avez probablement raison. Pourtant... M. DEL. — Il y a tout de même, j'en conviens, trop peu de franchise dans nos relations, surtout dans nos relations sexuelles. Vous avez assisté à ce supplice de Tantale qu'on appelle un bal ? Au bout d'une heure les couples se sont virtuellement formés, ils se sont élus, et l’unique désir des éléments qui le composent, est de se coupler réellement. Et après les frôlements, les appels de l'œil, les caresses de la parole, hommes et femmes rentrent séparés ou associés contre leur gré : de quoi résultent les phénomènes les plus immoraux, si on appelle immoral les actes qui ne se réalisent pas selon le mécanisme naturel. M. DESM. — Quel charabia ! Et encore vous n'insinuez que la moitié de ce que vous voudriez dire. M. DEL. — Que voulez-vous, je suis trop civilisé. M. DESM. — Je ne vous demande pas d'éclaircissement ; d'ailleurs je crois que vous exagérez. M. DEL. — On exagère toujours, en ces matières, parce qu'on juge d'après ses propres sensations. Me voudriez-vous hypocrite avec moi-même ? M. DESM. — Vous l'êtes un peu, car en ces bals, ce n'est pas une femme que vous désiriez, mais trois ou quatre, mais cinq, mais dix. M. DEL. — Je me serais contenté d'une. M. DESM. — Mais celle que vous auriez prise n'était pas celle qui, peut-être, vous aurait choisi. M. DEL. — Les femmes choisissent toujours celui qui les a prises. M. DESM. — Non, tenez, vous êtes trop le vainqueur qui inspecte les femmes de la cité conquise. M. DEL. — Cela améliorerait beaucoup la vie, ne trouvez-vous pas, si on pouvait, à tout moment, choisir entre toutes les femmes ? M. DESM. — Mais on le peut. Si vous entendez que toutes les femmes devraient se laisser passivement choisir ?... M. DEL. — Oui, ce serait... M. DESM. — Evidemment. Restons plutôt comme nous sommes. Les femmes ont, elles aussi, conquis la liberté, qu'elles en usent à leur gré. La plupart, il est vrai, ne désirent nullement en user, mais c'est leur affaire, et nous n'y pouvons rien. Et puis, mon cher ami, songez aussi que cela serait bien fastidieux de pouvoir réaliser à coup sûr chacun de nos désirs. Les plus belles aventures, et sans cela elles n'en seraient pas, ne sont-elles point celles où nous connûmes le plus de déboires, le plus de chagrins, le plus de supplices ? C'est bien élémentaire de ne placer le bonheur que dans la jouissance répétée et toujours satisfaite. Il y a toutes sortes d'autres bonheurs, et la souffrance peut devenir une volupté. M. DEL. — Prenez garde de tomber dans la phraséologie chrétienne. M. DESM. — Non. Je n'y tomberai point. Je veux seulement dire que les limites sont incertaines entre la douleur et le plaisir, et que le plaisir pense devenir de l'ennui, et l'ennui une sorte de douleur molle, écœurante et plus pénible que les maux aigus. Je dis encore qu'il n'est pas très mauvais que ces choses aient des noms vagues, comme les nourritures élémentaires de vos menus distingués. Notre système nerveux est trop compliqué pour que les sensations qu'il nous donne soient parfaitement stables. Avouez que la possession de telle femme que vous avez souhaitée et que vous n'avez pas eue vous aurait bien embarrassé. M. DEL. — Peut-être. Elle eût attendu de moi le bonheur et je n'aurais pu lui donner que de la volupté. M. DESM. — Et son regard eût gâté la vôtre. M. DEL. — Oui, quelquefois Je suis assez bête pour cela. Mais elles aussi sont hôtes de toujours croire que les merveilles vont se réaliser. M. DESM. — C'est l'histoire des menus menteurs que vous défendez. Ayez de la logique. M. DEL. — Oh ! cela non. Tout ce que vous voudrez, mais pas de logique forcée. Je veux que la logique m'appartienne aussi et j'en veux faire, comme du reste, mon plaisir. p. 287-293. p. 293-299. M. DESMAISONS. — Ah ! vous voilà revenu aussi. M. DELARUE. — Me voilà revenu. M. DESM. — Et qu'avez-vous fait ? M. DEL. — Rien, j'ai regardé les choses, les hommes aussi, mais surtout les choses. Et vous ? M. DESM. — Oh ! moi, vous savez, je ne cherche, par l'absence, que la solitude, la vraie solitude, celle de l'inconnu dans la foule, celle de l'homme sans nom, sans adresse, sans qualité sociale. La certitude que, pendant quelques jours, rien ne pourra vous atteindre qui vienne vous distraire de vous-même ! M. DEL. — Si l'on n'est plus quelqu'un, on est encore quelque chose, on est le voyageur, l'étranger, le monsieur qui... et qui... J'aime aussi la solitude en voyage, mais elle ne me serait rien, si je n'avais d'abord les plaisirs de l'œil. Je suis l'amateur de paysages, et j'ai d'ailleurs reconnu qu'un compagnon, parfois, nous aide à les mieux sentir, par le contraste ou l'accord de sa sensation avec la vôtre. M. DESM. — J'aime à regarder aussi, et un compagnon, vous le savez, ne m'offusque pas toujours, mais il me prend tout de même un peu de ma solitude. Enfin, il faut, selon les heures, des sensations diverses. M. DEL. — Je ne saurais trop analyser mon goût des paysages. A quoi cela répond-il ? M. DESM. — Je vous le demanderais. Des maisons le long d'un fleuve qui se prolonge dans une plaine, des collines modérées, un horizon qu'un peu de brume rend plus lointains, et l'on regarde, et l'on est heureux. D'ailleurs, ou regarde aussi la mer, le désert, la montagne. Nous aimons également le paysage naturel et le paysage factice. M. DEL. — Et c'est cela précisément qui rend si difficile l'analyse de ce sentiment. Cependant, un voyage n'est-il pas d'autant plus émouvant qu'il est plus inattendu, plus nouveau ? M. DESM. — Pas toujours. Il y a au contraire des paysages attendus, connus depuis des années, et qui nous émeuvent toujours autant. M. DEL. — Je le veux bien, encore faut-il que nous ne les ayons pas toujours sous les yeux. M. DESM. — C'est-à-dire que, même dans ce cas, le paysage n'est pas toujours le même, puisqu'il est sous la dépendance du soleil, des nuages, de la brume, des saisons qui le diversifient sans cesse. En somme, on voit bien rarement deux fois les mêmes paysages, quoique les parties essentielles, les lignes générales demeurent invariables. Donc, vous avez peut-être raison, et le goût des paysages serait le goût des aspects nouveaux de la nature. M. DEL. — Cela devient un peu moins obscur. Le goût des paysages se catégoriserait alors dans l'amour du changement, le besoin d'horizons nouveaux, d'émotions nouvelles, dans la curiosité enfin, et tout bonnement. M. DESM. — Tout bonnement, je le crois. M. DEL. — Cela rentre bien dans ma psychologie. Mais je ne suis pas un éperdu, un désordonné, et il me faut très longtemps pour épuiser les charmes d'un paysage. Je tiens qu'il en est d'un paysage comme d'une femme ; quand l'objet est d'une belle qualité, le charme en est durable et plus on vit avec lui plus on lui trouve d'attraits. M. DESM. — Hé ! Il ne faut pas abuser de la familiarité. Elle vient à bout de tout, elle use les charmes les plus adamantins. M. DEL. — Sans doute. Il faut que l'impression de nouveau se perpétue ou se recrée sans cesse. Cela arrive. Peut-être que dans ce cas la renouvellement se fait en nous-mêmes, plutôt que dans l'objet. M. DESM. — N'en doutez pas. D'ailleurs, c'est de la philosophie élémentaire. Les paysages sont en nous-mêmes et non point dans l'étendue, quoique l'étendue soit nécessaire. Et il en est de même en amour. La femme que nous aimons est en nous, et pourtant il faut également qu'elle existe hors de nous, pour que l'amour soit autre chose qu'une hallucination. Mais sans un peu d'hallucination, il n'y a plus ni femmes, ni paysages. Tout cela est contenu dans la définition de Spinoza : « L'amour est un sentiment de joie accompagné de l'idée de sa cause extérieure. » M. DEL. — Nous avons peut-être trouvé la cause de l'amour des paysages, mais avons-nous bien saisi sa nature ? M. DESM. — Non, sans doute, mais comment dissocier les sentiments, puisque précisément leur nature échappe aux prises du raisonnement ? On peut les classer par nuances, voilà tout. On sait bien que l'amour sexuel, par exemple, est simple ou qu'il peut s'exercer sans tout l'appareil de sentiments adventices dont nous l'entourons généralement ; mais, ainsi dépouillé, il n'est plus qu'un fait, primordial sans doute, mais tellement simple qu'il en est décourageant. Autant méditer sur la pesanteur. Les idées sont complexes, les sentiments sont simples. M. DEL — Je ne crois pas à la simplicité des sentiments. Au contraire. M. DESM. — Réfléchissez. En analysant une idée, en dissociant les éléments dont elle se compose, vous trouvez toujours un mélange d'idées souvent disparates cimenté par un amalgame de sentiments personnels, passagers. Aussi les idées se désagrègent-elles très vite. Celles du siècle passé ne sont plus, très souvent, qu'un informe chaos où nous ne voyons plus rien de saisissable. Le sentiment, au contraire, quelle que soit sa complexité apparente, se résout toujours en un fait unique et simple quand on le presse pour en faire sortir tout ce qui ne lui est pas essentiel. Rien de plus compliqué, dans nos sociétés compliquées, qu'un sentiment amoureux. Il est fait de mille petites choses qui vont de la qualité de la peau, de l'odeur, du sourire, à la qualité de la robe, des bottines, des gants ; un homme aime dans la femme à la fois l'être naturel et l'être social. Mais analysez et vous verrez que tout se réduit, à la fin, en un désir de possession physique. L'amour, quelle que soit son apparence, est un fait physique. Si vous ôtez ce fait physique, il n'y a plus rien, et c'est ce qui rend si bêtes, si inutiles, si mensongers tous ces romans, tous ces traités, toutes ces psychologie où l'amour physique n'est point nettement indiqué comme le centre et le but de tout. Ou bien il s'agit entre deux êtres d'une union physique, au moins possible, ou bien il n'y a pas d'amour. Le sentiment, en son essence, est simple. M. DEL. — Pour l'amour, je veux bien, mais pour le goût des paysages ? M. DESM. — Je ne trouve rien à ajouter à ce que nous avons dit. M. DEL. — Nous en restons à la curiosité ? M. DESM. — Un curiosité très particulière, oui, je crois que c'est le plus prudent. M. DEL. — Ah ! que ne sommes-nous romantiques ! Nous aurions dit de bien belles choses ! M. DESM. — J'en ai peur. p. 299-305. M. DELARUE. — Et vous n'avez pas été indigné ? M. DESMAISONS. — J'ai été indigné. D'ailleurs, en cette histoire, il n'y a que M. Arthur Meyer et M. Emile Faguet qui aient manifesté une certaine allégresse. M. DEL. — Deux grands penseurs, quoique en des matières différentes. M. DESM. — Encore l'allégresse de M. Faguet fut-elle modérée, discrète, académique et goguenarde. Je suis sûr, d'ailleurs, que M. Faguet se fût réjoui, non moins modestement, du dénouement contraire, car il regarde avec optimisme tout événement propre à fournir deux cent cinquante lignes de copie. C'est tout ce que j'ai lu contre Ferrer. Nous n'avons donc aucun mérite à avoir été indignés. Tous les honnêtes gens le furent, et même quelques autres, et même quelques coquins à la Franklin, comme disait Baudelaire. Bref, la conscience universelle, etc. M. DEL. — Oui, connu. Mais il y a peut-être quelque chose de vrai dans cette expression amphigourique. M. DESM. — Oui, l'unité d'éducation, l'unité de lectures. Il y a une sorte de fraternité intellectuelle à laquelle n'échappe point un esprit cuItivé, où qu'il soit ; il y a de même une fraternité sentimentale qui tend à unir les peuples par-dessus les frontières. Quand ces deux courants aériens se rencontrent, cela cause de grands remous dans l'atmosphère du monde. M. DEL. — Et voilà pourquoi l'Espagne est muette ! M. DESM. — Précisément. L'Espagne est un pays fermé, théocratique et monacal, entouré de montagnes où se brisent les courants d'idées et de sentiments. On s'est étonné que la mort de Ferrer n'y ait causé nulle émotion, mais l'ont-ils su, même, et, s'ils l'ont su, ont-ils compris ? Croyez-vous que les habitants du Rouergue, avant la Révolution, aient été informés du supplice de La Barre ? L'Espagne est toujours le Rouergue ou l'Auvergne d'avant la Révolution. C'est peut-être bien autre chose encore : une sorte de Thihet européen. M. DEL. — Ce que je sais bien, c'est que je n'ai jamais pu rien comprendre à l'Espagne, ni dans son histoire, ni dans ses mœurs. Ce pays me paraît ne ressembler à rien de connu. M. DESM. — Toujours comme le Thibet. On parle, pour l'un et l'autre de ces pays, de décadence. Le mot n'a de valeur qu'en conversation, où il faut se servir de termes compris pour se faire comprendre, mais il ne signifie rien. L'Espagne est au contraire un pays de constance, un pays où la sensibilité, les idées, les mœurs sont immuables. Dans les autres pays d'Europe, la fluctuation autour du type moyen a des amplitudes assez variables, et plus les amplitudes sont grandes, plus la civilisation est active. C'est ce que jusqu'ici on a appelé le progrès. Depuis que les idées de mutation remplacent en biologie les idées d'évolution, le mot progrès n'a plus de sens. Il faut employer celui de fluctuation. Il y a un point central autour duquel court une ligne circulaire à éloignement variable. Eh bien, l'Espagne n'a, pour sa ligne circulaire, presque aucune fluctuation. C'est la constance, c'est la stabilité. Il y a à cela une cause, et toute biologique : la pureté de la race, obtenue par l'élimination des éléments étrangers. M. DEL. — Je connais les nouvelles théories de Hugo de Vries. Elles sont belles et logiques et font comprendre les mouvements de la vie mieux que l'idée d'évolution lente, qui se heurte à tant d'exceptions, surtout pour les destinées humaines. Les lois de constance, jointes aux lois de mutation et de fluctuation, expliquent à peu près tout, maintenant, d'une façon raisonnable. Et elles ne nous enferment nullement, comme on l'a dit, dans un cercle sans issue, puisqu'il y a la mutation, d'où tout un monde nouveau peut sortir brusquement, comme l'homme sortit un jour d'entre ses frères, les primates. M. DESM. — Oui, mais les races ou les espèces humaines ne peuvent compter que sur des fluctuations plus ou moins amples autour d'un type constant. Les croisements entre races différentes peuvent-ils augmenter l'amplitude ces fluctuations ? M. de Vries ne s'explique point là-dessus, mais je le crois d'après l'expérience historique. Les plus beaux types de l'humanité furent presque toujours des produits d'un métissage soit de races, soit de variétés plus ou moins accentuées. La race pure donne le produit moyen. Il ne faudrait point, je le crois aussi, abuser de ces croisements, qui pourraient amener la dégénérescence ; mais il semble bien qu'un élément étranger, jeté, de temps à autre, parmi les éléments générateurs d'une race, la fortifie ou, du moins, la surexcite. M. DEL. — Il est certain que tant que les Maures et les Espagnols vécurent côte à côte, le pays fut prospère et la race aventureuse. M. DESM. — Il y avait du sang maure dans les conquérants de l'Amérique, il y en avait dans les armées de Charles-Quint. C'est au moment qu'elle fut privée de cet élément étranger que la race espagnole, retournant à son type initial, retombant dans une constance sans fluctuations que très rares, commença à donner à l'Europe le spectacle de sa déchéance. M. DEL. — Et ce fut encore pis pour les Maures, devenus les Marocains. M. DESM. — Oui, et c'est peut-être l'explication du mystère ibérique. M. DEL. — Voilà maintenant que la biologie devient la clef de l'histoire ! M. DESM. — Comme la physiologie est la clef des sciences que les Académies appellent plaisamment sciences morales. Toutes les sciences, d'ailleurs, ne tendent-elles pas à se réduire à une seule méthode physique, celle des mesures, des poids, de l'analyse ? Pour juger d'un gouvernement, irons-nous consulter les moralistes ou les statisticiens ? M. DEL. — A propos, a-t-on la statistique des moines, des nonnes, des curés, de tous les gens d'Eglise qui rongent l'Espagne ? M. DESM. — Qui oserait la faire ? C'est l'innombrable. M. DEL. — Croyez-vous que cette abondance de gens d'Eglise ne soit pour rien dans l'état fâcheux où se trouve ce pauvre pays ? M. DESM. — On ne sait. Pour moi, c'est plutôt un effet qu'une cause. Si le pays était vigoureux, il secouerait toute cette vermine. Mais peut-être aussi que si une main étrangère la lui enlevait, il reprendrait quelque vigueur. Cependant, supporterait-il d'être privé de ses parasites ? M. DEL. — La Catalogne lui donnera l'exemple. M. Dzsa. — Savez-vous quelle serait la solution ? M. DEL. — Dites. M. DESM. — D'abord, la Catalogne indépendante. Ensuite, cette petite république conquérant lentement la péninsule, par ses idées plus encore que par les armes. M. DEL. — Sans doute, mais quelle utopie. M. DESM. — Hé! le Piémont ? p. 305-311.
M. DESMAISONS. — D'abord êtes-vous bien sûr des statistiques ? M. DELARUE. — Il faut bien les accepter. M. DESM. — Oui, tant que nous n'en avons pas besoin. Mais avant de raisonner sur un fait, il faut vérifier ce fait. M. DEL. — Comment vérifierais-je les statistiques ? M. DESM. — Oui, je sais. Aussi bien, je ne vous demande pas de reprendre chaque chiffre et d'en vérifier le contenu. Mettons que je vous demande seulement un peu de scepticisme. Est-ce possible ? M. DEL. — Cela va de soi. M. DESM. — Bien. Alors vous raisonnez sur des chiffres dont vous n'êtes pas très sûr. M. DEL. — Sans doute, mais c'est à peu près ainsi, toujours. Ils ne sont pas vrais absolument, mais ils le sont jusqu'à un certain point, comparés les uns aux autres. C'est une question de soustraction. Il ne se peut pas d'opération plus simple. M. DESM. — Avez-vous entendu dire que des villes, pour des raisons diverses, ont intérêt a ne pas dépasser un certain chiffre d'habitants ? M. DEL. — Oui, et d'autres, pour d'autres raisons, se gonflent, dit-on, plus qu'il ne faudrait. M. DESM. — C'est bien cela. On ne sait pas. L'incertitude même est incertaine. M. DEL. — En des limites très étroites. M. DESM. — Admettons-le. M. DEL. — Vous admettez aussi, je pense, qu'il est exact que la population en France diminue. M. DESM. — Ou plutôt qu'elle n'augmente pas. M. DEL. — Soit. Enfin, qu'elle a trouvé son point mort. M. DESM. — Cela ne me paraît pas contestable. M. DEL. — Et enfin que c'est là une situation alarmante. M. DESM. — Non pas. M. DEL. — Comment ? M. DESM. — Avez-vous noté que les individus qui cherchent du travail soient très rares ? M. DEL. — Pas précisément. M. DESM. — Ils auraient dû diminuer. M. DEL. — Je ne m'en aperçois pas. M. DESM. — Alors pourquoi vous alarmez-vous ? Il n'y a pas de place pour tout le monde, et vous conseillez au peuple de faire des enfants. Est-ce que le travail court après le travailleur ? Est-ce que les usines chôment ? Est-ce que le commerce, est-ce que l'administration... M. DEL. — Non, je l'ai déjà reconnu. Il y a trop d'hommes. M. DESM. — Que feriez-vous donc d'un surplus ? Voudriez-vous donner au travail des spectateurs ? M. DEL. — Non, sans doute, mais on pourrait créer d'autres industries. M. DESM. — Puisqu'il y a des hommes en excès ? M. DEL. — Enfin les économistes vous diront... M. DESM. — Qu'ils parlent. Pour moi, je m'en tiens aux faits. Voyons, mon cher ami, on invente chaque jour, ou presque, une nouvelle machine qui rend inutiles deux ou trois travailleurs sur trois ou quatre... Est-ce que vous ne seriez pas plus capable que les autres de confronter deux idées simples ? Est-ce que vous considérez éperdument les choses une à une, sans jamais être tenté de les rapprocher pour voir ce qui va se passer ? Le même économiste se réjouit de la machine qui fait le travail de dix ouvriers et, sur la même minute, gémit de ce que, encouragés par un exemple si frappant, ces dix travailleurs éliminés, réduits au rôle de regardeurs, ne courent pas embrasser leur femme à fond. Le fermier, jadis, avait besoin d'une nombreuse troupe, l'été, faucheurs, moissonneurs, faneuses, et combien d'autres ! Maintenant, il attelle deux chevaux, monte sur la légère voiture, se promène dans ses champs, et en une journée la besogne est faite. Allez lui parler de la dépopulation de la France, il gémira aussi, parce que le premier mouvement de l'homme le porte à imiter son voisin; mais ne lui parlez pas d'allonger sa famille. « Non, vous répondra-t-il, autrefois, cela m'aurait r.apportè ; maintenant, ça me coûterait. On sait compter, que diable ! » M. DEL. — Voilà le malheur ! M. DESM. — Vraiment vous m'exaspérez. Eh ! oui, il sait compter, il sait raisonner, il sait considérer l'avenir, et voila pourquoi il s'abstient. C'est un fait de civilisation, voilà tout. Il sait encore autre chose. Il sait, ce qu'il n'a pas toujours su, que les enfants se font de gré à gré. et il vient d'apprendre, tout récemment, que Dieu maudit les nombreuses familles. Voyez-vous, quand, dans un pays, les hommes ont appris que les enfants sont des actes de volonté, jamais, dans ce pays, la population n'augmentera, Croyez-vous qu'ils vont besogner leur femme tout naïvement ? Ils sont devenus de savants jardiniers, tout comme les hommes des villes, et ils ne sèment qu'à bon escient. M. DEL. — Justement. M. DESM. — Oui, justement, car cela prouve qu'ils se sont civilisés. L'homme prévoit, et c'est ce qui le distingue de l'animal. N'en demandons pas plus, c'est déjà très beau. Ah ! les bons bougres qui caressent leur stérilité, en incitant le peuple à procréer par patriotisme ! M. DEL. — Voilà ce qui m'inquiète. M. DESM. — Oui, l'invasion, n'est-ce pas ? M. DEL. — L'invasion. M. DESM. — Nous pouvons en parler, nous autres, nous sommes d'une race d'envahisseurs. L'invasion ne ferait peut-être pas tant de mal que cela à la France. Ce n'est qu'un moment à passer. Il faut que les races se renouvellent. Quoi qu'en dise Fustel de Coulanges, la Gaule romaine a été absorbée par les Francs, maison par maison, champ par champ, et les Gallo-Romains durent travailler pour les vainqueurs. Ce fut une belle invasion que celle des Francs, et celle des Normands ne fut pas médiocre non plus. Pensez, tous les couvents des bords de la Seine, pillés, incendiés, toutes les nonnes présentables jetées en barque et tirées au sort, et les mâles de ces femelles occis. Nous ne reverrons pas cela. M. DEL. — Non, ce que nous reverrons, c'est l'invasion lente, minutieuse, mathématique, la déprédation calculée; enfin ce que virent nos pères. M. DESM. — Et voilà ce qui fausse tous nos raisonnements touchant la population. L'Allemagne a troublé notre arithmétique. M. DEL. — Je le reconnais, mais il serait insensé de ne pas tenir compte d'un tel élément. M. DESM. — Tenons-en compte. M. DEL. — Eh bien ? M. DESM. — Eh bien, si l'on vous disait que la Russie va envahir l'Allemagne, va la manger, va l'absorber, que diriez-vous ? M. DEL. — Rien, je rirais. M. DESM. — Pourtant, la Russie a une populution double. M. DEL. — Qu'importe ! M. DESM. — Admirable. Disons aussi, nous autres : Qu'importe. Quand les Allemands seraient le double de ce que nous sommes, la balance serait encore égale, parce que, passé un certain chiffre, les nombres ne s'opposent plus logiquement. Cela doit être bien encombrant, une armée de deux millions d'hommes ! M. DEL. — Que conclure ? M. DESM. — Rien du tout. A mesure que l'Allemagne se civilisera davantage, elle ressentira les atteintes de ce mal, qui est un bien, la dépopulation, et si nous demeurions seulement stationnaires. les deux chiffres se rejoindraient. Voyez-vous, cultiver la population, c'est cultiver la misère, et il n'est pas possible que la culture de la misère soit le but de la civilisation. M. DEL. — Le but de la civilisation ! C'est vous qui parlez ainsi ? M. DESM. — Pardon. Ne supposez pas... M. DEL. — Le but de la civilisation ! p. 311-317. M. DELARUE. — Hum ! M. DESMAISONS. — Hum ! M. DEL. — Eh bien ? M. DESM. — Eh bien ? M. DEL. — Heu ! M. DESM. — Heu ! M. DEL. — Qu'en pensez-vous ? M, DESM. — Qu'en pensez-vous ? M, DEL. — Oh ! M. DESM. — Il faut y venir. M. DEL. — Croyez-vous ? M. DESM. — Assurément. M. DEL. — J'ai été surpris... M. DESM. — Moi aussi. Agréablement. M. DEL. — Je n'aurais pas cru... M. DESM. — Enfin, il faut vous y faire. M. DEL. — Je ne demande pas mieux. M. DESM. — Vous êtes content ? M. DEL. — Cet effondrement de la justice... Ah ! oui, je suis content. M. DESM. — Il paraît qu'ils ont fui, le jugement prononcé, laissant les honnêtes gens se réjouir. M. DEL. — Ramassant en hâte leurs paperasses, ils ont décampé, allant achever leur mauvais rêve. M. DESM. — Et cette simple femme de ménage tenant tête à « l'homme qui venge la morale publique ». M. DEL. — Quelle rengaine ! M. DESM. — C'est « celui qui défend la société ». M. DEL. — Je vous en prie. La société gagnerait beaucoup à ne pas être défendue par des mensonges et par des lâchetés. Chaque fois qu'un de ces hommes parle, on se sent devenir « coquin » avec délices, on réprouve l'état d'honnête homme... Mais je dis des énormités. M. DESM. — Oui, et qui pourtant sont justes. Qui voudrait faire partie des défenseurs de la justice, si la justice, c'est ça ? Maintenir une femme au secret pendant un an et demi, ne recueillir sur le crime que l’on instruit que des potins de journaux et de loges, essayer d'y mettre de l'ordre, n'y pas réussir, faire là-dessus des hypothèses sottes et lâches et venir dire aux jurés: « Messieurs, vous allez la condamner, n'est-ce pas, parce que j'ai des rhumatismes, et que je suis bien fatigué. Faites cela pour moi ! » Voilà la justice, telle qu'ils nous la présentent. C'est là ce qu'ils appellent « prendre la défense de l’ordre social ». Quelle comédie, quelle bouffonnerie ! M. DEL. — Prenons-le plutôt du côté comique. Sans cela, ce serait à rougir d'être des hommes. Ils font leur métier. M. DESM. — Non, non, disons : « Ils font leur devoir ! » Il faut que les grands mots soient tous salis, et qu'on ne puisse plus les prendre même avec des pincettes. Le Devoir ! Mais c'est qu'ils ont l'air de parler au nom de la communauté. Merci, je ne suis pas solidaire. M. DEL. — Croyez-vous que cet accusateur public fût sincère ? M. DESM. — Comme une brute. Il faisait son Devoir. Et chacun sait que, lorsqu'on fait son Devoir, on sent comme un velours sur la conscience. C'est la récompense. S'il eût manifesté le moindre doute, aussitôt le velours eût été remplacé par une pelote d'aiguilles. C'est à quoi les honnêtes gens s'aperçoivent qu'ils font ou non leur Devoir, Le mécanisme de la chose est, vous le voyez, des plus simples. On construirait facilement l'automate vertueux. Il étonnerait même ses contemporains par la certitude de ses réactions. Notez que je l'approuve en secret, cet accusateur. Il est logique. Et puis, il sait bien qu'un acquittement est, pour la magistrature, Je plus épouvantable des scandales, puisque c'est un scandale irréparable et qui prouve, plus clairement que la plus belle erreur judiciaire, l'absurdité de la justice. Voulez-vous le fond de ma pensée ? Tout cela est très bien, et il ne peut pas en être autrement, attendu qu'en matière criminelle les magistrats sont particulièrement incompétents. Comment ! Voilà des hommes de ce siècle qui croient encore à la véracité des témoignages ! Quand il est prouvé que, sur dix personnes, il n'y en a pas une capable de dire la couleur du papier de sa chambre ! Je passe trois et quatre fois par semaine rue Bonaparte, et cela depuis quinze et vingt ans. Or, la semaine dernière, j'y ai découvert une boutique, une antique boutique, que je n'avais pas encore vue ! Le témoignage, oui, si l'on vous prévenait, cela pourrait avoir, quelquefois, une valeur. Mais hors ce cas-là, la plupart des hommes regardent sans voir. Songez à une femme avec laquelle vous avez couché, il y a un an, et demandez-vous la couleur de ses cheveux. Cela n'empêche pas les magistrats de faire état d'un témoignage unique pourvu qu'il soit toujours le même, ce qui ne prouve qu'une chose, c'est que le témoin est entêté et qu'il ne démord point de ce qu'il a une fois proféré. M. DEL. — Si vous ôtez à la justice la croyance au témoignage, que lui restera-t-il ? M. DESM. — Cela ne me regarde pas. Qu'elle cherche ! Elle trouvera. Si vous me dites qu'il a fait cette nuit 2 degrés au-dessous de zéro, je vous croirai, parce que cela n'a pour moi, qui en avais dix ou quinze dans une chambre, qu'un intérêt fort modéré ; mais si je devais considérer le fait comme un fait scientifique, je vous demanderais si vous vous êtes servi d'un bon thermomètre enregistreur, et si ses données concordent avec celles des autres thermomètres du même mécanisme. Si oui, nous aurions une preuve. Que la magistrature se serve du thermomètre enregistreur, c'est-à-dire, en l'espèce, des faits bien constatés et dont il reste une preuve tangible. Ainsi le vol est certain, quand on trouve dans la poche du voleur une douzaine de porte-monnaie ; ou l'assassinat par tel individu évident, quand on trouve près du cadavre le morceau de drap qui manque à la culotte de l'assassin. Les preuves par l'objet sont innombrables et il y en a presque toujours, à moins que la bêtise des premiers témoins ne les ait négligées. Enfin, il y a encore les preuves qui résultent d'un tas de petits faits qui rentrent logiquement l'un dans l'autre : c'était ce genre de preuve qu'on pouvait relever dans l'affaire Steinheil ; seulement, les petits faits ont refusé de se laisser rassembler logiquement ; c'était comme au jeu de patience : il y en avait toujours un qui restait en dehors et l'assemblage était toujours à recommencer. Ce qui n'a pas empêché, en outre des magistrats, un tas de gens de s'être fait une conviction. M. DEL. —- Oui, mais la conviction, c'est quelque chose de si fort qu'on ne peut pas lui résister. M. DESM. — Je le veux bien, mais elle ne doit jamais assumer la place de la raison ni venir s'immiscer dans un raisonnement. La phrase innocente : « J'étais convaincu que... », peut prendre un sens épouvantable. Il faut rougir d'être convaincu, si on ne peut s'empêcher de l'être. C'est la conviction qui a fait tant de martyrs ridicules et tant de bourreaux grotesques. Chercher la mort par conviction, ce fut la folie des chrétiens persécutés, mais la donner par conviction, ce fut la folie des chrétiens persécuteurs. La conviction morale produit les mêmes effets que la conviction religieuse ; la magistrature moderne le prouve chaque jour, comme l'ancienne. Il vaut mieux, disait à peu près Joseph de Maistre, faire périr dix innocents que d'épargner un coupable. Voilà où mène la conviction que la loi de Dieu doit toujours triompher. C'est toujours, même si on ne la nomme pas, au nom d'une divinité criminelle que l'on poursuit jusqu'à l'ombre du crime. Car, nous autres, qu'est-ce que cela nous fait que le crimeparfois triomphe ? Il n'y en aura pas un de plus pour cela, et d'ailleurs, est-ce si rare ? Celui qui n'est arrêté que par la crainte du châtiment ne l’est pas, en réalité, mais seulement par la lâcheté qu'il ajoute à sa perversité. Je suis convaincu qu'une société sans justice ne marcherait ni mieux ni plus mal qu'une société pourvue d'une mauvaise justice, et la justice est toujours mauvaise. Ils croient sauver la société et ils punissent un criminel sur dix ! Voyez les Crimes impunis, de Macé. Alors, leur orgueil s'exalte, leur vanité se rengorge. Pauvres gens qui ne savent pas qu'ils sont pris dans le déterminisme universel, à peu près comme un voyageur dans un train rapide ! Ils croient qu'un échafaud va ralentir la vitesse du train; ils croient que par hasard dix échafauds vont l'arrêter... M. DEL. — Non, mais... M. DESM. — Protégeons-nous contre les malfaiteurs, je vous comprends : mais pourquoi les relâcher quand on les tient ? M. DEL. — Il y en a de plus ou moins coupables. M. DESM. — Vous en êtes là, aux crimes gradués ? M. DEL. — Cependant. M. DESM. — On relâche les criminels qui semblent médiocres... M. DEL. — Et on a raison. M. DESM. — Pour justifier la magistrature, lui assurer la perpétuité, de l'avancement et d'honorables traitements. Il faut qu'il y ait des gens en robes rouges. C'est un décor. Seulement, il leur manque, comme en Angleterre, une perruque. p. 317-325. M. DELARUE. — Ces rois dans les rues de Paris, quel effet cela vous fait-il ? M. DESMAISONS. — Un effet d'archéologie, un effet lointain. Il me semble que les siècles passés sont revenus. M. DEL. — Heu ! moi, je pense plutôt à Louis-Philippe et à son parapluie, car ces rois contemporains, ils ont un parapluie ? M. DESM. — Non, on ne les sort que déguisés en généraux. M. DEL. — Manuel aussi ? M. DESM. — Ah ! celui-là s'habille en colonel. Songez qu'il grandit encore. M. DEL. — Il ne montera jamais bien haut. M. DESM. — Hum ! je ne le pense pas. M. DEL. — Quelle rage ont-ils de rester rois ! L'exemple... M. DESM. — Ne porte pas. On espère être plus heureux. La protection du ciel... Il y en a qui ont vécu. M. DEL. — A quel prix ? M. DESM. — On s'habitue au danger. Et puis vraiment, ils n'ont pas le choix. Les uns les visent parce qu'ils sont rois ; d'autres les viseraient, s'ils ne l'étaient plus. M. DEL. — D'où il faut conclure que ce sont les peuples qui sont archéologiques. M. DESM. — Enfants. Un roi : ils croient que cela protège, comme la Bible, comme la madone. Il faut accepter les données du problème. Le sentiment royaliste est un sentiment mystique. On croit au roi par la même raison que l'on croit à Dieu. Aussi vous verrez toujours ces deux sentiments unis : le trône et l'autel. M. DEL. — C'est vrai, l'un ne se comprend pas sans l'autre. Pour moi, je n'ai jamais admis bien volontiers qu'on pût être adorateur du Dieu et contempteur du roi. Un seul Dieu, un seul roi : cela se balance, cela se correspond. M. DESM. — Là où décroît le sentiment religieux, décroît aussi le sentiment royaliste. Aussi je pense que si bien des fléaux nous menacent, nous échapperons, du moins, à celui-là. M. DEL. — Ce serait, chez nous, effroyable. Vous avez lu l'anecdote de Philippe allant mettre un cierge à la Sainte-Vierge, un cierge pas trop petit, mais pas trop gros non plus. Est-il assez Louis-Philippe et juste milieu ! Mais pourquoi met-il des cierges ? M. DESM. — Pour hâter son retour. Ils en sont là. Ils croient très sérieusement que la Sainte-Vierge existe, d'abord ; ensuite que c'est une bonne Dame que cela amuse qu'on allume des cierges devant son image ; enfin que par bonté d'âme elle vous accorde ce pourquoi vous avez fait allumer le cierge. Ame de Botocudo ! Des esprits un peu vulgaires ont gâché ces sortes de considérations. Il ne faut pas les mépriser. L'anecdote du cierge est belle pour montrer l'état d'esprit de la pseudo-royauté et combien elle s'écarte de l'esprit général en France. Cependant, je la soupçonne d'être apocryphe, quoique le commerce de la cire en ait éprouvé, partout, un amendement notable. Il faut bien vous mettre dans l'esprit que nous vivons entourés de fétichistes, et qu'il faut compter avec eux. A l'heure que vous lisez une page de De Vries, et que vous méditez sur l'origine de l'homme, il y a une bonne femme qui, à Saint-Sulpice, fait allumer un cierge parce que son fils est malade, et ces deux actes retombent ensemble dans le néant. Tout s'équivaut, allez. Dans le possible, choisissez le plus noble : que vous importe, le reste ? M. DEL. — Oui peut-être que nous avons trop l'esprit de prosélytisme, mais cependant il faut bien défendre notre liberté. Si le roi revient, le clergé le suit. M. DESM. — N'en doutez pas. Il ne saurait vivre sans clergé, non pas à cause de ses opinions personnelles, mais à cause de son état de roi. Les racines de la royauté ne peuvent trouver quelque fraîcheur qu'en plongeant dans le bénitier. M. DEL. — C'est bien sale. A-t-on pensé à faire l'analyse de l'eau du bénitier ? Il y a là le thème d'une jolie communication à l'Académie des sciences. Il faudrait employer le mot désinfecter. Alors ? M. DESM. — On ne peut parler de ces choses sans devenir grossier. C'est l'« énorme » de Flaubert. Observons la neutralité. M. DEL. — Comme à l'école. M. DESM. — C'est cela. M. DEL. — La vraie, celle qui dit à la fois oui et non. M. DESM. — C'est cela. M. DEL. — Qu'est-ce que Dieu ? M. DESM. — Dieu est à la fois tout et rien du tout. M.DEL. — Vous penchez à gauche. M. DESM. — A la fois tout et rien. Non. A la fois le tout et le rien. M. DEL. — Ce n'est pas clair. M. DESM. — Mais c'est neutre. M. DEL. — Je n'en suis pas sûr. M. DESM. — Ah ! la neutralité est difficile. M. DEL.— A toutes les questions, je répondrais, dans mon manuel, par heu ! heu ! M. DESM. — Dieu existe-t-il ? M. DEL. — Heu ! heu ! M. DESM. — Napoléon a-t-il été un grand homme ? TU. DEL. — Heu ! heu ! M. DEM. — Vous appuyez trop à gauche, vous aussi. M. DEL. — Eh bien ! j'y renonce. M. DESM. — Je crois avoir trouvé. La neutralité, en matière scolaire, ce serait d'énoncer sur un ton indifférent tout les Ponts-Neuf de la métaphysique, de la morale, de l'histoire qui sont en contradiction les uns avec les autres. Vous voyez l'effet sur les bambins ? M. DEL. — Ce serait absurde. M. DESM. — Ce serait bien l'esprit du mot neutralité. Ni pour, ni contre. Egorgez-vous, si cela vous plaît, moi je suis neutre. Je vous récite toutes les âneries que l'on a dites sur les sujets célèbres. Choisissez ce qui vous fera plaisir. M. DEL. — Oui, mais on a affaire à des enfants. M. DESM. — C'est-à-dire à des êtres beaucoup plus intelligents que les vieux et bien plus capables d'un bon jugement. M. DEL. — Il est certain que l'âge supérieur, pour la plupart des hommes, c'est de quatorze à dix-huit ans. C'est l'apogée. On comprend tout et, comme on n'a pas d'expérience, on n'est pas influencé par les absurdités de la vie. On voit tout selon la logique. Mais il s'agit des écoles primaires. M. DESM. — Dites donc, vous avez l'air de me poser sérieusement la question ? M. DEL. — Pourquoi pas ? M. DESM. — Neutralité ! Quelle bêtise ! Dire ce qu'on pense, hardiment, voilà le meilleur. M. DEL. — Vous êtes encore plus sérieux que moi. M. DESM. — Et je veux l'être encore davantage. Savez-vous le défaut de tout enseignement ? C'est que l'on ne compte jamais avec l'esprit de contradiction. Ils s'imaginent façonner les enfants une fois pour toutes. Quelle erreur ! La classe finie, commence l'anti-classe, c'est-à-dire la dérision de tout ce qu'a enseigné le maître. Notre ennemi c'est lui, notre maître. Et puis, il y a la vie qui, se charge de l'enseignement véritable et définitif. On ne devrait enseigner à l'école que des faits et des méthodes de travail. Je ne vois pas bien l'utilité de leur dicter des jugements sur l'histoire de France, matière révisable et révisée sans cesse. Des jugements? Jugeons-nous l'évolution de la terre ? Disons-nous : ceci fut bien, ou fut mal ? La création des carnassiers fut un crime envers les herbivores? Ou, si, comme je le crois les carnassiers sont plus anciens, les herbivores dont l'apparition fut un bienfait pour les carnassiers réduits à se manger entre eux ? Nous-nous bornons à constater les faits, opération encore très difficile, et nous laissons le monde évoluer ou tourner sur lui-même. Il n'y a qu'une histoire, l'histoire naturelle, dont les chroniques particulières des espèces humaines forment une division. M. DEL. — Mieux vaudrait pas d'histoire du tout. Effacer à chaque génération les témoignages inutiles du passé... M. DESM. — Ce serait un système, mon ami. Nous sommes écrasés par l'histoire. p. 325-332.
|