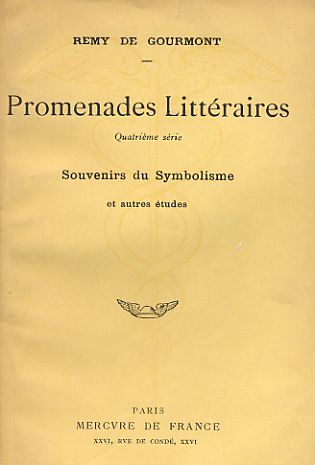|
Remy de Gourmont |
||
« Le Mercure de France », Promenades littéraires, quatrième série, Mercure de France, 1912.
« LE MERCURE DE FRANCE » Le Mercure de France a été fondé à la fin de l'année 1889 par un groupe de jeunes gens sans relations, sans notoriété, sans argent. Les premiers numéros, forts de trente-deux pages encadrées de marges immenses, portaient au verso de la couverture cette mention entre parenthèses : « La Pléiade, 2e année. » La collection n'est donc absolument complète que si elle englobe cette première série, dont la couverture violette l'apparente avec une certaine évidence au Mercure de France, non moins que la rédaction demeurée à peu près la même. Une première « Pléiade » avait été fondée en 1886 par M. Rodolphe Darzens, qui a depuis abandonné l'improductive littérature. C'est de là que date vraiment cette livrée violette, destinée à devenir presque aussi célèbre que la couverture saumon de M. Buloz. C'est cette première « Pléiade » qui publia le Traité du verbe de René Ghil ; sa livraison du mois de mai révèle un nom qu'attendait une grande fortune, celui, tout flamand alors, de Mooris Maeterlinck. Si l'on savait, n'est-ce pas ? Mais combien sont-ils ceux qui lurent, dans la « Pléiade » de 1886, le Massacre des innocents ? Le Mercure se rattache également, du moins pour l'esprit et la collaboration, au Scapin, publication hebdomadaire imitée de la Vogue, et qui était dirigée de fait par Alfred Vallette, qui y publia des fragments d'un roman et des articles de doctrine littéraire. Il y démontrait volontiers que le symbolisme n'avait aucun avenir et que tout au plus demeurerait-il un des ruisselets de la poésie française. Je ne crois pas qu'il ait changé d'avis en passant par la « Pléiade », et quand il organisa le Mercure de France, son intention était très loin d'en vouloir faire un recueil symboliste. Aussi bien le Mercure ne l'est-il devenu tout à fait que vers 1895. Jusque-là, de toutes les tendances qui s'y manifestent fraternellement, le symbolisme est la moins bien représentée. Mais peut-être faut-il entendre par symbolisme, ainsi que je l'ai écrit et toujours pensé, une littérature très individualiste, très idéaliste, au sens strictement philosophique du mot, et dont la variété et la liberté mêmes doivent correspondre à des visions personnelles du monde. En ce sens, le symbolisme ne serait techniquement, qu'un naturalisme élargi et sublimé, ce qui se définit assez bien par le mot de Zola : « La nature vue à travers un tempérament », si on donne au mot nature sa signification ample : l'ensemble de la vie et des idées qui la représentent. En ce même article du Scapin, intitulé : « Les Symbolistes », Alfred Vallette fait très bien remarquer, dès 1886, que l'école symboliste « a toujours marché de conserve avec la dernière venue : l'école naturaliste ». Elles avaient au fond, peut-être à l'insu de leurs tenants, mêmes principes, et l'on est moins étonné, après cela, de voir Huysmans tenir en pareille estime et pour les mêmes motifs d'art, le Zola de la belle époque et Stéphane Mallarmé, d'ailleurs strictement contemporains. Lui-même, dans A Rebours, dans En Rade, unit les deux tendances, telles qu'on les retrouvera encore dans la poésie de Verhaeren. En 1889, on doutait de la prépondérance du symbolisme. Au courant du mois de décembre de cette année-là, un de mes amis de la Bibliothèque nationale, Louis Denise, qui voulut oublier la poésie par amour pour les oiseaux, me demanda sans guère de préambule si je ne voulais pas m'associer à quelques jeunes gens qui fondaient une petite revue douée de ce titre archaïque : le Mercure de France. J'acquiesçai, cependant qu'il me racontait comment leur petit groupe, ayant découvert les capacités administratives d'Alfred Vallette, avait décidé de se mettre sous sa direction. « C'est, me disait-il à peu près, un esprit solide, sans envolées lyriques, mais à la vision nette, et qui sait mesurer les choses et les hommes, les estimer à leur valeur. Avec lui, nous ne nous perdrons pas dans les nuages, nous resterons dans les contingences. C'est de plus un garçon assez autoritaire, ce qui n'est pas mauvais, même pour mener une toute petite revue. S'il est possible qu'une telle chose se développe et réussisse, lui seul peut influencer le destin. » Les prévisions de ce jeune poète, également fort pondéré, ne tardèrent pas à se réaliser. Une revue comme un journal, comme toute entreprise, c'est avant tout une direction, et de tous les instants. Les collaborations viennent toutes seules, et une bonne organisation supplée à presque tout le reste. Il le fallait bien pour le Mercure de France, dénué d'argent à un point qu'on ne saurait dire, et qui se lançait à la conquête du monde littéraire avec rien que des forces intellectuelles assez incertaines. Toutefois, comme il faut que le rien lui-même contienne quelque chose, il y avait des parts de fondateur à cinq francs l'une, à la petite semaine, soixante francs par an. Le plus riche de la bande, Jules Renard ou Louis Dumur, en détenait quatre. On marcha ainsi quelques années, le faible produit des abonnements et des ventes comblant les insuffisances des cotisations ; et il y avait tant d'ordre et de régularité que dès la seconde année la revue avait doublé d'importance et commençait sérieusement à faire figure. Les premiers tomes furent singulièrement égayés par les merveilleuses ballades de Laurent Tailhade. Depuis Marot, Villon ou Saint-Amand, on n'avait pas vu une telle verve, ni une telle audace de satire. J'en suis bien fâché pour les victimes du redoutable mastigophore, mais il est probable que la postérité s'amusera encore à leurs dépens. Quelles aient un peu de patience, on les réhabilitera certainement comme celles de Boileau, dans deux ou trois siècles. Beaucoup de refrains de ces ballades sont passés déjà à l'état de citations courantes : « On mange du veau chez Allard. – Le commerce des veaux reprend. – L'homuncule dans la bouteille. – Joli cadeau à faire à un enfant », et d'autres, moins honnêtes, mais dont notre malignité ne se souvient que mieux. Laurent Tailhade contribua beaucoup sans doute, question de talent et aussi de scandale, à la diffusion du Mercure. Les petits contes et tableautins pittoresques de Jules Renard lui furent aussi un élément de succès. Ses courtes comédies sont en raccourci, comme le Plaisir de rompre, dans ces pages minutieuses données presque en chaque numéro de la revue. C'est là aussi qu'il faut chercher la première version, plus aiguë et plus ramassée, de Poil de carotte, cette satire de la famille qui évoque les invectives de Vallès et ne leur ressemble pas. Tout cela était bien loin du symbolisme, et les poètes de la maison ne s'en rapprochaient guère, excepté peut-être Saint-Pol-Roux qui d'ailleurs avait la prétention de représenter l'école idéo-réaliste, et qui, en attendant de plus grandes œuvres, s'amusait à des petits poèmes en prose rythmique, dont quelques-uns, comme le Pèlerinage de Sainte-Anne, sont de bien curieuses merveilles. Les poètes, donc, restaient fidèles à l'esthétique parnassienne, et d'abord Albert Samain, cet homme charmant qui fuyait la gloire et ne s'est laissé atteindre par elle que dans la mort. Il végétait d'un modeste emploi à l'Hôtel de Ville, ne voyait que de rares amis, passait, timide et orgueilleux, dans la vie qu'il jugeait de loin et de haut, sans faire plus de bruit qu'un bon employé. Comme Léon Dierx, il dédaigna de s'élever au grade de rédacteur sous le prétexte que ses appointements d'expéditionnaire suffisaient à son ambition, mais en réalité par paresse de poète, par dédain d'une besogne qu'il voulait bien exécuter, mais non prendre au sérieux. Bon employé, oui, mais qui, parfois, au printemps, oubliait l'heure de rentrer après déjeuner. Il humait l'air, les paupières un peu battantes, disait : « Tiens ! il fait amour aujourd'hui », et on ne le revoyait de la journée. Aucun poète, depuis Verlaine, n'a été plus populaire : les trois petits volumes de vers de cet insouciant rapportent à ses héritiers un véritable revenu. On ne connaît de Samain aucune autre prose que quelques contes. Les autres poètes des premières années du Mercure s'occupaient volontiers de critique, et quelques-uns y ont persévéré : Charles Morice, que son livre récent, la Littérature de tout à l'heure, mettait au premier rang des esthéticiens ; Louis Dumur, dont les essais de vers rythmiques promettaient un poète original et volontaire ; on n'a pas oublié sa iambique Neva : ... Les horizons pallides Ernest Raynaud, qui fut avec Moréas un des arcadiens de l'école romane ; Pierre Quillard (1), critique délicat et doux, qui lit tous les vers, mais n'en fait plus aucun ; Edouard Dubus, philosophe occultiste qui évoqua un soir devant Huysmans, fort troublé, le corps astral de Camille de Sainte-Croix ; Albert Aurier, qui était déjà (il mourut tout jeune) un maître en critique d'art, qui avait découvert Van Gogh et, presque avant tous, célébré la gloire de Gauguin, de Carrière, de Renoir, de Claude Monet, posé des principes d'esthétique que l'on discute encore, parce qu'on ne les a pas remplacés. De cette première rédaction du Mercure, un seul écrivain était connu, presque célèbre, surtout célébré, Rachilde, l'auteur de Monsieur Vénus, roman dont Maurice Barrès venait précisément de louer, avec toute sa précoce gravité, la morale mystérieuse. Bientôt cependant, à mesure que les fascicules du Mercure augmentaient de poids, sa physionomie se modifiait. Lentement, mais sûrement, le symbolisme s'y glissait. Vers 1895, après cinq ans, au milieu de cinquante autres revues ou gazettes, écloses à ce soleil, maintenant un peu refroidi, le Mercure est la concentration sinon la synthèse de la littérature nouvelle. C'est là qu'on la cherche, avec un peu d'hésitation, et c'est là qu'on la trouve. Non pas uniquement d'ailleurs, car la Plume, l'Ermitage, la Revue Blanche subsistent à côté de lui, avec leur clientèle particulière d'amateurs, leur esprit et leurs tendances. L'année suivante, avec la publication d'Aphrodite de Pierre Louys, le Mercure prenait un essor définitif. A cette date, 1896, on peut clore le premier et le plus valable chapitre de son histoire. La petite revue de trente-deux pages, fondée avec deux cents francs, est devenue la maison d'édition qui va bientôt entreprendre la traduction des Œuvres complètes de Nietzsche, qui influèrent tant sur la pensée française, et mener à bien, en une quinzaine d'années, l'édition de sept ou huit cents volumes, parmi lesquels l'œuvre entière d'Henri de Régnier, le plus fidèle et le plus solide soutien de la maison dont la première pierre avait été bravement posée sur le sable, sous l'œil bienveillant des chimères. J'arrête ici ces souvenirs où j'ai essayé de coordonner des impressions littéraires auxquelles les années donneront peut-être quelque importance ou qu'elles dissiperont peut-être, on ne sait jamais. Il est difficile à celui qui participa d'assez près à un mouvement comme le symbolisme d'en bien apprécier le prix, et je ne suis pas de ceux d'ailleurs qui se font de grandes illusions ni sur la valeur des mots ni sur la valeur des œuvres. Plus rapidement encore qu'autrefois, le temps ensevelira sous sa poudre les travaux d'une génération qui, comme toutes les autres, crut un moment qu'elle représentait l'avenir du monde. Ces tromperies sur soi-même sont utiles. On ne ferait rien, si on ne se croyait capable de tout. « Le mensonge comme condition de vie », a dit Nietzsche. Ce mensonge, c'est ce que la philosophie traditionnelle appelle l'illusion. Des jeunes gens groupés autour des nouvelles revues qui paraissent et disparaissent, croient volontiers qu'ils vont tout démolir. Ils sauront un jour qu'on ne démolit rien et que le plus grand effort d'un homme est d'apporter une toute petite pierre du chemin à la pyramide élevée par les générations précédentes. Mais il faut toujours s'imaginer qu'on détient une très grande force ; il faut rêver que la flèche a franchi la forêt, les fleuves, a traversé la montagne : nous avons bien le temps de la retrouver perdue à nos pieds, dans les broussailles, quand nous chercherons sur la terre les traces du passé. Il est en poésie, un résultat tangible de l'effort du symbolisme : le brisement du vers. On ne fait plus le vers français comme Sully-Prudhomme, cela est certain. La césure est abolie et ne revit que par hasard, par habitude, en vue d'un effort particulier. Le nombre exact des syllabes n'est plus nécessaire à la mesure des vers ; les muettes comptent ou ne comptent pas, selon la musique que l'on veut dessiner. La rime riche semble parodique, on ne prend plus au sérieux « ce bijou d'un sou » ; les vers à la Banville, semblent à nos oreilles lasses, ou trop raffinées pour se plaire aux sons pleins du cuivre, construits sur de laborieux bouts-rimés. Même la simple assonance nous satisfait mieux, et la surprise nous charme davantage des sons un peu dispareils que la concordance tapageuse des coups de cymbale. Enfin la division des rimes en masculines et féminines apparaît telle qu'une puérile hérésie phonétique : meurt et heure, voilà d'excellentes rimes, qui demain ne choqueront plus personne. La versification parnassienne est aussi loin de nous que la versification latine. Je ne fais nulle allusion ici au vers libre, quoiqu'il soit très en faveur, mais il me satisfait mal. La prose a naturellement peu changé, puisqu'il n'y a pour ainsi dire qu'une seule manière de bien écrire. Mais on peut cependant noter que le style simple et précis, loin de l'éloquence romantique, est, après des tâtonnements, des essais d'une fantaisie excessive, redevenu ce qui plaît davantage, ce qui décèle un écrivain. Le gain, c'est qu'il se plie volontiers et mieux que jamais à toutes les nuances, à tous les mouvements de la pensée. Il n'est plus oratoire, il ne fait plus de moulinets, il se concentre en sourires, en doutes, en reculs, en gestes discrets d'accueil, en insinuations. On sait tant de choses qu'on s'aperçoit qu'on ne sait plus rien. On suppose, on propose, on n'affirme pas et le mot charmant et désabusé de Pilate est sur toutes les lèvres : « Qu'est-ce que la vérité ? » Il y a des habitudes, il n'y a plus de principes. On peut douter de tout et on ne jure plus qu'avec un geste évasif. Telles m'apparaissent, formulées dans la prose des bons écrivains, les idées nouvellement évoluées. La science elle-même ne s'est-elle pas prise d'un goût tout nouveau pour le doute ? Elle ne dit plus : « Il est certain que... » Elle dit : « Il est plus commode d'admettre que... » C'est le commodisme de M. Poincaré. La biologie s'est mise à nier les vieilles théories darwiniennes sur l'origine de l'homme, ce qui n'est pas sans lui faire subir une crise assez dure d'incertitude. Je note cela, parce qu'il n'est pas de littérature sans philosophie, et que tous ces doutes ont modifié l'aspect littéraire, obscurci cette belle confiance en soi qui régnait dans les œuvres des générations précédentes. Mais c'est mieux ainsi. Au reste, je livre ces réflexions à ceux qui croient que le symbolisme a été une école de foi. Pour moi, cela fut tout le contraire. (1) Pierre Quillard vient de mourir (1912), en regrettant peut-être de n'avoir pas donné toute sa vie aux lettres. Voir aussi : "Hier et demain", Dans la tourmente, Crès 1916. |
||
 |