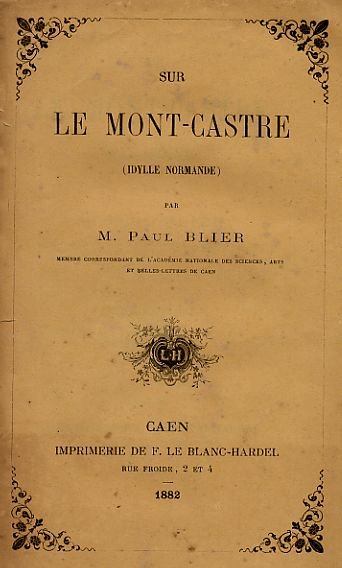|
Poème publié dans les Mémoires de l'Académie nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, 1882 et sous forme de plaquette :
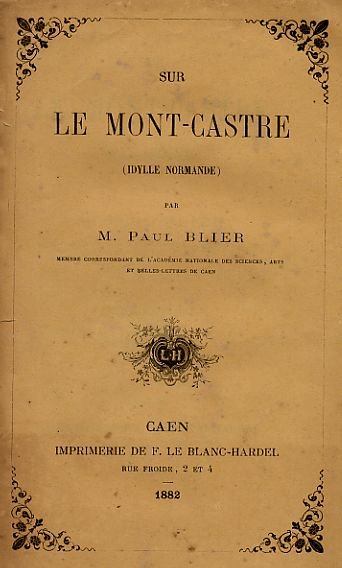
SUR LE MONT-CASTRE
(IDYLLE NORMANDE)
Par M. Paul BLIER
Membre correspondant
Un matin de printemps, à l'heure où la nature
Prend un aspect charmant, au réveil, - je sortis
Pour respirer le frais, et voir à l'aventure
Les rêves de vingt ans, en mon cerveau blottis,
Trotter, comme lapins, à travers la rosée
Sur la bruyère en fleurs par la nuit déposée.
Des nuages légers, floconneuse toison,
S'éparpillaient au ciel, et voilaient l'horizon
D'où s'élançait, trouant la brume vaporeuse,
Le soleil secouant sa gerbe de rayons.
Les lièvres se glissaient, race alerte et peureuse,
Entre les verts genêts et gagnaient les sillons ;
Les perdrix s'appelaient gaîment, et l'alouette
Fouettant l'air frémissant de son aile inquiète,
Montait d'un brusque essor, et dans l'air matinal
Saluait la soleil d'un hymne triomphal.
Je gravis lestement les pentes du Mont-Castre
Où fleurit l'ajonc d'or et le chardon bleuâtre,
Et j'arrivai bientôt sur le large plateau
Qu'offre à son vert sommet l'âpre et rude coteau.
- De ce point culminant je voyais, sur ma droite,
Verdoyer au soleil la campagne, où miroite
Par place un abreuvoir ou quelque filet d'eau.
Saules et peupliers coupaient d'un frais rideau
Les herbages noyés dans l'ombre des collines ;
Et sur ma gauche, au loin, l'anse de Morsalines
S'échancrait, reflétant au frisson de ses flots
Le sourire infini du jour à peine éclos.
Et déjà, s'envolant de Barfleur et des îles,
Les barques des pêcheurs rasaient les eaux tranquilles ;
Et le long des cours d'eau, dans les vallons herbeux,
Pas à pas, en paissant, s'en allaient les grands bœufs.
Comme je contemplais d'un regard circulaire,
Afin d'en mieux graver l'image en mon cerveau,
Ce tableau radieux que d'un sourire éclaire
L'aimable Germinal, le mois du renouveau, -
J'entendis tout à coup sur la pente escarpée,
De plus en plus distincte, une voix qui chantait,
D'un ton bas et plaintif dont mon cœur s'attristait,
Je ne sais quelle vague et lente mélopée.
La voix se rapprocha de buisson en buisson,
Comme à son nid revient la colombe échappée,
Et je surpris au vol ce lambeau de chanson.
"Las! hélas! pour mon cœur que lassent
Tristes, tristes, - tristement passent
| Les jours et les nuits.
Sur la verte lande,
Aux sons du pipeau,
Par couple ou par bande
S'ébat mon troupeau.
Il trotte et folâtre,
Sans penser à rien :
Sur lui le vieux pâtre
Veille avec son chien.
|
"Las! hélas! pour mon cœur que lassent
Tristes, tristes, - tristement passent
|
Le chant s'interrompit, et je vis apparaître,
Maigre et fauve, un vieillard, barbe et cheveux épars,
Qui poussait devant lui, tout en les laissant paître,
Ses brebis, dont son chien réprimait les écarts.
- "Vieux berger, si c'est toi qui chantais tout à l'heure,
Lui dis-je, sur ma foi ! tu prends bien mal ton temps
De choisir un refrain où la tristesse pleure,
Pour fêter, au réveil, ce beau jour de printemps !"
- "Ce beau jour ? dit le vieux à la barbe d'apôtre.
Et sur quoi juges-tu ce jour plus beau qu'un autre,
Jeune homme ? Crois-tu donc qu'il suffit d'un rayon
Allumant la rosée aux herbes du sillon,
D'un parfum qui s'exhale, et d'un chant d'alouette
Tombant du haut du ciel et que l'écho répète,
Pour que tout cœur s'éclaire et chante, - et qu'à mon tour
Je puisse m'écrier avec toi : quel beau jour ?"
- "Oui, repris-je, je crois qu'entre toutes les causes
Qui peuvent éveiller la joie en notre sein,
Rien n'est plus naturel, et plus juste, et plus sain
Que de s'unir de cœur à la gaîté des choses."
- "Erreur ! dit le vieillard. Les bois, les prés, les roses,
L'oiseau qui bat de l'aile, et le ruisseau qui fuit,
Pas plus que le soleil et les feux de la nuit,
Ne sont en aucun temps ni joyeux ni moroses.
Le monde extérieur ne pleure et ne sourit,
Crois-moi, qu'en reflétant l'état de notre esprit :
Splendide et lumineux, si notre âme est joyeuse,
Brumeux, terne et voilé, quand elle est soucieuse."
- "Non, répliquai-je, non ! Le deuil d'un soir d'hiver,
L'allégresse de l'aube illuminant la mer,
Ne sont pas seulement un reflet que leur prête
Notre humeur attristée ou notre cœur en fête.
Une âme éparse flotte avec les moissons d'or,
Et dans les bois émus à tous leurs bruits se mêle !...
Et, d'ailleurs, fût-il vrai que l'antique Cybèle
Ne vit qu'en nous, vieillard, je te dirais encor :
Puisque les choses n'ont de charme et de sourire
Que ceux dont les revêt notre âme qui s'y mire,
Faisons fête au présent, croyons au lendemain,
Et marchons exultants d'une gaîté sereine,
Afin que la nature inconsciente prenne,
Sous nos regards joyeux, quelque chose d'humain !"
- "Quoi qu'il en soit, reprit doucement le vieux pâtre,
Ton appel à la joie est d'un bon cœur. Mais quoi !
N'est pas joyeux qui veut. Les tristes, comme moi,
Ceux que la vie amère a traités en marâtre,
Vivent sans espérance et ne sauraient s'unir
A ta jeune gaîté qui rit à l'avenir.
- "Je pensais comme toi, lorsque j'avais ton âge.
J'admirais tout : le ciel, la mer, le bois sauvage ;
De l'amour, comme toi, je rêvais la douceur ;
Enfin, ainsi que toi, juvénile chasseur
Je battais les buissons, quêtant les mêmes proies.
Et j'ai fait buisson creux... - Hélas ! où sont les joies
Dont je voyais alors, au rayon matinal,
L'essaim charmant s'ébattre et danser, au signal
Que leur jetait du ciel l'alouette en délire ?
Où sont-ils ces transports que la jeunesse inspire,
Ces longs enivrements ressentis tant de fois
Quand, au déclin du jour, j'errais au fond des bois ?...
Ainsi qu'un vert bouton se fane avant d'éclore,
Ainsi que la rosée au soleil s'évapore, -
Tout cela s'est flétri, tout cela s'est séché,
Et dans mon dur sentier, triste et seul, j'ai marché.
"Pauvre, et de m'enrichir n'éprouvant nulle envie,
Mais jaloux de rester un homme honnête et droit,
J'avais l'ambition, quand j'entrai dans la vie,
De m'y faire au soleil la place où j'avais droit.
J'y tâchai de mon mieux : d'autant qu'à mon estime
J'avais à réussir un titre légitime,
Le talent - En tout cas (car j'en doute aujourd'hui),
Je me sentais au cœur l'inébranlable appui
D'une âpre volonté, de ses efforts prodigue,
Et qui ne reculait devant rien - que l'intrigue.
"Mais que ce fût l'intrigue ou non, - vice ou vertu,
Quelque don précieux dut me manquer sans doute :
Car, après maint obstacle évité sur ma route,
Au moment décisif, je fus toujours battu.
Oui, c'est à l'instant même où ma juste espérance,
Comptant sur le succès, en jouissait d'avance,
Que toujours quelque heurt survenait, imprévu,
Qui me désarçonnait près du but entrevu...
Mais à quoi bon poursuivre une plainte importune ?
L'amour ne me fut pas moins dur que la fortune :
Et j'en vins à conclure, abreuvé de dégoûts,
Que, dans ce monde amer où nous gémissons tous,
II n'est pas un amour - si pur qu'on le suppose -
Qui nous paie en bonheurs les chagrins qu'il nous cause !
Et pourtant ce doux mal, cet indigent trésor
Est tout ce que la vie a de meilleur encor...
Quant au reste, ce n'est qu'une plate imposture.
"Vois ! j'ai quatre-vingts ans : j'ai fait tous les métiers ;
J'ai laissé de ma laine, en courant l'aventure,
Aux cailloux des chemins, aux ronces des sentiers ;
Dans les camps, sur les mers - où gronde un double orage,-
J'ai nargué la mitraille et bravé le naufrage ;
J'ai du pôle au tropique erré sans trêve, eh bien !
Durant tout ce stérile et douloureux voyage,
Je n'ai jamais trouvé rien d'innocent - mais rien ! -
Que mes brebis, jeune homme, - et de bon que mon chien."
Comme s'il eût compris ce que disait son maître,
Le chien, se détachant du troupeau qu'il fait paître,
S'approcha du vieil homme, et lui mit dans la main
Sa grosse tête où luit un regard presque humain.
Le pâtre ému paya d'une lente caresse
L'humble ami qui proteste ainsi de sa tendresse ;
Puis, brandissant ses poings et défiant le sort,
II cria d'une voix désespérée :
Toi, du pauvre la seule amie et la meilleure !
0 mort, quand donc viendra l'heure que j'attends, l'heure
Bienheureuse où, pauvre être affamé de repos,
Dans l'ombre, près de toi, j'étendrai mes vieux os !
Les riches, les heureux tremblent, quand ta main rude
Les arrache aux plaisirs dont ils font leur étude ;
Mais pour l'infortuné, las enfin de gémir,
Oh ! quel soulagement quand tu viens l'endormir !"
Et, sans un mot de plus, le sombre patriarche
Rassembla ses brebis, et se remit en marche.
Pour moi, surpris d'abord de son brusque départ,
Je lui criai, pendant qu'il s'éloignait :
Dans quelque cinquante ans, si Dieu me prête vie,
Peut-être inclinerai-je à ta philosophie.
Quant à présent, - j'en crois l'exemple du pinson."
Et rappelant soudain ma belle humeur enfuie,
Je repris , le pied leste et l'âme épanouie,
Ma course, - en me chantant cette allègre chanson.
"L'aube s'éveille, et l'alouette,
Lance un chant que mon cœur répète
Dans la nature et dans mon âme
Tout germe et fleurit,
Tout chante et sourit :
|
Tout est parfum , caresse et flamme !
Amour, Amour, je te réclame !
Voici le printemps,
Et moi j'ai vingt ans.
|
|
"S'il faut au cours lent des années
Avant que les fleurs soient fanées,
Au vieillard qui me désenchante
La vie et l'amour,
Je puis croire un jour, -
|
Mais aujourd'hui l'amour m'enchante
Aussi je ris, aussi je chante :
Gloire au gai printemps,
Joie à mes vingt ans !
|
|
|
[entoilage : Sabrina Leriverend,Terminale littéraire, 22 mars 2001]
|