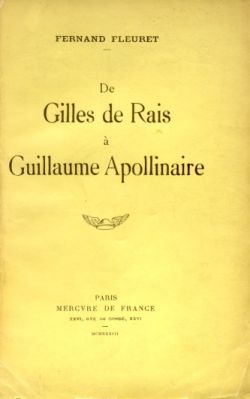|
Fernand Fleuret (1883 - 1945) |
|||||||||||||||
« Coutances et Remy de Gourmont », De Gilles de Rais à Guillaume Apollinaire, Mercure de France, 1933.
« Placé entre la Haye-du-puits, écrivait Barbey d'Aurevilly de la Lande de Lessay, ce désert normand où l'on ne rencontre ni arbres ni maisons, ni haies, ni traces d'homme ou de bêtes que celles du passant ou du troupeau du matin dans la poussière s'il faisait sec, ou dans l'argile détrempée du sentier s'il avait plu, déployait une grandeur de solitude et de tristesse désolée qu'il n'était pas facile d'oublier. La Lande, disait-on, avait sept lieues de tour. Ce qui est certain, c'est que, pour la traverser en droite ligne, il fallait, à un homme à cheval et bien monté, plus d'une couple d'heures. Dans l'opinion de tout le pays, c'était un passage redoutable. Quand de Saint-Sauveur-le-Vicomte, cette bourgade jolie comme un village d'Écosse, on avait affaire à Coutances, on s'associait à plusieurs pour passer la terrible lande... On parlait vaguement d'assassinats qui s'y étaient commis à d'autres époques... Mais, ce n'était pas tout : si l'on en croyait les récits des charretiers qui s'y attardaient, la Lande de Lessay était le théâtre des plus singulières apparitions. Dans le langage du pays, il y revenait... C'était là le côté véritablement sinistre et menaçant de la lande... » Depuis Barbey, des pins ont été plantés, des haies séparent des champs, des buissons ont cru au bord de la grand'route qui remplace le sentier. C'est ainsi que la Lande m'apparut, dans mon adolescence, quelque peu civilisée. Mais, aujourd'hui, elle ne présente plus cet aspect à demi-hirsute qu'elle montrait encore voici trente ans, et les attaques à main armée, déjà rares, ne défrayent plus la chronique. Des moissonneurs y fauchent l'avoine et le blé. Des vaches y pâturent. Les petites filles les y amènent et viennent les rechercher. Elles vous saluent au passage. Des maisons se sont élevées de loin en loin, et un parc d'aviation y dresse un vaste hangar. En moins de deux ans, la Lande sera recouverte d'habitations et de cabarets. Peut-être y fera-t-on passer des trains. Pour le moment, la bruyère y fleurit à profusion; le nénuphar laisse flotter sur les eaux sa petite coupe de porcelaine; sans souci du promeneur, les canards sauvages volent en triangle à dix mètres du sol marécageux, et les lapins traversent la route sans trop de hâte. Mais j'ose dire que la Lande s'est singulièrement raccourcie depuis Barbey, qui voyait grand, car « un homme bien monté » et marchant à l'amble la traverserait en moins d'une heure : calculez la section médiane d'un cercle de sept lieues... Une automobile y met quelque dix minutes si ses occupants prennent le loisir de regarder le paysage. On pourrait soupçonner Barbey d'avoir dramatisé son tableau. Cependant, le grand patoisant Louis Beuve, notre contemporain, a évoqué la Lande sous un aspect à peu près pareil. En dix ans, l'homme modifie ou recrée un site. La Nature n'a pas le visage immuable que les poètes voudraient lui conserver : elle est aussi l'œuvre utilitaire des hommes, et n'y toucheraient-ils pas que les arbres, les boqueteaux, les belles allées de verdure mourraient quand même comme nous, et sans plus laisser de traces. « Les citadins, dit Remy de Gourmont, qui, dans leur exode vers les plages, traversent... la Normandie, s'imaginent volontiers que ce pays d'arbres, d'herbe et de blé eut toujours cette figure ; ils la trouvent riante et bénissent la Nature. C'est l'homme ici qu'il faut admirer : il a fait, avec la Nature, qui est une matière, ce que l'architecte fait avec des pierres : une construction. La Normandie, c'est un pays défriché ; on y défriche encore et j'ai vu disparaître de vastes étendues d'arbres qui, déjà, prennent l'aspect des plus vieilles terres cultivées. » « C'est une souffrance, dit-il plus loin, de voir un beau paysage gâté par une main maladroite ou avide, mais il faut bien nous dire que cette intervention est inévitable ; que l'aspect présent des choses n'est qu'un moment dans l'évolution ; qu'hier elles étaient différentes, et que demain aussi elles seront différentes. » Gourmont admirait Louis Beuve. Il trouvait que sa Grand-Lande était un chef-d'œuvre, et que, même transposée en français, c'était encore un beau morceau de poésie. On connaît les diverses descriptions romantiques de Barbey, mais on connaît peu, ou pas assez celle de Beuve, du moins en dehors de la Normandie. Nul mieux que lui n'en a rendu la désolation et la grandeur. Puisque ces beautés doivent disparaître, qu'elles le sont plus qu'à demi, mais qu'il est encore temps de les attester, laissons résonner la vielle mélancolique du poète ; autrement, en moins de dix années, on pensera que, pareil à Henri Heine et Guillaume Apollinaire, qui ont chanté la Loreley, il a déformé son sujet, que son imagination brillante s'est enflammée sur une légende, qu'enfin il n'avait pas pris contact avec le réel. « J'ai vu ça », disait Goya. J'ai vu ça, ou presque : Louis Beuve n'a pas amplifié. LA GRAND-LANDE DE LESSAY Le Bon Dieu t'a bien mise à sa place, Lande, posée là comme un mur pour préserver le pays du Nord, qui parle le pur patois, du voisinage de ceux du Sud. Reine des fées au dur visage, reine des goubelins que l'on redoutait, c'est toi qui gardes les vieux usages des hommes du nord aux blouses de droguet, ô ma belle Lande, grande comme la mer, ô ma Grand-Lande de Lessay ! Gueuse généreuse autant que ladre, tu bailles la tourbe aux malheureux, mais tu permets qu'on assassine ceux qui possèdent des écus ! Fantôme terrible dans tes colères, autrefois, quand à la nuit noire on revenait à Coutances, dès la côte du Bigard, le plus hardi tremblait devant toi, ô ma belle Lande, grande comme la mer, ô ma Grand-Lande de Lessay ! Oui, par les sombres nuits, lorsque court le varou, lorsqu'on entend les vents gémir (1), lorsque les pauvres gens en voyage font devant toi le signe de la croix, c'est en vain que le phare de Carteret qui s'allume t'envoie le sourire de son éclair : tu demeures triste sous ton manteau de brume, et rien au monde ne te distrait, ô ma belle Lande, grande comme la mer, ô ma Grand-Lande de Lessay ! Grande milloraine (2) désolée, tu ne souris qu'une fois tous les ans, lorsque la foire de la Sainte-Croix amène à pleines carrioles nos gens sur la bruyère. Tu troubles alors la solitude de la vieille Abbaye par les beuglements de tes dix mille bœufs ; et, pendant les trois jours de folie, le riche Cotentin lui-même n'a pas ta fierté, ô ma belle Lande, grande comme la mer, ô ma Grand-Lande de Lessay ! Il me souvient de ces belles journées, quand nous arrivions la veille au soir, et que le feu des tentes montait bien doucement dans la nuit, pareil à une gerbe géante. Mais, quand venait la fin des vacances et que l'on s'en retournait vers le collège, tu te déroulais devant moi comme un regret qui ne finit pas, ma belle Lande, grande comme la mer, ô ma Grand-Lande de Lessay ! Semblable à une vieille mendiante fatiguée qui vous tend la main sous les tentes, mon âme, ô Lande de ma jeunesse, revient te demander l'aumône d'un souvenir. Je te ressemble, car toutes les joies, à présent, ne durent pas en moi, et ma pauvre âme tourmentée est restée triste tout comme toi, ô ma belle Lande, grande comme la mer, ô ma Grand-Lande de Lessay ! Par sa concision, sa légèreté et sa noblesse de ton, ce poème n'égale-t-il pas les plus parfaits des âges classiques ? Louis Beuve, peut-être sans le vouloir, a renouvelé l'Antiquité, dans la langue vernaculaire des bouviers et des maquignons. * Si la Lande, pour le poète patoisant, est une frontière linguistique, elle est, pour le voyageur, le grand repoussoir de Coutances, et fait désirer davantage la vision aérienne des hautes flèches de sa cathédrale au-dessus d'un océan de verdure. La Bruyère a donné son impression de Coutances, mais elle n'est que celle d'un passant : J'approche d'une petite ville, et je suis déjà sur la hauteur d'où je la découvre. Elle est située à mi-côte, une rivière baigne ses murs et coule ensuite dans une belle prairie; elle a une forêt épaisse qui la couvre des vents froids de l'Aquilon. Je la vois dans un jour si favorable que je compte ses tours et ses clochers : elle me paraît peinte sur le penchant de la colline. Je me récrie et je dis : quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans ce séjour délicieux ! Je descends dans la ville, où je n'ai pas couché deux nuits que je ressemble à ceux qui l'habitent; j'en veux sortir... Et le moraliste de souhaiter « une petite ville qui n'est divisée en aucuns partis, où les famille sont unies, ... d'où l'on a banni les caquets, le mensonge et la médisance » (De la Société, V). On pardonne au nouveau Théophraste en faveur de ce passage si charmant et si juste : « elle me paraît peinte sur le penchant de la colline ». C'est ainsi qu'apparaît Coutances quand on arrive, non de Lessay, mais de Granville, et qu'elle m'apparaissait surtout autrefois, lorsque nous rentrions au collège, le jeudi et le dimanche, à la fin de l'après-midi. Souvent, un arc-en-ciel enjambant la Soulle, qui coule dans la plaine, embellissait le tableau. Par ses vives couleurs, par l'artifice qu'il ajoutait à la nature, il faisait vraiment croire que ce beau paysage citadin fût peint sur la colline... Mais Coutances est autre chose qu'une ville mesquine de caquets et de médisances. C'est faire une injure gratuite à son passé magnifique que d'évoquer à son sujet « les Provinciaux et les sots, toujours prêts à se fâcher, à croire que l'on se moque d'eux ou qu'on les méprise » ; que de conclure, enfin, « qu'il ne faut jamais hasarder de la plaisanterie, même la plus douce et la plus permise, qu'avec des gens polis et qui ont de l'esprit ». Les plaisanteries présomptueuses d'un La Bruyère même, le mépris d'un homme de cour n'ont certainement pas touché les Coutançais de jadis. On dit encore : fier comme un Coutançais, et Coutances comme l'écrit Louis Beuve, dans la Lettre à la Morte, se révèle autrement plus altière ! Ecoutons encore le noble barde du pays : Un souvenir guerrier s'élance de ces rues posées quasi droites comme des échelles d'assaut, et de cette ruée de titans qu'une cathédrale de maisons soulève. Cette ruée, cette bataille de la terre vers la nue, l'entendez-vous, ô Normands, quand, par les lundis affairés, vos carrioles, en file, papillonnantes de bonnets fleuris, rapidement dévalent, et que les ateliers des meuniers, dans le bruit des freins que l'on serre, font frémir les grelots des gorgères par soubresauts joyeux ? L'entendez-vous ? C'est votre Histoire qui chante, en lançant, comme Taillefer, vers le ciel, son épée ! C'est la conquête de l'Angleterre : l'évêque Geoffroy de Montbray, mitré du heaume, passant en revue les troupes du Cotentin, garde d'honneur de Guillaume... Entendez-vous ? Aux pieds des enfants de Coutances s'agenouille l'Orient ! Ce sont, sous leurs manteaux de rois, les Guiscard, les Roger de Sicile, les Tancrède de Jérusalem, les Bohémond, tous les conquistadors de chez nous qui chevauchent... C'est la petite capitale gallo-romaine, devenue pompeusement normande, qui charge ses épaules du plus riche manteau de gloire que l'on puisse imaginer... Coutances est mieux qu'un décor d'éventail... Coutances est une épopée ! Ce bourdonnement, cette rumeur de gloire étaient encore plus grands lors de la jeunesse de Beuve, quand les « traînes à bois » cahotaient encore les jours de marché. Ces traîneaux attelés, qui véhiculent surtout les fagots et broyent parfois sur leur passage les paniers et les bottes d'ognons, ont servi à la construction de la cathédrale aux temps héroïques de Geoffroy de Montbray et de ses successeurs, qui épuisèrent en dentelles de pierre la donation des aventuriers de Hauteville-la-Guicharde. J'ai voulu rechercher dans les prés de Hauteville le pan de mur qui survit, dit-on, au manoir de Tancrède, d'où sont sortis douze conquérants, et, parmi eux, ce Robert Guiscard, qui est l'Agamemnon de l'Iliade normande sur les plages de Sicile et de Céphalonie, l'antique Samos, dans la mer Ionienne. Je m'égarai plusieurs fois avant de découvrir le berceau des douze Preux, un village de quelques maisons et d'une vieille église perdu dans une forêt verdoyante et traversé de chemin inextricables. Une aubergiste m'indiqua la voie et me dit qu'il n'y avait plus « ren de ren ». Pourtant, quelques personnes ont vu ce pan de mur que je n'ai point trouvé, et qui n'est peut-être lui-même que le vestige d'une étable dans le coin d'un champ. Un manoir composite, où le XVIIe siècle se marie gauchement au moderne, marque, je veux le croire, l'emplacement de l'ancien nid des Aigles. Mais, à part cette intuition, rien ne me parla des Tancrède, au milieu de cette terre grasse et de cette verdure si dense qui recouvrent le passé et la mort avec un énergie vivace. Je ne pus même imaginer l'exode des douze fils et de leur centaine de pauvres gentilshommes vers la lointaine Italie, et le combat du neveu de Robert avec Clorinde se refusa à ma mémoire. Pourtant, au collège de Coutances, comme je m'étais enivré du Tasse en cachette, apprenant par cœur des chants entiers de la Jérusalem, dans une langue que je ne comprenais pas, mais qu'il me suffisait de trouver brillante et sonore !.. Alors, je me répétai les mots de l'aubergiste : « il n'y a pus ren de ren ! » Que de fois ne me sont-ils pas venus aux lèvres, comme un glas mélancolique, dans cette Normandie que je ne reconnais déjà plus, soit que l'homme et les usages l'aient modifiée, soit que le renouvellement de l'être ait élevé sur le souvenir, comme sur le champ de Hauteville, des accroissements qui me dérobent à moi-même. Si rien ne subsiste des Tancrède à Hauteville, les statues de ces « pères des Monarchies » ont disparu de la cathédrale, qui fut élevée grâce aux pillages de Robert et peut-être avec une partie du butin de Rome. Leurs cendres et celles de leur lignée reposent en terre lointaine ; du moins, je sais que celles de Robert sont à Venouse, celles du héros du Tasse à Antioche, celles de Bohémond dans la Pouille, en un lieu « duquel je ne sais pas le nom », comme il est dit dans la Ballade des Seigneurs du Temps Jadis. Mais ne pourrait-on exhumer de Venouse la dépouille de Robert Guiscard, afin qu'elle dormît à l'abri majestueux de son œuvre, cette cathédrale aussi svelte et fière que son épée ? Ou peut-être vaut-il mieux qu'il en soit ainsi, pour illustrer, une fois encore, le vanitas vanitatum du roi Salomon, qu'une paysanne de Hauteville traduit, sans le savoir, par « pus ren de ren », et que j'entendrai désormais dans le tintement des cloches quand le soir tombe avec l'Angelus. Ilz sont tuits morts, ce monde est chose vaine ! Et moururent Féret et Gourmont, le premier, mon plus grand ami et le plus grand poète moderne de sa province; le second, le plus attrayant sophiste de son temps, et, après Moréas et Anatole France, le plus grand écrivain. Le souvenir de Féret n'est pour moi lié à Coutances que par trois vers de la Normandie Exaltée, l'un où il dépeint « les pastels de son ciel pâle », et qui est d'une justesse étonnante, surtout pour un homme qui ne voyait rien du monde extérieur ; les deux autres en l'honneur du grand évêque qui bénit l'armée de Guillaume à Dives. Ils sont d'une musique délicieuse, un peu estompée comme les pastels dont il parlait ailleurs et qui leur est assortie : C'est Geoffroy de Montbrey, dont la gloire volette, Que ce nom de Coutances est beau dans un vers, comme celui de Florence, avec lequel il rime ! Mais il y a mieux entre Coutances et Florence qu'une parenté de son. C'est Raoul Dufy qui a baptisé Coutances la Florence normande, un beau matin d'été que je lui faisais visiter le jardin public et qu'il avait admiré la cathédrale. Je pense qu'il les associait dans son esprit à Santa Maria dei Flori et le parc des Cascines, encore que rien de tout cela ne se ressemble, sauf certains airs de noblesse, alliés à la rêverie et la discrétion, et aussi quelque chose d'éthéré dans l'atmosphère, que l'on ne respire qu'en ces deux villes. Le jardin de Coutances, tout en terrasses, est délicieux. La bénignité du ciel y favorise ou tolère l'oranger, le magnolia, le cèdre du Japon, le palmier, le bananier et autres plantes exotiques. La grande allée centrale, bordée d'héliotropes nains, de bégonias, de roses, de pois de senteur et de mufliers multicolores, est un chef-d'œuvre qui eût ravi le Prince de Ligne. Au reste, tout est là XVIIIe siècle, derrière le petit hôtel délabré et mi-recouvert de glycines, qui sert de Musée. La cathédrale dresse ses hautes tours au-dessus des arbres ; les fleurs naissent et meurent au son de ses cloches. Oui, ce jardin est si loin du monde, encore qu'il touche à la rue, que l'on est tenté de rapporter les glas et les carillons à la vie et à la mort des roses ; que l'on croit que la vibration des uns les effeuille si la vibration des autres les ouvre doucement au jour. Et comme la rose est le motif de décoration normande le plus répandu de la cathédrale, l'on pense aussi que les roses qui meurent vont rejoindre leurs sœurs de pierre dans une immortelle félicité, et pour la plus grande gloire de Dieu. Au centre, un obélisque érigé en mémoire du donateur ne rappelle pas celui-ci, malgré l'inscription de reconnaissance des bons citadins. Pour moi, il commémore la plantation du plus vieil if, qu'un chirurgien de marine a rapporté dans son chapeau, cent ans avant la naissance de Francis Jammes à Orthez, et sur le déclin de l'abbé Delille. Le jardin expire au bord de la route ; mais si l'on ne descend pas jusque-là, les hautes futaie qui reprennent de l'autre côté laissent croire qu'il se prolonge et se perd au loin, abritant des Gilles, des Indifférents, des Finettes, et autres personnage de Fêtes Galantes, Jouant du luth, et dansant, et quasi Raoul Dufy et moi avions vainement cherché dans la ville le monument de Remy de Gourmont. Ne le découvrant pas davantage dans ce jardin, nous demandâmes en sortant sur quelle place nous le pourrions trouver, afin de déposer une rose sur sa stèle. Il nous fut répondu que nous l'avions passé près du grand bassin. « Craignez, écrivait Gourmont pour ses contemporains, d'avoir frôlé du coude l'homme de génie sans vous en être seulement aperçu ! » Gourmont est là, caché dans l'ombre verdière. Il ressemble au vieux Faune chanté par Verlaine « qui sourit à ces instants sereins », et il ne manque à sa stèle que l'ornement phallique. Il tient encore de Saint-Evremon[d], avec qui il avait aussi quelque ressemblance d'esprit et de style, et qui, d'ailleurs est de Saint-Denis-le-[Gast], dans la Manche. A sa droite est un frêne pleureur qui a l'air d'une dame à crinoline, et à sa gauche un aubépin qui voisine avec un houx. « Simone, le soleil luit sur la feuille du houx », soupirait Gourmont qui avait, toutefois emprunté ce vers à Saint-Amant. Voilà, avec les sophoras et les cèdres qui lui font vis-à-vis, pour les « compagnons de son triste cœur ». Il y a aussi les héliotropes, les géraniums et les roses, « fleurs hypocrites, fleurs du silence », qui fleurissent à ses pieds et ses côtés. Mais il y manque la fougère qu'il aimait tant et que certains poètes de la gauloiserie, disait-il, ont déshonorée. Rien n'est plus beau que la fougère de la Manche et de l'Orne, en effet. C'est la plante des solitudes de Lessay, de Mortain et de la Basoche-en-Houlme. Elle forme une mer houleuse de verdure, mais à la houle immobile. Avec elle pousse l'airelle-myrtille qui noircit les lèvres et que les enfants rapportent enfilées d'une avoine. Sur elle dansent les elfes au tintement de leurs grelots et sans faire ployer sa tête, par les belles nuits de lune qui glacent d'argent son feuillage. Elle semble tenir de la plante et de la bête, et elle connaît les maléfices des sorcières, ayant reçu la semence du Diable. Ce sont les raisons que je trouve au bout de la plume qui la faisaient aimer de Gourmont... Néanmoins, ce n'est pas là que j'aurais placé le buste de l'auteur des Promenades Philosophiques, devant ce bassin d'eau morte qui, pourtant, convient si bien à sa rêverie, avec ses nénuphars et ses cyprins décolorés et monstrueux, passant et repassant comme les images inlassables d'une délectation morose. C'est à gauche, plus loin, tout en haut du Labyrinthe ou Colimaçon, qui, pour moi, représente la pensée de Gourmont, inaccessible au commun, habile en détours, trompeuse, spécieuse, contradictoire et secrète par pudeur, par timidité, surtout par orgueil. Il eût dominé ce labyrinthe avec ironie, mais non sans amertume, celle-là même qui fut le poison de son orgueil, l'orgueil qui l'avait retiré du monde. Trop tard, quand il y descendit, il était trop tard ! Vous le savez, Amazone !... Oui, toute la vie de Gourmont fut ce drame. C'est pourquoi je le voudrais là-haut, tel qu'en lui-même enfin la Critique le change. Je veux dire que, lui mort, on ose maintenant le juger. De son vivant, il gardait un prestige si altier que nul parmi nous n'aurait osé le faire. Il était notre maître, ce que fut France pour ceux qui nous avaient précédés. Mais rien de ce que je viens d'écrire ne tend à le diminuer. Au contraire : nous qui le croyions livresque, nous découvrons, à la suite de Paul Escoube, que Gourmont était un homme sous des masques divers. Lui qui ne fut pas simple prêchait la simplicité ; lui qui fut anarchiste, ou du moins libertaire, cherchait des lois dans la Biologie qu'il avait découverte. Avez-vous lu Baruch ? Les lois de la Biologie sont des lois plus féroces que celles des sociétés, qui, du moins, tentent de vaincre la Nature par la Civilisation. Mais Gourmont ne s'y serait pas soumis. Elles étaient bonnes pour les autres, non pour cet aristocrate ! Les lois de la Biologie mènent à l'apologie de la Guerre et à l'asservissement des faibles par la brute. Elles ont conduit Quinton à un livre posthume qui serait ridicule par sa mauvaise rhétorique, s'il n'était monstrueux par la pensée qui l'anime. Déjà, de son vivant, au nom de la Biologie, Quinton tuait les gens avec des injections d'eau de mer... Mais la loi biologique qui séduisait le plus Gourmont, et qui pour lui n'était pas loin de représenter toute la Biologie, c'était celle de la reproduction, en somme, de l'Amour. Grâce à cette loi, il avait découvert que le but de la Nature n'était que la multiplication des espèces, et que tous les autres concordaient avec elle. Les religions sont d'accord là-dessus ; la chrétienne nous dit : Croissez et multipliez. Cependant, par une de ces contradictions qu'il revendiquait inlassablement comme un des droits du philosophe, il prétendait que le véritable amour est l'amour sans contact, celui de Dante pour Béatrix et celui de Pétrarque pour Laure. Encore une fois, vous le savez, Amazone !... Il n'y avait au fond de ce pétrarquisme que de la sensualité exaspérée, ou du mysticisme, ce qui revient au même. Pour tout dire, c'était encore un masque de l'auteur du Livre des Masques... Il a écrit que la véritable patrie est celle où l'on éprouva les premières sensations fortes. Né en Normandie, il y avait ressenti ces sensations, et il aimait sa race et sa province. Tout est normand en lui, depuis ses origines, puisqu'il descendait de Cormon, le roi scandinave, jusqu'à son art. Il avait épuré et simplifié son style comme son autre ancêtre Malherbe, et pour mieux nous convaincre, ce qui est encore très normand ; mais, au temps de ses premiers livres, on retrouvait en lui l'amour des mots rares, des parures et des bijoux somptueux ou singuliers, de l'orfèvrerie, des broderies éclatantes, de la basse-latinité et de l'imagerie de couleurs vives. Ainsi Flaubert et Barbey d'Aurevilly, qu'il aimait beaucoup. Ainsi Féret, qu'il aimait aussi et qui l'amusait. Ainsi Beuve, qui écrit en patois pour la sonorité des mots, qu'il ne choisit pas au hasard. Oserai-je parler de Jean Lorrain, qui portait des bagues à tous les doigts, et qui, dans son ignorance, se croyait byzantin ? Cet amour de l'éclat et de la parure est un héritage des Vikings. Il y a plus de vingt ans, lorsqu'on parlait de Gourmont, l'on prétendait qu'il vivait retiré et n'ouvrait qu'un petit guichet à de rares visiteurs, qui ne l'apercevaient qu'à peine dans la pénombre; qu'il laissait passer une belle main ornée d'une améthyste épiscopale, et qu'il était revêtu d'une soutane violette. Légende ! Elle cadrait pourtant avec une partie de son œuvre, Les Saintes du Paradis, Lilith, Théodat et le Latin Mystique, et il a écrit qu'il aurait voulu être un prélat de la Renaissance, dans une petite cour d'Italie. Il portait, cependant, une robe de camaldule et une petite calotte ecclésiastique, tout ce qui lui restait de la religion, dont il avait aimé, les hymnes, les églises et les rites. Là encore, je découvre une preuve racique, le même amour de l'éclat qui fit construire aux chefs scandinaves les premières églises, comme à Robert Guiscard la cathédrale de Coutances, lui qui fit le pape prisonnier. Mais je ne suis pas loin de croire que les Vikings ne considéraient pas la religion sans une certaine crainte superstitieuse qui la leur faisait assimiler à la magie, et, qu'en honorant ostensiblement le Dieu des vaincus tout en priant secrètement Odin, ils ne cherchaient pas à concilier deux puissances contraires. De même les Tancrède, en se croisant, conciliaient le temporel et le spirituel. Pour Gourmont, il prisait à la fois la Religion et la Magie, bien qu'il fût profondément athée, et c'est peut-être ce mélange qui le poussa vers un écrivain comme Huysmans, qui n'avait rien d'autre pour le séduire. Quand Paul Léautaud reproche à Gourmont cet assemblage un peu enfantin, dit-il en substance, de religion et de paganisme, il ne songe pas, ou ne sait pas, qu'il le tient de loin, mais que le goût puéril du blasphème n'y entre pas ? Aujourd'hui, Gourmont médite à l'ombre de la cathédrale et sous le bronze sonore de ses cloches. Il rêve aussi devant ces poissons qui paraissent être de mauvaises pensées et qui nagent dans une eau trouble. La sculptrice, qui le connaissait bien par son frère Jean, a-t-elle choisi tout exprès cet endroit, ou le hasard a-t-il voulu que dans la mort il eût la même attitude que dans la vie ? Là, me dit-on, il est près de la maison familiale, où il vint se reposer avant de mourir. Il s'asseyait dans le jardin qui est contigu au jardin public, et contemplait les travaux des fourmis pendant de longues heures, une planche sous les pieds pour se garder de l'humidité. Encore la Biologie ! Mais je préfère évoquer Gourmont tel que je l'ai connu, dans une petite pièce du Mercure de France, où il venait s'asseoir, à partir de cinq heures, avant de monter régulièrement à six pour causer avec Alfred Vallette. J'y venais moi-même plusieurs fois par semaine. Je n'avais que vingt-deux ou vingt-trois ans. J'avais déjà reçu une lettre de Gourmont me remerciant des Friperies avec quelques éloges qui m'avaient fait battre le cœur. Car je n'écrivais que pour mériter un jour le suffrage d'un homme que je jugeais d'un goût si difficile et qui me paraissait être le premier des écrivains, le Régent des Lettres contemporaines. Sur la foi d'une photographie publiée dans la première Anthologie des Poètes Normands, je m'étais imaginé Remy de Gourmont sous les traits d'un bel homme barbu et coiffé d'un feutre romantique un peu de guingois sur l'oreille, et je souffrais pour lui qu'une maladie cruelle eût ruiné cette beauté mâle et décidée. Je ne sus que bien plus tard, par son frère Jean, que Remy, sollicité d'envoyer son portrait, s'était décidé pour celui de Francis Jammes... Pauvre Gourmont qui souhaitait encore de faire palpiter le sein des inconnues et de se soutenir dans l'admiration intolérante des jeunes gens ! Un soir, je vis donc entrer Remy de Gourmont, que me désigna Van Bever à voix basse. Je me levai en tremblant devant un homme courtaud, rustique et défiguré, qui me tendit une grosse main sans pression. Il bégayait en soufflant, péniblement, et, à l'embarras de sa personne, je jugeai qu'il était encore plus timide que l'enfant que j'étais. Il prit le siège qui lui était toujours réservé en face de Van Bever, et, pour se donner un maintien, se mit à polir sa canne avec son mouchoir ! « Eh bien ! eh bien ! » me faisait-il de temps en temps, en levant sur moi des yeux admirables, des yeux d'un bleu de pervenche, tout chargés de rêve et de pensée. Eh bien ! je n'osais rien dire. J'étais stupide d'admiration et d'effroi. Notre timidité réciproque disparut à la longue, après plusieurs rencontres, et nous en arrivâmes à tenir des conversations d'une heure. Je compris qu'il ne fallait pas regarder Gourmont quand il parlait, sinon il bégayait davantage et finissait par se taire. Ces conversations avec un débutant étonnaient l'entourage, car Gourmont ne parlait à personne. J'en avais conclu qu'il était bon, qu'il voulait m'encourager. Une fois qu'il signait des exemplaires de presse, je regardai à la dérobée le livre qu'il venait de repousser et qu'il avait laissé ouvert pour qu'il séchât. Il avait écrit : A Anatole France, que j'aime. Guillaume Apollinaire fréquentait chez Gourmont. Il allait d'abord saluer Mme de Courrières, qui avait été la maîtresse de Clésinger, et qui, au dire du facétieux visiteur, était âgée de plusieurs centaines d'années. Elle se croyait en butte aux persécutions des carbonari, et montrait une balle logée dans le mur et qui lui était destinée. Elle croyait aussi à la Magie et racontait comment elle avait coupé le lien fluidique qui la tenait enchaînée à Gourmont. Après avoir entendu quelques folies de ce genre, Guillaume montait chez Gourmont et lui parlait de Nerciat, de l'Arétin, de Giorgio Baffo, du Marquis de Sade et de Restif de la Bretonne. Parfois Gourmont lui demandait de le mener au cirque ou au bordel. Avant que d'aller chez les filles, Guillaume prenait la précaution de prévenir la matrule, afin que ses pensionnaires fussent déférentes et de bonne compagnie devant le grand homme défiguré. Puis il commandait des gâteaux, des cigarettes et du champagne, qu'il payait d'avance de ses propres deniers, et il revenait chercher Gourmont, qu'il avait quitté sous un prétexte quelconque. Ainsi l'auteur des Lettres d'un Satyre pouvait-il passer, quelque temps au milieu de belles filles nues, qu'il se contentait de regarder en fumant et sans dire un mot, cependant que l'inventif et intarissable Guillaume faisait parler le bataillon de Cythère sur les vicissitudes de la vie et de l'amour. Puis ils sortaient ensemble ; près du Luxembourg, Gourmont demanda un soir à son compagnon de le laisser marcher seul. Guillaume, dissimulé dans l'ombre, suivit Gourmont à distance. Il le vit bientôt, rasant les grilles, porter derrière son dos une feuille de papier bien évidente, peut-être de quoi consigner ses pensées à la lueur d'un réverbère. De temps à autre, des filles se détachant de l'obscurité le rattrapaient pour le dévisager. Mais ensuite elles prenaient du large ou laissaient le rêveur les dépasser de son pas traînard et pesant. Apollinaire eut encore la curiosité de les questionner : ce papier était un billet de cent francs, que le poète au visage ravagé étalait comme un appât... Peut-être ce chef-d'œuvre si gracieux et si musical, Une nuit au Luxembourg, est-il le fruit d'une de ces promenades obsédées d'images voluptueuses. Mais qui pourrait dire les refoulements de cette douleur si noblement dissimulée, de ce cœur, dis-je, si bien fait pour l'amour, et pareil au cœur de Stendhal ? A plusieurs reprises, au temps des Lettres à l'Amazone, je rencontrai Gourmont qui se prélassait dans un fiacre découvert, un gros bouquet de roses sur les genoux et enveloppé dans du papier, le bouquet qu'on ne voit plus qu'au théâtre, dans les pièces comiques. Il rêvait aux anges et ne remarquait pas les saluts... Il marchait la tête rejetée en arrière, et, malgré la lourdeur de son corps et la petitesse de ses jambes, il ne manquait pas de noblesse. C'est ce que me fit remarquer un jour, sur le Boulevard Saint-Michel, Talassan Giafferi, qui est mort si jeune et n'a laissé qu'un livre, les Amants Raisonnables. « Regardez, me dit-il, comme nous marchions derrière, à plusieurs mètres de distance, regardez, il tient sa canne comme une épée : On dirait d'un grand capitaine ! ... » Et je songeai au vieux Robert Guiscard, dont Gourmont n'avait pourtant pas la taille... Il ne semble pas avoir beaucoup aimé Coutances. « La petite ville, écrit-il, serait un bon endroit pour vivre, si on savait encore goûter pleinement la monotonie des journées où tous les instants sont pareils, à peine différenciés par la qualité de la lumière. Il y a des matins, des midis et des soirs, mais il n'y a que cela. Ce sont des vases que l'âme doit remplir elle-même et dont elle-même crée la couleur et la limpidité, et même, quand elle a soif, la saveur. L'écueil d'un tel séjour, c'est l'ennui... » Cela revient un peu à La Bruyère, mais il y avait déjà tant de lassitude de la vie chez Gourmont ! Il n'aurait pas écrit de même au temps de Merlette, qui est un roman oublié, et peut-être son meilleur. Là, il est simple, naturel et frais comme les fougères de son pays. Il est vrai que « c'est nous-mêmes, a-t-il dit dans Idées et Paysages, que nous contemplons dans le spectacle des choses, nos souvenirs, nos désirs, nos habitudes ». Gourmont n'avait plus de désirs ; ses habitudes étaient ailleurs, ses souvenirs à la Bazoches-en-Houlme. C'est là, à la Bazoches-en-Houlme, dans le cimetière chanté par lui mezza-voce, qu'il aurait dû devenir « de l'herbe et des fleurs ». Mais c'est dans un caveau de Saint-Germain-des-Prés qu'il repose, et le Solitaire n'est pas seul. Par une bizarrerie du sort, à laquelle il serait peut-être décent de mettre fin, l'amoureux de Sixtine repose en compagnie de Mme de Courrières et de Clésinger ! La guerre, une épidémie ayant comblé les cimetières, on mit les trois amants ensemble, puisqu'il restait encore un peu de place. Le paradoxe aura suivi Gourmont jusque dans la tombe. Je parlais de décence, mais peut-être faut-il le laisser là, pour l'accomplissement, la conclusion de son destin... Quant à moi, je ne reconnais plus Coutances. J'avais laissé une ville triste qui ne me rappelait que la contrainte de l'étude et des sorties maussades, alignés que nous étions comme des soldats et sous la garde d'un pion famélique, qui s'est pendu de désespoir, et que nous appelions Jésus-Christ. Je retrouve une ville pimpante, aux volets ouverts, aux boutiques achalandées avec goût et peintes de couleurs vives. La tristesse d'une génération disparue de cagots et de vieilles filles avares n'est plus sur les visages. Ou peut-être ne les vois-je pas. A peine évoqué-je l'ombre de mon grand-père qui me conduisait au collège en penchant un front que j'encombrais de soucis, et qui me parlait de l'avenir d'un ton prophétique et menaçant. J'ai trop changé moi-même pour me reconnaître en cet enfant que l'on enfermait derrière une grille et qui se levait au son du tambour. Aurais-je mal vu Coutances, jadis ? le vois-je mal aujourd'hui ? Non, c'est le paysage-état d'âme. Pourtant, la voix taquine revient me résonner aux oreilles : Ya pus ren de ren ! pus ren de ren !... C'est-à-dire qu'il y a autre chose et que nous passons. Et voilà que me saisit le petit regret de ne pas me retrouver tout comme autrefois, de ne pas être l'enfant que j'étais, rempli de sanglots refoulés. O singulière contradiction ! Ah ! combien de dépouilles de soi-même faudra-t-il traîner comme des enveloppes de chrysalides, jusqu'au jour où nous aborderons la tombe ? Combien de cercueils pour un homme ?... « Coutances et Remy de Gourmont », De Gilles de Rais à Guillaume Apollinaire, Mercure de France, 1933 (1) Vyipâer, dans le texte, Viper, de l'anglais to weep, pleurer. Il n'y a aucune relation avec le sifflement de la vipère, comme paraît le croire l'auteur, dans sa propre traduction, et, avant lui, Barbey d'Aurevilly, dans la Vieille Maîtresse. Le mot est dans la Muse Normande, avec le sens de pleurer en poussant des cris. J'ai rencontré une autre forme dialectale, mais bourguignonne, viaper. (2) Fantôme, dame-blanche. Echos
Sur Fernand Fleuret, on lira avec profit l'ouvrage de J. de Saint-Jorre, Fernand Fleuret et ses amis, Imprimerie P. Bellée, Coutances, s.d. [1959 ?], dont voici un compte rendu paru dans le Bulletin de l'Association Amicale des Anciens élèves du collège-lycée de Coutances d'octobre 1959 :
Fernand Fleuret et ses amis
Notre camarade de Saint-Jorre a publié récemment un volume chez P. Bellée, imprimeur à Coutances. Bien que l'auteur soit chef cabinet au secrétariat d'état aux affaires économiques, il ne s'agit pas de quelque bouquin austère bourré de statistiques, mais de « Fernand Fleuret et ses amis » (1) Nous avons eu déjà l'occasion à l'exposition du centenaire du Lycée de voir les manuscrits, les éditions rares de Fleuret que possède notre camarade. Il s'agit cette fois d'une biographie complète de F. Fleuret qui fut, en 1899, élève de notre Lycée. Destin tragique puisque Fleuret mourut fou en juin 1945. « On lira dans le livre de M. de Saint-Jorre tout ce qu'il est important de connaître de la vie de Fleuret » dit dans sa préface M. André Billy, de l'Académie Goncourt. Certes la biographie de notre camarade est une étude fortement documentée qui fait revivre la figure originale de Fleuret et de ses nombreux amis, notamment Guillaume Apollinaire, Dufy, Billy, R. de Gourmont, Féret et enfin de Mme Gabrielle Réval, épouse de F. Fleuret, et qui eut son heure de célébrité avec « Sevriennes », roman paru vers 1900. Je ne puis que recommander à nos camarades la lecture de ce livre bien illustré, par ailleurs joliment écrit, mais on sait depuis Alphonse Daudet que la carrière préfectorale prédispose à la poésie et à la littérature. Mon propos sera plus modeste, je me bornerai à évoquer F. Fleuret élève de notre lycée. Voici ce qu'en dit de Saint-Jorre d'après une lettre du 24-5-36 adressée à M. P... « Je fus élève du lycée avec Garnier qui est devenu mon éditeur. C'était sous la férule de Lucas Girardville qui me mit hautainement à la porte au bout de 6 mois. 1°) pour avoir tiré un coup de pistolet dans la cour ; 2°) pour avoir percé le pot de chambre du pion ; 3°) pour avoir brisé la bicyclette du censeur, un jour que j'étais au cachot ; 4°) pour faire des vers ; 5°) pour ne rien faire d'autre ; 6°) pour avoir donné un coup de pied sur la tête de M. Héon, professeur de gymnastique et de géométrie ; 7°) pour avoir craché pendant 6 mois sur son paillasson le verre d'huile de foie de morue que j'étais obligé de prendre à l'infirmerie. Pour toutes ces bonnes raisons on me demanda, voici deux ou trois ans, de prononcer le discours de distribution de prix. J'eus la prétention de faire l'éloge du dernier. Alors on me pria de me tenir tranquille. Les pions n'ont pas la sens commun ». En 1934, je lus le livre de Fleuret « de Gilles de Rais à Guillaume Apollinaire », où se trouve un article sur « Remy de Gourmont et Coutances ». Il y parlait de Coutances, du lycée et d'un pion famélique qu'on appelait Jésus-Christ. Je lui écrivis et il me répondit par une lettre charmante (il habitait encore 11 bis, Avenue du Colonel Bonnet à Paris) où il évoquait les camarades qu'il avait connus en 1899 et son court séjour de six mois à notre lycée. Les causes de son renvoi sont celles plus abrégées indiquées par Saint-Jorre, mais il rappelle ses camarades « A.-P. Garnier, Gi[?] qui est resté à St-Pair, Boué tué à la guerre, Lainey et quelques autres dont les noms m'échappent, dit-il, sauf Godefroy officier de marine ». « Je me souviens très bien de M. Lerévérend qui m'avait donné 19/20 pour une composition d'histoire sur Mahomet. J'étais justement à côté d'Harrache qui me donnait des tuyaux sur le Transsibérien, composition pour laquelle j'obtins cependant zéro... Oui Paté et puis Jean Bart, professeur de physique, ... quant à Jésus-Christ il s'est suicidé pour deux femmes. Rien que cela ! qui l'eût cru ? ». Je n'ai pas personnellement connu tous les camarades de Fleuret sauf Boué et Godefroy dont le frère était mon condisciple. Je n'ai pas gardé le souvenir d'Harrache, mais rien d'étonnant qu'il ait pu tuyauter Fleuret puisqu'il eut un premier prix d'histoire au concours général. Par contre, j'ai parfaitement connu Giquel, dit Jésus-Christ, parce qu'il avait une barbe rousse. Il a été mon répétiteur chez les moyens. C'était un être assez singulier, taciturne, qui avait loué pour lui tout seul la grande maison située à côté de la chapelle de la Roquelle. Le loyer en était très modique car on disait la maison hantée. Hantée par ses maîtresses ? C'est possible. Toujours est-il qu'il s'est pendu. Vengeance des fantômes ou chagrins d'amour ? On ne le saura jamais. Tout ceci nous éloigne beaucoup de Fleuret écrivain et du livre de notre camarade de Saint-Jorre, qui vous permettra de mieux connaître l'auteur érudit d'une édition des Satires du 16e et 17e siècle et peut-être vous incitera à lire l'aimable, légère et fantaisiste « Histoire de la bienheureuse Raton, fille de joie ». (1) Un volume illustré, 3,000 F, chez P. Bellée, éditeur à Coutances. (Bulletin de l'Association Amicale des Anciens élèves du collège-lycée de Coutances, octobre 1959, pp. 2-3). [document communiqué par Georges Bottin, juin 2002] A consulter :
|