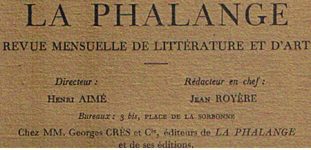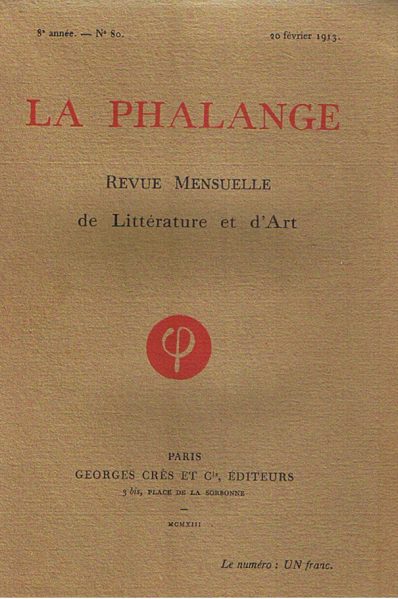|
La Phalange (15 juillet 1906-20 mai 1914) |
||||
|
15 mars 1908 Grain de raisin choisi à la vigne de la femme, tu vas vivre et tu seras un homme. Né de la luxure, tu aimeras la luxure, et, au jour de ta mort, tu pleureras d'entrer dans le royaume où elle n'entre pas, mais tu laisseras un fils qui répétera tes actes, miroir ressuscité où l'image que tu fus pâlira du même désir éternel. D'abord, tu auras chaud dans les eaux maternelles, et le sang de ta mère te gonflera d'amour : comme tu es bien en cet habitacle aveugle qui te fait participer à une vie charmante ! Ta mère est jolie. Tant qu'elle te méconnaîtra, tu seras bercé dans l'orage des valses et des chevauchées ; les jeunes filles presseront ingénues contre toi leur ventre pur, et le plaisir de l'homme, quand les nuits seront à moitié, viendra jusqu'au seuil de ta grotte choquer ton obscur sommeil de larve. Puis, un mouvement dira ta vie et tu deviendras le centre d'un monde. Des yeux tendres, à travers la terre et l'eau, te toucheront comme des antennes. On te couchera sur des chaises longues. Un jour, un tremblement prendra tes membres et ton cœur. Le lac vidé te laissera sec, et tu auras si peur que d'un tour de reins tu sauteras dans la vie. L'air est dur, tu crieras. Puis tu boiras, tu dormiras. Le jour où ta petite bouche rendra à ta mère un de ses dix mille baisers, elle aura des larmes dans les yeux, des larmes toutes pareilles aux larmes que tu arracheras aux yeux des autres femmes, car il n'y a qu'une qualité d'eau pour la diversité des yeux et des cœurs. Sorti de la femme, ton rêve adolescent sera d'y rentrer. Le ciel et la terre ne contiennent pas autre chose pour un jeune mâle. Tu féconderas la vigne dont tu es chu. Le grain enflé crèvera et tu verras l'image de ce que tu fus quant tu n'étais pas. Les vignes se fanent et les hoyaux s'ébrèchent, mais en voici d'autres et d'autres. De luxure en luxure se perpétue la vie. Les yeux devinent sous les robes les beaux triangles. Les ventres s'attirent, aimants, amants. Le flambeau de la vie, c'est celui que tu levais et qui tombe. Laisse à ceux qui sont sortis de toi le soin de la luxure éternelle. Songe au pauvre chaînon que tu es devenu. Songe aux socs et aux chocs, si tu veux. La charrue, la terre, songe à la terre. C'est là que vient mourir le chemin de la luxure. Iter ad luxuriam. Remy de Gourmont pp.798-799 [texte entoilé par Vincent Gogibu] 15 juillet 1908 - André du Fresnois, « Remy de Gourmont, Promenades philosophiques, 2e série », pp.164-166 20 avril 1910 - Jean Florence, « Remy de Gourmont et la dissociation des idées », pp. 520-537 & Le Litre et l'Amphore , Albert Messein, 1924, pp. 63-90 Que dire ? Qu'en penser ? Et qu'allons-nous faire ? Voici des propos tels que j'imagine que les pourraient tenir M. Delarue et M. Desmaisons au lendemain du jour — que je souhaite aussi lointain que possible — où M. Remy de Gourmont nous aurait quittés pour une destination inconnue. Par un effet d'une longue habitude et de la vitesse acquise, on peut admettre que ces deux excellents bonshommes continueraient de faire leur métier bimensuel et de gesticuler quelque temps après que la main du maître se serait retirée, telle une âme, de leur corps de guignolesques poupées. Je le regretterais, ai-je dit ; nous le regretterions tous. D'abord parce qu'il est dur de voir disparaître une vieille institution, parce qu'il est amer de renoncer à un plaisir invétéré, et puis aussi pour une raison moins égoïste qui est que les lettres françaises y auraient fait une grande perte et que, si bonne opinion que nous ayons de nous-même ou des autres, nous serions sûrs de ne pouvoir la réparer. Et serait-ce un deuil pour la littérature ? Les sciences et la philosophie seulement n'y devraient-elles pas prendre leur part ? Je ne sais trop, et me voici aussi embarrassé que tout à l'heure celui des deux bonshommes qui essayait de définir M. Remy de Gourmont. Il était obligé de s'y reprendre à plusieurs fois et de le prendre par chacun de ses multiples côtés à son tour. Et, comme on ne lui a pas laissé le temps d'achever une énumération fastidieuse, il n'a pu faire le tour de son objet. N'essayons pas de mener à bonne fin sa tâche interrompue. Nous ne serions pas bien sûrs d'achever demain soir, et, par quelque bout que nous le prenions, sachons dès maintenant que nous ne ferons jamais complète justice à M. de Gourmont. Si, par un procédé sommaire auquel ont recours les bibliothécaires embarrassés de dresser un catalogue, en désespoir comme un polygraphe, ce serait la meilleure façon de lui déplaire, ce qui n'est ni notre souci, ni notre crainte, ni notre intention, et la meilleure aussi, ce qui est plus grave, de dire ce qu'il n'est pas tout en disant ce qu'il risque parfois, sinon d'être, du moins de paraître. Il a su toucher à tout, en effet, sans être un touche-à-tout. Et si l'on veut son secret et voir comment il a accompli ce miracle, il faudra dire qu'il a eu des idées générales et que non seulement il en a eues, mais qu'il a su qu'il en avait, et combien ou à peu près il en avait et celles qu'il n'avait pas et pourquoi il ne les avait pas ou ne les voulait pas avoir ; qu'il ne s'est pas borné à les accueillir d'où qu'elles lui vinssent mais qu'il les a examinées et, pour tout dire d'un mot qui lui appartient, qu'il les a cultivées. S'il en a fait ainsi la critique et l'examen, s'il en a pratiqué la culture, c'est peut-être qu'il en avait le culte (1). Ici, on m'arrête, on me reprend, et pour deux raisons. On me reproche de faire un jeu de mots ; à quoi je réponds que ce jeu de mots n'est pas le premier dont je me rende coupable, et je promets de veiller, la Providence aidant, à ce qu'il ne soit pas le dernier. Un jeu de mots, dans ce que j'écris, est toujours ce qu'il y a de plus positif et de plus solide ; je ne me porte garant de rien de ce que j'avance ; mais je suis sûr de cela parce que précisément ce n'est pas moi qui l'avance, parce que le langage même me le suggère et me le dicte et parce que le jeu de mots est une révélation gratuite du langage que nous n'avons qu'à accepter docilement. Quoi que je fasse pour les rendre impersonnels, mes raisonnements m'appartiennent plus ou moins et participent de la fragilité et de l'insignifiance de ma personne. Mais quand je fais un calembour, je m'efface et c'est comme si je me taisais et c'est le langage qui prend la parole, en sorte que le calembour se produit à l'abri de son autorité universelle et séculaire. Tout le reste, je le donne sur ma parole ; mais le jeu de mots est parole d'Évangile. — Mais on a une autre raison, plus sérieuse, de croire que c'est trahir M. de Gourmont que de lui attribuer le culte des idées générales. « Ne voyez-vous pas, dit-on, que sa méthode étant de les dissocier, et son effort constant, de les rendre le plus qu'il peut concrètes, solides, précises et tangibles. M. de Gourmont, à supposer qu'il pût vouer un culte à quelque chose et nommément à des idées, du moins n'aurait-il jamais que celui des idées particulières ? » Et j'avoue que M. de Gourmont a prononcé plus d'une parole et formulé plus d'une pensée dont on pourrait se réclamer pour lui faire dire à peu près ce que notre hypothétique contradicteur voudrait bien qu'il eût dit expressément. Et c'est d'avoir généreusement prêté à des interprétations de ce genre que j'en veux surtout à M. de Gourmont. Car enfin, de prétendre qu'il n'est d'idées valables, recevables et mêmes discutables ou qui méritent la discussion que les idées particulières, qu'est-ce à dire sinon que nous ne laisserons valoir, ne recevrons et ne discuterons que des idées suffisamment particularisées ? Et puisqu'il est ainsi reconnu que nos idées ont besoin d'une élaboration avant qu'on s'en puisse servir et que ce travail préalable consiste à en fixer étroitement les limites, j'ai le droit d'en conclure qu'à l'état primitif, à l'état brut pour ainsi dire, avant que cette élaboration, ce nettoyage aient eu lieu, toutes nos idées sont des idées générales. Mais je me garderai bien d'user de mon droit ; je serai bon prince. Et je serai prudent. Ma victoire ne serait dangereuse que si je voulais en jouir pleinement. Je pourrais partir de là pour, de l'aveu même de M. de Gourmont, repousser le dogme de ses chers sensualistes qui voulaient que toutes nos idées nous vinssent des sens et que l'intelligence, suivant sa forme favorite, ne fût que de la sensibilité transformée. « Comment donc, m'écrierais-je avec une indignation de prétoire, vous voulez tout à la fois que nos idées à l'état primitif soient des sensations et qu'elles soient générales au point qu'il faille les préciser pour s'en servir ! je ne puis vous accorder l'impossible. Choisissez, je vous prie, entre des idées sensibles très précises, aussi précises qu'une piqûre d'aiguille ou qu'un coup de poing (ce sont là des sensations, je pense !) et des idées intellectuelles aussi générales qu'il vous plaira ». Et le démon me tentant, il me serait facile de montrer que nos idées, loin de nous venir des sens exclusivement, nous viennent surtout du langage, de la tradition, de ce que nous entendons et lisons, et qu'avant de me former une idée sensible d'Athènes par exemple, en faisant le voyage d'Athènes, il ne m'est pas possible de ne pas m'être formé une idée traditionnelle, ou verbale ou livresque, et toujours une idée intellectuelle d'Athènes d'après ce que la tradition, les gens ou les livres m'en auront rapporté. En devenant sensible, en s'enrichissant et en s'imprégnant d'éléments sensibles, mon idée d'Athènes se préciserait et deviendrait de plus en plus particulière. Mais c'est aussi bien qu'elle était d'origine intellectuelle. Si l'on veut au contraire qu'elle soit originairement sensible, il ne lui reste guère en se particularisant que de s'intellectualiser, c'est-à-dire de se généraliser, si bien qu'elle deviendrait d'autant plus générale, qu'elle se ferait particulière ! Si cette histoire vous paraît un peu absurde, ne croyez pas qu'il y ait de ma faute. Et il n'y a pas non plus, hâtons-nous de le dire, de la faute de M. de Gourmont. Les Évangélistes ne sont pas responsables ni de l'orthodoxie catholique, ni des hérésies, ni de l'exégèse moderniste. Et M. de Gourmont n'est pas responsable des exégèses de ses zélés disciples ; il n'est pas même responsable — heureux lui ! — de la présente dissertation. M. de Gourmont est logicien, certes, mais il est douteux qu'un logicien soit tenu d'être logique. Il cultive la logique, ce qui est tout autre chose que de l'être, et les illogismes sont du ressort de la logique autant que les syllogismes. Et si l'on veut voir une rigoureuse logique, dans son œuvre, qui n'y est pas, il n'y est pour rien vraiment, car, malgré la rigueur très louable de son style et la vigueur qu'il y a mise et qui plaît, ne fût-ce que par l'heureux contraste qu'elle forme avec le flottement perpétuel de Renan, il n'a pas manqué de prévenir ses lecteurs et de les mettre en garde contre lui-même. Et toute son œuvre enfin est trop dirigée contre la superstition de la logique et de la certitude pour qu'il soit permis de la lire dans le dessein d'y trouver la logique ou la certitude. De pareilles lectures ont le grand tort de n'être pas désintéressées. Et l'on n'en rapporte le plus souvent que de la confusion. C'est ce qui est arrivé ici à mon contradicteur hypothétique. Il a pris au tragique la grande colère de M. de Gourmont contre les idées générales ; il n'a pas vu que son maître n'en voulait, au fond, et n'en avait qu'aux idées vagues, aux idées confuses, à ces idées précisément qui ne nous viennent pas des sens mais de la tradition, de ce que nous avons entendu et lu. M. de Gourmont, qui a perdu une partie de son temps à répéter que l'intelligence était de la sensibilité transformée et, avec mille et mille variantes nil in intellectu quod non prius fuerit in sensu, a passé du moins, et comme par compensation, tout le reste de sa vie à prêcher, à mettre en pratique une doctrine bien différente et autrement utile, autrement efficace et joliment plus pénible pour qui veut la suivre, à savoir qu'il nous faut tremper dans la sensation toute idée qui ne nous en vient pas. C'est tout autre chose, au point que c'est tout le contraire. Si toute idée avait la sensation à son origine, il ne serait nullement besoin, il serait absurde, de lui faire subir l'épreuve et de lui donner la trempe de la sensation ; pour l'affiner, pour la perfectionner, et tant pour lui ôter ce qu'elle a de trop que pour lui donner ce qui lui manque, il faudrait s'adresser ailleurs ; évoluant de la sensibilité à l'intelligence, l'idée d'abord sensible s'intellectualiserait d'elle-même, et la verrait-on encore se volatiliser, se perdre dans l'éther et se mêler aux nuages qu'il faudrait saluer cette ascension vers un état de plus en plus parfait. Nous savons maintenant qu'il n'en est rien de cette origine humble et terrestre ; et cela nous rend défiant à l'égard de pareil développement ouranopète et perfection céleste. Nos idées, la plupart de nos idées étant à l'origine des idées courantes (qui circulent dans la tradition orale ou écrite), flottantes et indistinctes (en raison même du grand nombre de heurts et d'empreintes qu'elles ont reçu), tout ce que nous pouvons faire, c'est de les fixer. Et c'est en quoi consiste la Culture des Idées, et c'est à quoi sert la Dissociation des Idées. M. Remy de Gourmont a passé le meilleur de son temps à fixer ainsi, au double sens de ce mot, des idées courantes et indistinctes. Il s'est livré à ce travail avec d'autant plus de goût et de délectation que la tendance la plus profonde sans doute et la plus essentielle à son esprit trouvait à s'y satisfaire. Je veux parler de la passion, si prononcée qu'elle en semble parfois perverse, qu'il a pour l'impopularité. Il est des gens qui ont ainsi le besoin de l'impopularité aussi impérieux que, d'autres, celui de la popularité. On dirait, en bref, que les premiers sont logiciens et les autres, orateurs, le logicien devant faire abstraction de son public de même que l'orateur doit tenir compte et faire grand compte du sien. M. de Gourmont est tellement peu orateur et à tel point logicien que ce n'est pas assez de dire que la popularité lui répugne ; il faut dire qu'il a soif d'impopularité, qu'il s'enivre d'impopularité, qu'il y trouve une volupté, qu'il en jouit et s'en repaît. Or, pour qui ne l'est pas de naissance et pour ainsi dire de droit divin, il est aussi difficile de devenir impopulaire qu'il l'est de devenir populaire autrement que par décret spécial de la Providence. Et l'on met communément autant de coquetterie à se rendre impopulaire qu'à acquérir la popularité. Rigoureusement, d'ailleurs, l'un et l'autre problème seraient insolubles, car, y ayant non pas un public mais des publics, si en s'efforçant de plaire à l'un on risque de déplaire à l'autre, en s'arrangeant de manière à déplaire à un troisième, on ne saurait échapper à la douloureuse fatalité de plaire à un quatrième. Songez encore que non seulement nous avons des publics et qu'il y a des partis différents mais que nous appartenons encore, de par notre naissance, nos goûts, nos relations et nos occupations, à des mondes différents. C'est ce monde clos dont nous sommes qui sera le théâtre et qui décidera de notre popularité ou de notre impopularité, puisque les autres mondes tout simplement nous ignorent. En sorte que pour jouir de l'impopularité tant désirée, le meilleur moyen est souvent de penser avec le peuple. Mais le plus sûr, afin que notre impopularité soit bien et largement assise, serait de déplaire à tous les mondes, à tous les publics et à tous les partis à tour de rôle. L'impopularité s'acquerrait donc, intégrale, que nous condescendrions à plus souvent varier. Or, M. de Gourmont a eu le rare bonheur de satisfaire son besoin d'impopularité sans varier jamais, à force de rester fidèle à lui-même au contraire, et sans prendre d'autre peine que celle de développer en conscience tout ce qu'il y avait dans ses principes. Qu'est-ce à dire sinon qu'il avait le génie de l'impopularité, qu'il était impopulaire de génie, comme d'autres sont de génie comédiens ou orateurs ? N'oublions pas, en effet, que logique est synonyme d'impopularité, et, après un coup d'œil jeté sur l'ensemble si divers et si harmonieux pourtant de son œuvre, nous ne nous étonnerons pas de constater que M. de Gourmont a excellé dans toutes les manières qu'il y a de concilier la défaveur et de quêter l'impopularité depuis celle qui consiste à penser avec une coterie contre tout le monde jusqu'à celle qui consiste à penser avec le peuple contre toutes les coteries. Il lui a suffi, pour atteindre ce beau résultat, de rester fidèle au culte des idées, c'est-à-dire de pratiquer la culture des idées, c'est-à-dire d'être logicien. Il s'est offert le luxe d'être logicien au point le plus aigu et, quoique avec une nonchalance de grand seigneur, du ton le plus provoquant, le plus insolent, avec une calme ténacité et comme qui dirait avec une virulence placide. Il y a de tout cela, dans cette méthode qu'il a instaurée ou restaurée après un siècle de délires et d'orgies synthétiques et que, par un retour significatif à cette vieille Analyse de Condillac, il a appelée la Dissociation des Idées. Rien qu'à introniser un mot formé sur le préfixe dis-, il y a un défi jeté à nos plus chers préjugés et à nos habitudes de penser les plus vénérables. Préjugés et habitudes les plus vénérables, je dis bien, puisque le langage les confirme, les appuie et nous les suggère. Les sentiments les plus respectés, les scènes les plus riantes et les actes les plus réjouissants ont pour préfixe con-. Conscience, concorde, condoléance, compliments, consolation et confiserie et confiture, voilà qui inspire joie et confiance, et lorsque les jeunes conjoints ont convolé en justes noces, conquis le bonheur et consommé leurs vœux, les conviés viennent les congratuler. Et le malheureux lecteur de ces pages en attend anxieusement la conclusion, parce que l'étymologie lui fait espérer qu'elle sera concluante et que le préfixe con- ne saurait rien promettre que de bon. Il en va tout autrement du préfixe dis-. La disjonction demandée par les dissidents d'un parti politique y jette la division et la discorde, dissémine une majorité et provoque d'ultérieures dissensions. Et la distraction du lecteur sera cause peut-être non pas de nos dissentiments... J'admire, quand j'y songe, que M. de Gourmont, qui n'ignorait pas ces convenances et disconvenances du langage, ait osé les braver au point où il l'a fait et soit allé choisir ce mot de Dissociations, — où l'on peut lire la menace d'une dissolution de la société, — pour en faire son porte-drapeau, lui confier son secret et l'exposer comme une enseigne flamboyante au-dessus de sa porte. Si j'étais tant soit peu sensible au charme des fables ethnographiques, si j'avais à quelque degré le désir de complaire à ce faible de notre troisième siècle des lumières, ce serait ici le lieu de rappeler que M. de Gourmont est Normand (2) et de chercher dans les qualités de sa race la raison de ce goût qu'on lui voit pour la froide bravade et l'impopularité exquise. J'aurai beau jeu, j'aurais même trop beau jeu, et il n'est pas d'un beau joueur d'abuser inélégamment et indiscrètement d'un beau jeu. Et il serait d'une plus saine méthode d'expliquer les Normands par M. de Gourmont (en y ajoutant Barbey d'Aurevilly, Flaubert, Corneille et Huet) que d'expliquer M. de Gourmont par les Normands. Sans compter qu'il est d'une détestable méthode de confondre la littérature avec l'ethnographie et la logique avec la psychologie des races. Ce que nous retiendrons pourtant, parce qu'il nous a frappé, c'est que de maintes comparaisons entre le Normand et quelque type de Germain latinisé, comme l'Alsacien ou le Flamand, il résulte que le Normand se distingue par un excès d'intelligence qui lui est fatal quand il n'en trouve pas un emploi indigne et qui, appliqué par le paysan normand aux minuties de la procédure, lui a valu son renom séculaire. Sans doute il y a de la cupidité et de l'amour du gain dans sa manie processive ; mais il y a aussi de l'amour de l'art. Dans ces luttes d'intérêt, l'exercice désintéressé d'une intelligence oisive est pour quelque chose toujours et parfois pour beaucoup. Son intelligence qui ne sait où se prendre est prise dans la chicane et s'en éprend. Et la chicane, aujourd'hui que la théologie est délaissée et pour le paysan qui de la théologie n'a cure, est une excellente école de ce jeu favori de l'intelligence qui consiste à séparer dans l'esprit des choses inséparables en fait et à user sans scrupule du fameux distinguo. L'abbé Trublet n'était certes pas Normand, car il « compilait, compilait, compilait ». C'est ce qui l'a rendu ridicule. S'il eût été Normand, il n'aurait pas été ridicule mais terrible, car il aurait « distingué, distingué, distingué ». Les préfixes différents décidément font une grande différence ; tel qui compute ni dispute pas. Aussi bien, s'il n'est pas tout à fait sans intérêt de souligner le trait qui rattache M. de Gourmont à sa province et à sa race, à la vérité il n'importe guère. Car ce par quoi le Normand se distingue d'entre les Français, c'est par quoi aussi le Français se distingue des autres Européens. Le Français a inventé, en esthétique, la séparation des genres ; belle invention à laquelle nous devons aujourd'hui encore ce que nous avons de supériorité en des domaines tout autres que celui des arts. Je regrette seulement que l'explication qu'on en donne d'ordinaire soit si mesquine et si peu faite pour en rendre apparent le mérite. On ne semble pas se douter qu'avant que nous en fissions le principe de notre esthétique, la séparation des genres était dans nos mœurs, qu'elle est restée pour une large part dans notre esthétique en dépit des efforts qu'on a faits pour l'en chasser et que, malgré tout ce que les femmes, la sentimentalité et le moralisme ont fait pour l'en arracher, elle paraît devoir se maintenir longtemps encore dans nos mœurs et nos sentiments. Par un très honorable souci d'ordre sentimental et de propreté intellectuelle, le Français est incapable de supporter certaines confusions, le mélange de certains sentiments et la promiscuité de certaines idées. Il a même inventé le sens du ridicule, tel un gendarme, pour empêcher par exemple, l'amour-passion de communiquer avec l'amour-vanité, l'amour-sentiment d'embrasser l'amour-volupté, pour interdire tout contact entre la sentimentalité bavarde et le sentiment monosyllabique. Il y a là beaucoup plus qu'on ne pense ; il y a là le plan tout fait d'une société, le destin prédéterminé de générations innombrables. Ces distinctions de sentiments et d'idées nous paraissent élémentaires ; mais un Allemand habitué à mêler tous les genres, les trouverait subtiles et ne saurait comment les justifier. Nous savons, du moins, à quel point il est choqué par les institutions et les coutumes qui en dérivent directement. Il ne comprend pas la sagesse du Français qui, pour ne pas avoir le scandale chez soi, a réservé, dans ses villes, et voué certains quartiers au scandale. Il ne comprend pas le délicat sentiment du Français qui respecte la mère de ses enfants et sacrifie sur des autels et selon des rites différents à la mère de famille et à sa maîtresse. Raffinement, je le veux bien, raffinement d'aristocrate, j'y consens, mais qui est assez commun en France et qui n'est pas pour nous faire honte ni pour que nous rougissions de l'avouer. Et puis, de quelque commentaire qu'on l'enguirlande, c'est un fait, un grand fait qui s'impose à l'observateur et que M. de Gourmont, fût-il moins disposé qu'il ne l'est à dissocier les idées, fût-il dépourvu de toute curiosité à l'endroit des questions sexuelles, n'avait pas le droit de négliger et ne courait nullement le risque d'omettre par cette raison seule et suffisante qu'il est un grand amateur de faits. Et comme je comprends que les faits, tous les faits, petits et grands, hauts faits, faits d'armes, faits divers, fait du prince lui soient chers ! Car le fait n'est pas du tout la chose brève, brutale et sèche que pense un vulgaire abusé. Ce n'est pas, comme trop souvent dans les conversations des gens atrabilaires, l'argument péremptoire et hautain par lequel on se débarrasse de quelque difficulté, de quelque doute, le coup d'éponge dont on efface quelque délicate nuance de pensée. Le fait, enfin, c'est ce qu'on a lu quelque part, ce qu'on nous a raconté jadis, ce dont on croit, si l'on se souvient bien, que quelqu'un nous a parlé. Et le fait, en somme, n'a jamais comme aurait voulu Hippolyte Taine, fermé la bouche à personne ; il a toujours, au contraire, ouvert toutes grandes les portes du souvenir. Il n'a jamais paru dans la lumière blessante du matin ; il n'est jamais apparu, au contraire, que dans les riches couleurs du couchant, dans le nimbe flamboyant de la mémoire. Un jour, il m'en souvient, le Sénat équitable... l'honnête Burrhus va rapporter un fait de la jeunesse de Néron. Mais il est trop honnête, trop véridique pour l'omettre, Racine est trop excellent poète pour oublier de le dire : l'honnête Burrhus s'en souvient, et il suffit de cette touche merveilleuse, de ce symbole magique d'un vieillard qui se laisse glisser à la fuite du souvenir pour que la prétendue sécheresse du fait s'évanouisse et fasse place à l'éternelle poésie du fait. Un fait, nous le savons maintenant et ne nous y tromperons plus, c'est toujours un souvenir, une réminiscence, c'est une trouvaille de style ; ce n'est pas autre chose, le plus souvent, qu'un procédé littéraire, une ficelle dialectique. C'est toujours, et voilà qui en fait toute l'efficacité philosophique et artistique, une planche sur laquelle la discussion fatiguée rebondit, un tremplin de l'imagination. Le fait, ainsi compris, sollicite l'imagination, avive et aiguise l'attention et l'esprit. Tel qu'on l'entend vulgairement, il étouffe et comprime l'une et tendrait à réprimer et supprimer l'autre. De libérateur qu'il était, on le fait oppresseur. Mais je doute que les contemporains de la Révolution aient jamais suivi avec autant d'intérêt que nous, avec ses battements de cœur et cette anxiété les faits divers dont se compose la Révolution. Et pourtant, ces péripéties poignantes avaient pour eux le charme puissant de l'imprévu. Nous savons où devait aboutir la Révolution, mais quand l'histoire nous en est narrée nous trouverons du plaisir à l'entendre parce que les faits qu'on nous rapporte — et, en littérature, il ne saurait être question que de ceux-là— excitent notre imagination, tandis que les faits dont nous sommes les témoins oculaires compriment notre imagination, la laissent indifférente et inoccupée et méritent à peine d'être nommés des faits et ne sont pas du tout des faits. Tous les matins je lis dans mon journal avec avidité des faits qui n'auraient pas retenu un instant mon attention si, dans la rue, j'en avais été l'impassible témoin. Il n'y a de fait que celui que l'on rapporte et que l'on lit après qu'il a été détaché d'une chaîne continue, d'un ensemble homogène de faits indiscernables. Il n'y a de fait, autrement dit, qu'en littérature, et là, en règle générale et pour les raisons que nous avons déduites, autant de faits, autant de fées. C'est donc très légitimement et avec un sûr instinct de la vérité et de la poésie, si l'on veut bien me passer ce pléonasme, que M. de Gourmont s'est mis à commenter les faits divers, s'est fait chroniqueur, le chroniqueur du royaume des fées. Son métier, qui est celui du journaliste (3), n'en diffère que par la qualité de la pensée et du style, qui est presque tout, et par ce point de vue où son bon génie l'a placé et d'où il ne saurait laisser tomber un regard qui ne s'arrête sur un objet digne de le retenir. Je me figure l'ahurissement d'un de nos colporteurs de nouvelles à qui l'on apprendrait à brûle-pourpoint l'auguste et terrible mission qui lui est confiée ; il y aurait là matière à un conte pour un Villiers de l'Isle-Adam. Car on ne lui mentirait par en lui affirmant qu'il imite l'Ange du Souvenir, comme cet autre imitait le Tonnerre, ou, selon que je dirais plutôt, qu'il écrit la gazette ou la chronique du Royaume des Fées. C'est, du moins, ce que M. de Gourmont n'ignore pas. Il sait ce qui plaît à ces dames, et ses chroniques sont volontiers galantes. Et comme il excelle à leur faire accepter autant de sa dialectique qu'elles sont capables d'en supporter, la dissociation des idées, comme bien on pense, n'y perd rien. Et quand elle s'applique à des idées qui ont trait aux rapports des sexes, la dissociation des idées fait merveille. C'est ainsi que, dans certaine controverse fort en vogue aujourd'hui, les notions étaient restées furieusement confuses et, dans la nuit propice, maint attentat s'était perpétré contre la saine logique, jusqu'au moment où le fanal de M. de Gourmont s'alluma. On agite très volontiers depuis quelque temps, et trop volontiers peut-être, la question de savoir si les enfants sont une bénédiction ou une malédiction pour un ménage. Il aurait fallu répondre aussitôt, et si l'on m'avait consulté je n'aurais pas hésité à répondre que la question ne se pose pas puisque sans enfants il n'y a pas de ménage. C'est par un criant abus de langage qui en hurle que l'on dit d'un monsieur et d'une demoiselle quand ils ont signé certains papiers et balbutié certaines paroles inintelligibles qu'ils sont « un jeune ménage ». Tant qu'il n'y a pas d'enfants, il n'y a jamais ni ménage ni ménagère ; je reconnais qu'il y a quelquefois une ménagerie et une mégère de plus de par le monde... Pour revenir à la sotte question qui nous occupe ici et qui a tant préoccupé nos contemporains, on voulait savoir lequel était plus louable, plus conforme à l'intérêt bien entendu, au patriotisme, à la saine morale de « s'abstenir ou de procréer ». Nos paysans ont pour le dire des expressions plus franches, plus crues et plus pittoresques ; mais j'use à dessein de ces deux vocables qui trahissent si ingénument l'hypocrisie et la louche conscience de nos néo-malthusiens. Toutes les aberrations sont dans la nature humaine, mais il en est qui ont leurs dupes prédestinées : un homme incapable de plaisanter, un agrégé de philosophie, un ancien élève de l'Ecole normale soutint devant moi cette thèse, digne d'un autre public, que « l'abstention » est un ascétisme, qu'il y a dans le moral restreint une victoire de l'humanité consciente sur l'animalité aveugle. De là à représenter comme étant des brutes les gens qui s'unissent par le saint nœud du mariage dans l'espoir d'avoir des enfants, il n'y avait qu'un pas. Et on n'a pas tardé à le franchir. On nous a parlé avec cette éloquence sirupeuse et cet oléagineux pathétique, qui fait fortune auprès des femmelettes, de l'ivrogne mâle qui, rentré chez lui se jette sur sa femelle sobre mais épouvantée, et on a voulu nous attendrir sur le sort de ce pauvre bébé conçu dans un instant de dégoût, d'horreur et d'ivresse alcoolique et destiné, paraît-il, à garder pour la vie les traces de l'état où était son triste sire de père et des sentiments qui bouleversaient sa sainte femme de mère à ce moment décisif. Sur de pareilles tirades, je laisse à penser si le ton des débats était assez élevé. Il dépassait vraiment le niveau des circonstances. Tandis que l'orateur, — c'était le plus souvent une femme médecin, — se tamponnait avec son mouchoir les coins de la bouche, dans la salle le Tohu-Bohu primitif était déchaîné. Un père de famille se disait insulté, un jeune avocat du Sillon demandait la parole, un voyou anticlérical criait : « Hou, Hou, la capote ! », le syndicaliste qui présidait réclamait de l'ordre et les syndicalistes répandus dans la salle préludaient à « l'Internationale » en acclamant le sabotage de la natalité et la grève des ventres. Le moins fou de tous était encore ce fumiste qui tirait la morale de la fable en répétant un vieil adage, aussi vénérable que la Faculté : « Buvez de l'eau ! » C'était donc le cas où jamais de dissocier des idées si fâcheusement associées et embrouillées. Et c'est au sortir d'une de ces assemblées de cauchemar qu'il faisait bon entendre M. de Gourmont. Son langage, en substance, était à peu près celui-ci : « Il s'agit en somme de savoir quel emploi nous ferons de certains organes. » Or considérez un instant ces organes et voyez à quel point ils sont équivoques, et leurs fonctions ambiguës. J'ai une préférence pour les divisions dychotomiques [sic], mais la vérité m'oblige à leur reconnaître au moins une triple destination. L'enfant n'en connaît qu'une, et peut-être serait-il souhaitable que les deux autres nous fussent révélées en même temps et tout d'un coup. Mais cela ne se voit que dans les romans et n'est jamais arrivé qu'au chevrier Daphnis et à Chloé, l'aimable bergère. Sachons du moins distinguer deux fonctions si dissemblables dont l'une nous donne un plaisir passager et l'autre assure la perpétuité de l'espèce. La première est l'experte servante de notre égoïsme, et par le jeu de l'autre nous devenons les servantes et les serviteurs de l'espèce. Louons-les l'une et l'autre, puisqu'il n'est pas d'acte plus complet que celui-là par lequel d'une part nous nous ramassons sur nous-même et touchons au fond même de notre être et d'autre part nous nous épanchons, nous perpétuons et confinons à l'être universel. Nous lui devons d'atteindre à ces deux pôles de toute existence, l'infini de concentration et l'infini d'extension, de connaître l'instant éternel et l'éternité instantanée ». — On ne traduit pas la pensée d'un pareil écrivain sans la trahir. M. de Gourmont a dit à peu près cela et il l'a redit et sous tant de formes, avec tant de variétés et de nuance que j'ai dû condenser. Il a dit cela, donc, mais il n'a dit que cela. Il s'en est tenu là de ses conseils, il n'a pas passé outre et à la lumière il n'a pas ajouté l'ardeur. Car ce logicien, s'il a du poète, n'est pas du tout orateur, et, s'il est devenu moraliste en s'appliquant à des faits moraux, ç'a été bien malgré lui, en sorte que ce singulier moraliste se fait scrupule et a horreur de prêcher la morale, et ç'a été par mégarde et il s'en trouve tout penaud comme un chasseur surpris sur les terres d'un voisin qu'il n'aime pas. Il n'importe, et telle qu'elle est, la doctrine de M. de Gourmont me suffit puisqu'elle suffit à convaincre d'absurdité les jolis ménages malthusiens et les théories de mon ami, l'agrégé de philosophie, ancien élève de l'École normale. Si nous méprisons assez la crainte du ridicule pour tirer des propositions de M. de Gourmont la morale qui s'y cache, nous n'obtiendrons pas, il est vrai, un impératif, mais, ce qui est tout aussi précieux, un dilemme. Vous, donc, qui vous unissez par des liens charnels, ou bien vous voulez vous amuser ou bien vous êtes sérieux ; ou bien vous cherchez la bagatelle ou bien vous aspirez à l'éternité. Le choix est libre, mais il faut choisir, à moins de se vouer à l'ascétisme qui reprend ici son vrai sens. Aspirants à l'éternité, vous n'hésiterez pas à passer cette vie ensemble, et votre double solitude sera féconde d'année en année, votre maison se peuplera. Et alors, vous connaîtrez cette merveilleuse aventure, comparable à la seconde maturation du vin dans le cellier : ce que, d'un cœur léger, vous aurez cru perdre et abandonner en vue de quelque vie supérieure, voici qu'il vous sera rendu, et ces éléments se combineront que vous vous étiez résignés à dissocier, ces deux joies que dans votre probité vous vouliez séparer se confondront en une seul, comme la flamme de deux foyers jumeaux. Amateurs d'un plaisir passager, vous vous contenterez de la passade ; de cette façon, d'abord, vous ne ferez pas une parodie sacrilège de l'indissoluble union et ensuite vous ne donnerez pas le spectacle ridicule de deux chiens de porcelaine qui se considèrent sans considération, d'un Moïse qui frappe à tour de bras et inlassablement sur un rocher qui ne donne pas d'eau. Je crois bien, à ce coup, avoir dépassé la pensée de M. de Gourmont. Mais je ne m'en soucie plus, car mon propos est maintenant de la dépasser délibérément et de la prendre à revers. Non pas qu'il s'agisse de construire la synthèse après qu'il nous a fourni la thèse et l'antithèse. Loin de nous toute contrefaçon de la triade hégélienne ! Le penseur n'a pas d'autre outil que l'analyse, à d'autres, l'aiguille ; il lui suffit des ciseaux ! Le philosophe, c'est le digne époux de la « Mère coupe-toujours » ! Jamais il ne manque de matière à découper et à trancher, car la nature recoud à mesure et la trame se resserre et se referme sur la trace de ses ciseaux. Plus exactement, le philosophe dissocie les idées parce que la vie associe les choses. La synthèse que Hegel cherchait dans les nuages et pensait devoir construire, la synthèse n'est pas artificielle, et c'est par la nature qu'elle est donnée, ou plutôt, puisqu'aussi bien elle perd ici son caractère de synthèse, c'est la confusion vivante qui est antérieure à la distinction de ses éléments antithétiques et qui triomphe victorieusement de tout effort que l'on ferait pour les maintenir isolés. Distinguons le sentiment de l'appétit, c'est fort bien ; et sachons ne pas confondre l'habitude avec la concupiscence, ce qui est de sa nature durable avec ce qui est fugitif, rien de mieux. L'intelligence nous est donnée pour que nous l'exercions, mais n'oublions pas que le sens commun lui est supérieur. Non pas en beauté peut-être, car l'intelligence est une belle, une très belle chose. Mais ce n'est ni une grandeur ni une force et, à y regarder de très près, c'est à peine une réalité. Elle est belle, elle est froide, elle est antipathique, elle est souverainement impopulaire. C'est que, belle on la soupçonne de n'être pas bonne ; froide, on lui reproche de n'être pas féconde ; antipathique, on ne l'aime pas ; impopulaire, elle dépeuple. Et, comme nous devons tous l'honneur de sa connaissance à une de ces confusions fécondes où elle répugne, il suffit d'un rappel à notre origine pour nous faire méconnaître ce qu'elle a de noble, oublier ce qu'elle nous a valu de joies et pour que nous insultions parfois à ce qu'il faut lui reconnaître de généreux et de libérateur. L'intelligence, ainsi, a toujours raison, et toujours la vie lui donnera tort. Remy de Gourmont, ainsi, a toujours raison et toujours la vie lui donnera tort. Mais il n'y a que la vie qui puisse le démentir, et c'est en docile esclave de la vie que j'ose contredire cet homme libre. Je ne l'aurais pas toujours osé. Je n'ai pas toujours été un docile esclave de la vie. Et ego in Arcadia... moi aussi, j'ai été un insurgé. Il y a quelque cinq ans, je ne me serais pas permis d'élever la voix contre M. de Gourmont, et ce que j'aurais pu écrire à son sujet eût produit l'effet répugnant d'un éloge funèbre. C'est-à-dire que c'eût été un éloge très sincère et tout à fait sans réserve. Ceci est encore très sincère, mais j'y ai mis les réserves discrètes et fermes que la vie, notre commune maîtresse, nous apprend à mettre à tout ce qui n'est pas elle. Pourquoi ce changement ? C'est sans doute que j'ai négligé mon intelligence. Et c'est peut-être aussi que les dures leçons de l'existence n'ont pas été tout à fait perdues pour moi. Mais tout cela ne me laisse pas le droit de conclure. Confions ce soin aux bonshommes qui parleront, cette fois, au présent. C'est une grande et puissante intelligence. JEAN FLORENCE. (1) Pour se rendre compte de l'exactitude et de la portée précise de cette expression, il ne sera pas mauvais de comparer à celle de deux autres grands remueurs d'idées l'attitude de M. de Gourmont à l'égard des siennes. Il les traite avec une familiarité respectueuse. M. Charles Maurras pratique ce qu'on pourrait appeler la culture intensive des idées, trop intensive même au gré de quelques-uns qui sont moins sensibles que moi au charme de sa dialectique serrée et qui trouvent du sophisme dans l'habileté qu'il met à faire prospérer son unique talent. Et pour M. Paul Adam, les idées sont des cavales à dompter et il semble mettre sa gloire à en tuer le plus qu'il pourra sous lui. L'un et l'autre, quoique de façon bien différente, font violence aux idées. L'excès de soin et l'excès d'insouciance aboutissent à des résultats très différents, mais partent d'un même principe. M. de Gourmont paraît plus sage quand il laisse à ses idées leur liberté entière et se contente d'assister presque inactif mais très intéressé et amusé à leurs développement spontané. Il reste ainsi très accueillant au nouveau sans jamais devenir ingrat pour l'ancien ni oublieux du passé. La dissociation elle-même des idées, qui semblerait impliquer violence, se fait chez lui en douceur. Les idées de M. de Gourmont se dissocient plutôt que M. de Gourmont ne dissocie ses idées. Tout au plus pourrait-on dire qu'il dissocie volontairement, et avec une intention polémique, pour en montrer le néant, pour en corriger les fautes, les idées des autres. (2) Gourmont est normand, c'est-à-dire nordique, norrois, danois au même titre que Burnouf, Turgot, Anquetil ou Harvard. La désinence est analogique, française et postérieure ; quant au radical, il paraît identique à celui du nom nordique Gormr. (3) En ce sens que M. de Gourmont, au lieu de tirer ses sujets de son propre fond et de nous conter, par exemple la tragique histoire de la Princesse Phénissa, va les emprunter dorénavant à la réalité, à ce qui s'est passé pendant la semaine écoulée, pendant le mois ou depuis la création du monde, peu importe. N'oublions pas qu'on en peut dire autant de Goethe et que, même dans sa jeunesse, le grand poète n'a jamais pris son essor, comme on dit, qu'en s'appuyant sur des faits, sur l'expérience d'autrui ou la sienne propre. La grande consommation qu'il faisait de vies humaines pour en composer ses poèmes et ses romans a pu le faire passer, aux yeux de quelques critiques épouvantés, pour une sorte d'anthropophage très dangereux, l'anthropophage littéraire. Sans parler des Mémoires, du Wilhelm Meister qui en est un complément ni des poésies lyriques qui sont, plus que des mémoires, des confessions, prenons garde que Clavigo n'existerait pas sans les mémoires de Beaumarchais, ni Goetz sans ceux du Chevalier de la Main de fer, qu'il n'y aurait pas eu de Werther sans les époux Buff et le suicide du jeune Jérusalem, qu'il a fallu la brillante et brève carrière de Lord Byron pour introduire dans le Second Faust l'épisode d'Euphorion et qu'à le bien prendre, en somme, il n'y a d'inventé et de créé, dans toute l'œuvre de Goethe, que la pensée et le style. Cela nous suffit quand nous le lisons dans le texte ; quand au jugement qu'en pourra faire un français muni de la traduction genevoise de M. Jacques Porchat, il devra toujours, s'il est sincère, ressembler un peu à celui de Barbey d'Aurevilly. [texte entoilé par Vincent Gogibu, novembre 2007] - Guy Lavaud, Éparpillements par Natalie Clifford Barney (Sansot éditeur), p. 719 C'est un genre aujourd'hui presque abandonné que les Pensées. Loin d'être un éparpillement, elles nous obligent à contracter nos sentiments dans une forme nette, et à y resserrer la vie. À peu près seuls aujourd'hui M. André Suarès et M. Charles Régismanset continuent de se livrer à cet ingrat labeur qui dépouille la vie de tous ses voiles et nous la montre comme elle est, cruelle et laide. Dans ce genre difficile Mademoiselle Natalie Clifford Barney a réussi des mots d'une heureuse concision : « Le soleil... l'or des pauvres... Ce parasite : le passé... Les larmes une maladie des yeux... L'inattendu, ce maladroit... L'affinement de la souffrance : sourire... La dentelle : l'art des trous ». Elle y a mêlé de brefs paysages parmi lesquels celui-ci me séduit : « Une cascade rapetissée par le lointain tient dans l'embrasure de ma fenêtre. Sa chute, légère et puérile comme une chevelure, n'atteint pas en droite ligne toute sa longueur, d'être interceptée par le vent fort. Infidèle elle s'envole avant de toucher les rochers humides d'elle (et qu'à d'autres heures elle forme, use et transforme), pour se mêler à cette force passagère qui, souple, l'emporte, et qui, d'être plus libre qu'elle la surpasse. » On aimera ces Éparpillements. G. L. [texte entoilé par Vincent Gogibu, novembre 2007] 8e année. — N° 80. 20 février 1913 I. POESIE Henri Hertz : Les Séjours du symbolisme, 97 II. LITTERATURE Jean Florence : Remy de Gourmont à cinquante ans, 136 III. FOLKLORE Raymond Geiger : Les Chansons populaires du Ghetto, 158 IV. MUSIQUE René Chalupt : Le Mois du Musicien : La centième de Pelléas et Mélisande. — Les concerts du Mois, 187 LES SÉJOURS DU SYMBOLISME DE L'Art Indépendant, Au Mercure ET A La Phalange A propos des Souvenirs du Symbolisme DE M. REMY DE GOURMONT (Promenades littéraires, 4e série.) M. REMY DE GOURMONT a réuni ses souvenirs sur le symbolisme, dans une série d'articles qui ont paru dans le journal Le Temps. Ces articles sont pleins de précautions. Ils ne traduisent pas les délices compliquées qu'ont, certes, dû causer à M. de Gourmont tant d'œuvres originales ; ils ne se mettent pas au service de cet esprit d'aventure, minutieux, machiné, et redoutable dont M. Remy de Gourmont témoigne si souvent, lorsqu'il aborde, avec des manières caressantes, l'examen des mœurs ou l'étude des livres. Ici M. de Gourmont s'efface devant ses lecteurs ; il prend soin de n'être qu'un guide exact, attentionné, agréable. Cette sollicitude pour ceux qui ne sont point avertis des choses dont il parle, dépouille celles-ci de toute surcharge subtile, les vêt de la plus scrupuleuse simplicité, les empreint de clarté. Quand il s'agit du symbolisme, une pareille présentation n'est point superflue. M. de Gourmont a agi avec un tact opportun en racontant les péripéties de cette époque littéraire comme des événements aisés et d'une qualité familière. Cette leçon de naturel ne sera perdue, espérons-le, ni par le public, ni surtout par certains jeunes écrivains. Au mot de symbolisme, en effet, le public, par ignorance, certains jeunes écrivains, par calcul, ont pris l'habitude d'associer une espèce de rite compassé, une liturgie, un formalisme quintessencié, qu'ils s'autorisent à ridiculiser ou à dédaigner. Or, rien n'est plus faux. Il suffit de lire les pages de M. Remy de Gourmont pour s'en convaincre. Lorsque le symbolisme s'affirma, il rapprocha des écrivains si différents les uns des autres, que ce fut plutôt par le fait d'une boutade de l'un d'eux que de principes consentis, qu'ils se trouvèrent réunis sous une appellation plus générale, en vérité, que générique et qui avait l'air, surtout, de narguer toute définition. C'est que, venant après le romantisme et après le parnasse, tous deux fort jaloux de leurs convenances et de leurs modes, tous deux imbus d'une pensée assez farouche de prosélytisme, le symbolisme entendait s'insurger contre les exagérations d'écoles, et constituait essentiellement une protestation de liberté. La liberté avait bien été proclamée par les romantiques : que de tapage ne firent-ils pas contre les règles ! Mais la liberté romantique fut toute extérieure ; elle résida plus dans les façons des hommes que dans la façon des œuvres. Ce fut une liberté politique, non une liberté artistique. Dans l'exercice de leur art, nous voyons que les romantiques furent, au contraire, des dogmatistes impitoyables ; ils accordèrent des licences, sans doute. Mais qu'il y a loin des licences à la liberté ! Hugo se fit l'ordonnateur de pratiques verbales qu'il n'eût pas affichées avec autant d'ostentation s'il n'avait pas ambitionné de les tourner en discipline. On s'explique que le parnasse, si féru d'observance, soit sorti directement de cette souche tyrannique. Sa susceptibilité, sa raideur, dérivaient de la poétique romantique dont la détente n'avait été qu'apparente, et qui, par exemple, à la rigueur de la césure médiane, dans l'alexandrin, avait substitué des coupures hachées, des chutes brusques et des rimes brutales, autrement monotones et autrement contraignantes. Le parnasse, toutefois, réagit contre les préoccupations politiques du romantisme. Il revendiqua donc, à sa façon, une liberté, celle d'être, à sa guise, ou hiératique, ou descriptif, ou religieux, ou plastique, celle surtout d'être calme, c'est-à-dire exempt de fougue oratoire. Seulement, cette liberté, il la paya cher. Il la paya d'une sorte de monachisme glacé dont Leconte de Lisle devint l'apôtre, qui s'opposa à l'impétuosité sacramentelle du romantisme, mais qui, à vrai dire, en participait et n'en était qu'une hérésie. A ce moment, de toute évidence, le lyrisme demeurait emprisonné entre des gageures trop rigides et trop fermées. Soit qu'ils creusassent dans sa muraille des niches dévotes où s'adonner, loin du bruit, à l'adoration d'images impassibles (parnasse), soit qu'ils montassent par des marches rudement scandées, sur des remparts d'où ils embrassaient l'humanité entière d'un regard apostolique et féodal (romantisme), les poètes restaient soldats d'un château-fort dont la loi ne tarda pas à leur peser. Bientôt, beaucoup cherchèrent à s'évader. Où trouver la liberté jusque-là illusoire ? Le naturalisme apparut. Le naturalisme descendait dans les campagnes, frappait aux portes des bourgs et des villages, frayait avec tous les spectacles de la vie quotidienne dont il instruisait les drames avec méthode et bonhomie. Ce fut, en ce temps, qu'autour du naturalisme, contribuant à la même émancipation, soucieux comme lui de simplicité et de diversité, prit figure le mouvement qui allait faire fortune sous le nom de symbolisme. Leur parenté est certaine, ainsi que l'a très judicieusement relevé M. Remy de Gourmont, lorsqu'il dit : Mais peut-être faut-il entendre par symbolisme, ainsi que je l'ai écrit et toujours pensé, une littérature très individualiste, très idéaliste, au sens strictement philosophique du mot et dont la variété et la liberté mêmes doivent correspondre à des visions personnelles du monde. En ce sens, le symbolisme ne serait, techniquement, qu'un naturalisme élargi et sublimé, ce qui se définit assez bien par le mot de Zola : « La nature vue à travers un tempérament », si on donne au mot nature, sa signification ample : l'ensemble de la vie et des idées qui la représentent... Alfred Vallette fait très bien remarquer, dès 1886, que l'école symboliste a toujours marché de conserve avec l'école naturaliste. Elles avaient au fond, peut-être à l'insu de leurs tenants, mêmes principes et l'on est moins étonné, après cela, de voir Huysmans tenir en pareille estime et pour les mêmes motifs d'art, le Zola de la belle époque et Stéphane Mallarmé, d'ailleurs strictement contemporains. Ainsi, du romantisme au symbolisme, s'étaient entassées des tentatives de liberté contradictoires. Ces tentatives s'étaient longtemps heurtées et neutralisées les unes les autres, jusqu'au jour où, élargissant les données du naturalisme et leur restituant de la hauteur, le symbolisme parvint à composer l'unisson de toutes les libertés en suspens. Romantisme, parnasse, classicisme même, se ranimèrent dans l'hospitalité du symbolisme, mais avec un visage et des proportions transformés, car, désormais, ils étaient libres vis-à-vis d'eux-mêmes. Le symbolisme n'interdit rien. Il se soucia plutôt de revivifier les formes durcies par l'esprit de système, en y introduisant le goût, le respect de la libre richesse répandue avec variété, à travers les rêveries des hommes, et que peut extraire et porter au jour leur mobile langage. Cette tolérance et cette déférence constituèrent l'originalité du symbolisme et dirigèrent ses propres découvertes. Dans les traits de sa physionomie, le symbolisme refléta l'admirable bienveillance spirituelle qui l'inspirait. M. Remy de Gourmont trace de sa vie d'aimables tableaux. Il n'y avait point encore de zones prescrites ni de mœurs patentées pour les écrivains de Paris. Entre les rives de la Seine ne s'élevaient pas encore des difficultés de préséances. La vieille montagne Sainte-Geneviève et le Montparnasse restaient, certes, les camps préférés des poètes ; mais, de Montmartre au Panthéon, ils aimaient vagabonder sans arrière-pensée. La bonne parole était chez Mallarmé, qui habitait rue de Rome et, dans le quartier latin, auprès du verre de Verlaine. Les hommes n'éprouvaient pas le besoin d'être parqués pour se sentir unis ; les œuvres n'avaient pas à être couvées sous une doctrine, pour se rendre mutuellement hommage. Il en venait de partout, de la richesse et de la misère, de l'aristocratie, de la bourgeoisie, de la plèbe, des champs et de la ville, des pays lointains ; il en était qu'avait allaitées la vertu, d'autres dont le vice faisait la santé. Elles recélaient le parfum langoureux des terroirs, ou des saveurs étrangères. Toutes fraternisaient. C'était la vraie liberté morale réclamée par les romantiques, mais dont ils avaient énoncé la revendication plutôt que réalisé le multiple et souple accueil. Du romantisme, vint qui voulait. Du parnasse, combien de stylites accoururent, tout heureux de retrouver leurs jambes ! Que dire de cette rencontre qui liait sous une désignation flexible, sans qu'aucun en tirât vanité ou en prît ombrage, Villiers de I' Isle-Adam, Jean Moréas, Tailhade, René Ghil, Gustave Kahn, Henri de Régnier, etc., etc... Puis chacun était libre de choisir, ensuite, la route qui lui convenait. Jean Moréas retourna aux oratoires raciniens ; d'autres essayèrent des voies nouvelles, d'une innocence savante, comme Laforgue, ou d'un sec enchevêtrement, comme René Ghil. C'était bien « la colline aux cent chemins » qu'avaient chantée les Grecs. C'est alors que, favorisée par ce concours de toutes les libertés de conscience, de coutume et d'inspiration, put s'affermir l'œuvre capitale du symbolisme : l'innovation du vers libre. Prose et poésie allaient se rejoindre ; après six siècles, la langue était assez sûre d'elle-même pour se prêter à cette transfusion : prose et poésie allaient s'infléchir l'une vers l'autre dans ces proses rythmées et ces vers libres qui restent la grande réforme du symbolisme. Mais cette réforme ne fut point un schisme. Tout au contraire. Par là, l'art se garantissait contre l'usure scolastique où aboutissent les genres, lorsqu'ils sont trop séparés, et les styles, lorsqu'ils se spécialisent. En ayant des jours l'une sur l'autre, la prose et la poésie pourraient, à leur gré, s'aérer, se soutenir et moduler mutuellement leurs ondes. Les revues où, pour inaugurer cet important usage littéraire, séjourna le symbolisme, furent, elles aussi, nombreuses, volages, et sans apparat. Ce fut encore une nouveauté. On aurait pu s'attendre, pour une révolution de cette portée, à un déploiement de manifestes, à une profusion de pontificats. Il n'en fut rien. Tout se fit le plus simplement du monde et presque exclusivement par l'exemple. A « La Vogue », au « Scapin s, les plus hardis ouvrages parurent sans parade. La plupart semblaient étonnés eux-mêmes de l'audace qu'on y découvrait. On put ressentir, à ces traits, ce que c'était enfin que la liberté en art, ce que c'était que l'action en art, et combien elles se distinguent de ce qu'on en fait au dehors. La part la plus précieuse de la tradition littéraire française n'était pas désavouée elle prenait, au contraire, une valeur inattendue. Le goût de la grâce, la force mordante se manifestant dans une sorte de fluidité aiguë et mesurée, ce qui est chez les chanteurs des Cours d'Amour, ce qui est à la belle époque de la Renaissance, ce qui est, également, en dépit de la façade, chez Rabelais comme chez Racine, ressuscitait avec un sens agrandi et multiplié. Je m'étonne que, parmi les maisons que passe en mémoire M. de Gourmont, il ne soit pas question de l'Art Indépendant, et que le nom d'EDMOND BAILLY ne vienne jamais sous sa plume. C'est pourtant de cette petite boutique de la rue de la Chaussée-d'Antin que partirent ceux qui ont mené l'effort du symbolisme jusqu'à la célébrité, jusqu'à l'Académie. Le choix d'Edmond Bailly fit éclore les jeunes gloires de Henri de Régnier, de Pierre Louys, de Paul Claudel, d'André Gide. Aux symbolistes de la seconde génération, Edmond Bailly donna l'envol. La renaissance musicale eut aussi ses racines chez lui, puisque c'est sur son piano que Claude Debussy éveilla les thèmes de Pelléas et Mélisande et que l'Art Indépendant fut le premier éditeur de la Damoiselle Elue. « L'Art Indépendant » n'était pas riche; Edmond Bailly aimait trop l'indépendance pour s'accommoder du despotisme des bailleurs de fonds; il commit l'imprudence de ne se lier avec personne, pas même avec ses auteurs. Ceux-ci, après qu'appuyés à sa main légère et forte, ils eurent fait leurs premiers pas, le délaissèrent.. Lequel se souvient de lui, de ses connaissances, de sa conversation narquoise et étincelante ? Pourtant, quand, par hasard, il est sur leur chemin ou que son nom revient à leur oreille, ils ne peuvent se défendre d'un mouvement d'émotion qui n'est, peut-être, pas dénué de quelque remords. L'Art Indépendant existe toujours; mais Edmond Bailly n'édite plus que des ouvrages de Haute Science. Le vieux fonds, longtemps endormi, s'épuise peu à peu on y recueille, à prix d'or, les derniers exemplaires des premières éditions des Chansons de Bilitis, de l'Arbre, du Voyage d' Urien. Les transfuges de l' « Art Indépendant » passèrent au « Mercure de France ». L'aventure du « Mercure de France » méritait d'être signalée : M. Remy de Gourmont n'y a pas manqué. C'est encore une preuve de la compréhension du symbolisme, de l'extraordinaire attraction qu'il exerçait, et, on peut le dire, de la nécessité invincible avec laquelle il s'imposait à tous les jeune-venus, avides d'interpréter soit par leur plume, soit par leur groupement, soit par leurs publications, l'opulent caprice partout répandu. Le « Mercure », nous dit M. de Gourmont, débuta par une espèce de déclaration de méfiance envers les périodiques, détenteurs du symbolisme. Plusieurs, il est juste de le reconnaître, s'immobilisaient dans un byzantinisme excessif, et justifiaient l'accusation de décadence qu'on leur infligeait. Cette réaction, le « Mercure » l'opéra dans le sens du naturalisme, en tirant ses premiers effets des ballades explosives de Laurent Tailhade, et des notations à la loupe de Jules Renard. Mais bientôt et comme à son insu, le Mercure de France reconnut que faire profession d'abandonner le symbolisme, même au profit et au nom d'une liberté moins définie et, en apparence, moins enclose, c'était renoncer à la liberté, à toute la liberté, tant le symbolisme, de son titre à dessein nuageux et céleste, couvrait d'espace littéraire. Finalement, ce fut le « Mercure » qui, dans la transmission graduelle de cette vaste poussée de sensibilité artistique, forma la branche maîtresse. Et cela nous conduit jusqu'à cette revue-ci, jusqu'à la Phalange, que le Mercure a, parfois, traitée avec irritation, bien qu'elle soit la plus fidèle pupille de son principe. La Phalange s'attacha à sauvegarder ce principe sur le point de se perdre; elle voulut qu'il demeurât incorruptible, loin de la fête. Elle publia des œuvres impénitentes, dans lesquelles il conservait sa vigueur et sa fraîcheur recluses. Surtout, — surtout! — elle le protégea contre des menaces nouvelles qui venaient de surgir. L'art littéraire subissait une grave épreuve. Les soucis sociaux dominaient les esprits ; ils commençaient à attaquer ce que l'on appelait avec mépris « les tours d'ivoire », ce que l'on bafouait du sobriquet de « l'art pour l'art ». Les tours d'ivoire ? Oui certes, s'il faut entendre par ces mots le travail solitaire, sans hâte et sans bâtardise. L'Art pour l'Art ? Oui, si cela veut dire que l'art a son existence à lui, ses devoirs à lui, son optique à lui, son mouvement à lui, sa façon à lui de se passionner et d'agir, d'être bon et d'être utile, et qu'aucune de ces attributions ne se confond avec celles de la science, de la religion, de la politique ou de la philanthropie. C'est à défendre ces prérogatives de souveraineté hautaine et d'indépendance absolue, que s'acharnèrent Jean Royère et la Phalange. L'appétit de sacrifice démocratique, l'habitude du dramatique politique, que l'art ne peut servir qu'en refusant de s'y asservir, se liguaient pour le ruiner. La Phalange lutta contre ces risques et cette déchéance. Aujourd'hui, plus elle va criant, sans répit, sa foi dans la liberté de l'artiste, et le bienfait des tours d'ivoire et la raison d'être de l'art pour l'art, plus elle est battue des orages et des invectives. C'est à qui s'ingéniera à la supplanter, en hissant le pavillon de contrebande d'un parti ; c'est à qui s'efforcera de la pousser vers les havres mornes où somnolent les épaves. A toutes les avenues de l'art, s'armant contre le symbolisme des libertés que le symbolisme leur a données, s'embusquent des inquisiteurs. Au moment où l'on arrive à la fin des souvenirs de M. de Gourmont, on ne peut s'empêcher d'y ajouter, à part soi, un chapitre de plus qui n'est pas le moins noble et le moins tourmenté. Ce n'est pas une tâche facile que de maintenir debout et vogante, la nef de la liberté artistique, afin qu'elle continue de parcourir toutes les émotions de la terre, afin qu'elle entre avec calme dans les horizons du couchant et dans ceux du levant, et que, au fil de sa course, on puisse regarder avec volupté, en tous sens, aussi bien derrière soi, vers les splendeurs qui se voilent, sans être ni iconolâtre ni iconoclaste, que devant soi vers le remous des aurores, sans être, cependant, thaumaturge. Telle est la direction qu'a assumée à son tour Jean Royère, et à laquelle, opiniâtrement, il voue sa ferveur (1). Plus tard, on se rendra compte du mérite qu'il y aura eu, et de la reconnaissance à laquelle il a droit. Plus tard... quand, — dans une large mesure, grâce à lui, — la liberté aura survécu ! HENRI HERTZ (1) Henri Aimé, qui a assumé depuis le mois de mai 1912, la direction de la Phalange, poursuit le même idéal. [N. D. L. R.]. M. REMY DE GOURMONT M. Remy de Gourmont, s'il faut en croire Larousse, né en 1858, aurait aujourd'hui cinquante-cinq ans. Son dernier recueil d'études, ses dernières Promenades littéraires seraient donc l'œuvre d'un quinquagénaire, et c'est ainsi qu'il convient de les envisager pour peu que l'on tienne à rester dans la ligne, dans la ligne de vie de leur auteur. Ceux-là n'auront pas eu besoin de mon conseil qui auront été, comme je l'ai été moi-même, les lecteurs attentifs de cet écrivain fécond sans qu'il y paraisse, à la fois abondant et concis, les spectateurs sympathisants et parfois émus de cette vie littéraire si régulière, d'un cours harmonieux et en apparence paisible, où l'on devine pourtant plus de troubles, plus de douleurs peut-être et certes plus de luttes que les quelques tourbillons superficiels n'en avouent. Le Gourmont de 1913 n'est plus tout à fait celui que je commençai de lire (avec quelles délectations, pipes que je culottais alors, pipes d'antan, vétérans des vieilles guerres qui vieillissez honorablement au râtelier, vous le savez !) vers 1900. Nominaliste radical et individualiste comme il serait honteux de ne pas l'avoir été à dix-sept ans, je me plaisais alors aux saillies, aux boutades, aux jugements irrespectueux et tranchants de celui qui était alors bien certainement, avec Anatole France, mon maître incontesté. C'était le temps où je ne pensais guère mais où j'écrivais bien. Je soignais mon style, mes maîtres m'inspiraient maint pastiche lamentable et impeccable, et je n'avais d'hésitation qu'entre la manière plutôt brusque de l'un et les façons plus sournoises, insinuantes et enveloppantes de l'autre. Nous étions d'ailleurs presque toujours d'accord, car, n'ayant pas plus qu'un individualiste en bas âge pris le fâcheux pli de juger des choses par moi-même, m'attachant, comme tout nominaliste zélé, fervent et mal préparé, beaucoup plus aux mots qu'aux choses, je ne me connaissais pas assez encore pour bien connaître les autres et pour mesurer les distances qui nous séparaient. Les efforts que j'ai faits pour réparer le temps perdu et les maîtres qui m'ont aidé dans ces efforts m'ont peu à peu éloigné de M. de Gourmont, comme d'Anatole France : s'il faut reconnaître le contre-sens qu'il y avait à les prendre pour directeurs spirituels, il y aurait mauvaise grâce pourtant à leur refuser le beau nom de maîtres, quand il ne s'agit que de prose française, et le nom plus beau encore de sages, tant que c'est d'eux-mêmes que l'on parle. Ceux qui écrivent bien parmi ceux qui écrivent ne le font, à y regarder de près, que portés par le sujet, emportés par la passion, par la conviction, dans les moments d'exaltation où leurs facultés semblent tendues et, entre autres, celle de bien dire. Ils n'écrivent de belles pages qu'aux moments où ils s'échauffent, aussi leur art ne consiste-t-il, en somme, suivant l'expression de Montaigne, qu'à se chatouiller quand ils veulent rire et à se frapper quand c'est aux sentiments tristes qu'ils s'adressent. L'émotion chez M. de Gourmont n'est jamais artificielle ni provoquée ; il ne l'exclut pas, il l'accueille, il lui fait sa place et lui reconnaît ses droits, mais jamais il ne s'en laisse maîtriser et jamais surtout il ne la feint ni ne l'exagère. Il faudrait avoir le goût bien gâté ou malsain pour l'accuser de froideur, et pourtant, à certains moments, on est tenté de le définir comme un de ces tièdes dont parle l'Écriture et dont elle ne dit pas grand bien. Sa tiédeur, du moins, n'est pas une chaleur insuffisante ou languissante; ce qu'on peut prendre pour de la tiédeur chez lui serait plutôt l'heureuse combinaison de l'émotion et de la réflexion, se tempérant l'une par l'autre et aboutissant à quelque chose qui paraît assez voisin de la sagesse, si ce n'est la sagesse même. Cette disposition où il est, je ne dirai pas qu'il y paraît jusque dans son style mais plutôt que le témoignage et la preuve la plus évidente s'en trouvent, comme de juste, dans son style. Il n'est pas d'écrivain moins oratoire que celui-ci. Quand on écrit, le plus souvent on a quelqu'un en vue, on s'adresse à un particulier ou à plusieurs, on songe à certaines opinions que l'on discute, approuve ou combat, et toujours enfin on s'efforce de persuader. M. de Gourmont n'a jamais l'air de vouloir persuader qui que ce soit. Il ne s'adresse pas plus à Jean qu'à Pierre, Paul ou Mathieu. Il écrit pour lui, pour tout le monde, il n'écrit pour personne en particulier. Ses articles sont des monologues. Il nous ouvre pour un moment sa porte, il nous permet de l'entendre, il ne nous demande pas ce que nous pensons de ce qu'il nous a dit, il ne nous invite pas expressément à l'écouter; libre à nous, si nous sentons quelque fatigue, de le quitter, d'adopter ce qui nous plaira de sa pensée ou de n'en rien prendre ni retenir du tout. Ce lui est tout un. Aussi ces discours n'ont-ils ni l'enchaînement ni le mouvement que d'autres mettent dans les leurs. Les phrases ne se poussent pas, ne se pressent pas, n'aspirent pas à quelque but précis. Puisque ce n'est pas une démonstration qu'il s'agit de faire, à quoi bon cette rigueur mathématique que d'autres affectent ; à quoi bon ce mouvement oratoire que d'autres chérissent ? Une à une, les phrases de M. de Gourmont s'égouttent, s'égrènent, pareilles à l'eau de la clepsydre, au sable du sablier, à la procession des heures et des jours. L'harmonie qu'il y a dans cette lente théorie n'est pas de celles que l'on saisit d'abord et qui frappent. Mais elle se révèle, se dégage peu à peu et, subtile, s'insinue avec des surprises parfois, des accélérations, des ralentissements qui sont dans la pensée même qu'elle accompagne et convoie. On ne sait plus guère écrire de ce style-là, et j'avoue que les préférences de la mode, les besoins de la génération présente ne s'en accommodent guère et ne lui présagent pas de sitôt la faveur. Non seulement le goût des sports détourne de la littérature ; il fait bien mieux (ou bien pis, selon qu'on le prend), il favorise une certaine littérature aux dépens d'une autre. Et ce qui en souffre le plus, quand ce n'est pas la clarté, c'est la nuance et la mesure. Le style de M. de Gourmont fait à la pensée un devoir de la mesure et de la nuance. Il ne vit que par elles, il ne vit que pour elles. A écrire de ce style, à le tenter seulement, on s'interdit tout autre moyen de plaire, on s'oblige, on se condamne à ne plaire que par ces qualités de mesure et de finesse, et dame ! comme elles ne sont pas le fait d'un chacun, il se peut bien qu'on s'en tire à sa honte. J'ai essayé d'écrire comme M. de Gourmont, mais j'ai bientôt dû y renoncer ; si l'on a toujours assez de mots à sa disposition pour faire de longues phrases (la langue française ne se lassant guère d'en prêter), on n'est pas toujours disposé comme il faut pour en faire de petites. Ou voudrait s'étendre davantage encore sur le style de M. de Gourmont. On voudrait le considérer comme styliste et lui consacrer l'étude qu'à ce titre il mérite. Tôt ou tard il se trouvera quelqu'un pour le faire. A une génération de la nôtre, ne doutons pas qu'avec Huysmans il ne partage la gloire d'avoir été le grand prosateur du symbolisme, de même que Chateaubriand fut celui du romantisme dont Lamartine et Hugo étaient les poètes. M. de Gourmont semble nous inviter lui-même à des considérations de ce genre. Dans ses récentes études critiques, de plus en plus le styliste, disons mieux l'amateur de style ou plutôt encore de styles multiples et personnels, s'ajoute au moraliste et au philosophe que nous connaissions et aimions en lui. Il n'est guère possible d'oublier son apologie pour Gongora et le Gongorisme, soit qu'à plusieurs reprises il étudie son maître Flaubert et ses procédés, soit qu'il suive les progrès du style culinaire de Huysmans et qu'il en énumère et détaille les enrichissements successifs. La langue lui a toujours été un sujet favori de méditations et de recherche, et l'auteur du Latin mystique se retrouve dans maint article plus récent. Mais il y a plus : M. de Gourmont ne dissimule plus la mauvaise opinion qu'il a de ceux qui substituent la biographie à la critique littéraire et l'étude de l'auteur à celle des œuvres. Ce qui reparaît le plus souvent peut-être dans son dernier recueil, c'est la condamnation de ce procédé qui réussit et fait merveille quand ce sont Sainte-Beuve et Taine qui l'appliquent mais dont leurs innombrables imitateurs ne font pas toujours l'usage le plus heureux. C'est d'ailleurs toujours un tort que de confondre les genres, et il y a là de quoi expliquer en partie la répugnance de M. de Gourmont, outre que l'excès où l'on a poussé la manie de l'anecdote et de la « petite histoire » est bien fait pour la provoquer. Ce n'est pourtant ni à cette prédilection pour la « dissociation des idées » ni à cette méfiance à l'égard d'un travers contemporain que j'attribuerai sa protestation. M. de Gourmont est le littérateur le plus convaincu que je connaisse. Oh ! il n'est pas de ceux qui chanteront en public Dulces ante omnia Musae, qui s'attendriront sur les chères études, qui se prendront d'enthousiasme pour la haute culture. La possession n'est pas aussi lyrique que le désir, et M. de Gourmont possède trop sûrement pour qu'il entre tant de lyrisme dans sa conviction : on ne le voit pas présidant une distribution de prix et prononçant le discours d'usage. On ne le voit pas non plus faisant une conférence. La littérature pour M. de Gourmont n'est matière ni à brillantes généralisations ni à ingénieux exposés. C'est ce qui le distingue des critiques qui ne sont que cela, et par exemple des universitaires. Brunetière et M. Lemaitre se maintiennent toujours à une certaine distance des textes. M. de Gourmont ne s'en détache qu'à regret et il lui arrive d'avouer qu'il aimerait mieux relire son auteur que d'en écrire. Cet aveu lui échappe en particulier à propos de Flaubert qu'il feuillette de préférence à tout autre et qu'il approfondit diligemment. Il est de ceux d'ailleurs qui s'appliquent à détruire l'absurde légende et qui n'admettent pas que l'on fasse de Flaubert un styliste exclusif et maniaque. Mais, cette légende écartée, quand on aura reconnu dans le romancier de Croisset l'homme de génie que certainement il fut, il n'en restera pas moins quelques vérités très certaines qui m'empêcheront toujours de lui vouer un culte semblable à celui que M. de Gourmont a pour lui. Il n'en restera pas moins que l'œuvre de Flaubert manque extraordinairement de fraîcheur et de spontanéité, que la prétention de nous intéresser aux vicissitudes sentimentales de Frédéric Moreau est outrecuidante ; il n'en restera pas moins que l'impassibilité spinoziste de Flaubert méritant toute notre admiration, la qualité de son lyrisme, de son émotion et de tout ce qu'il y a, tout de même, de personnel dans son œuvre n'est pas bien haute. Ce qui séduit M. de Gourmont, ce qui l'attache à Flaubert, c'est bien que Flaubert fut en son temps, comme il l'est lui-même aujourd'hui, le littérateur le plus convaincu qu'il y eût. Je lui préfère, et de beaucoup, Balzac. Mais je reconnais aussi que Balzac, infiniment plus fécond, fut beaucoup moins homme de lettres que Flaubert, attacha beaucoup moins d'importance à la littérature, en fit un usage et en chérit un idéal moins purs et plus mêlés. Il fut plus homme, par contre, plus éminemment et plus complètement homme ; c'est ce qui fait sa supériorité, ou, pour parler avec modestie, c'est pourquoi je le préfère, c'est pourquoi son œuvre m'intéresse davantage. Car M. de Gourmont a parfaitement raison de rappeler que l'œuvre seule importe et que tout le reste n'est qu'anecdote. Ce ne sont pas les aventures par mer et par terre d'un auteur qui ajouteront rien à la valeur de ce qu'il a écrit ou qui la diminueront. On a souvent parlé de l'avantage qu'il y a pour les lettres françaises à ce centre et ce foyer qu'elles ont dans Paris. Il y a pas mal d'inconvénients aussi, et le plus grand de tous est qu'on s'y connaît trop, que l'on y vit les uns sur les autres, qu'il n'y a pas moyen de s'ignorer et que la dernière des choses que l'on examine d'un auteur, c'est son livre. Maintes fois j'ai eu à Paris l'impression de me trouver dans une vaste maison dont les corridors seraient des rues et dont les chambres seraient des maisons. N'est-il pas drôle, quand on y songe, n'est il pas d'une divine drôlerie qu'il suffise de pousser un bouton pour produire un monsieur ? Une grande ville, quand on la connaît, est comme un meuble à fiches, comme une suite de casiers que l'on ouvre et ou l'on puise. Il ne doit pas être bien gai de se trouver ainsi catalogué et rangé. Et ce doit être moins gai pour un auteur que pour tout autre citoyen. L'auteur gagne peu à être connu. Il est de ceux qui vivent mieux cachés. Et plus il a de valeur, plus il devrait s'appliquer à ne laisser voir de lui-même que son œuvre. Il est bien difficile de briller à la fois de vive voix et par écrit. Il y a d'ailleurs une telle différence entre l'art de parler et l'art d'écrire, entre les conditions, les moyens, la fin de l'un et ceux de l'autre qu'il est bien rare que l'on réussisse également dans les deux. Mais pour la critique, qui nous intéresse en ce moment, le grand danger de Paris, c'est qu'on y prend insensiblement l'habitude de ne pas distinguer entre l'homme et l'écrivain, d'expliquer celui-ci par celui-là, d'attribuer à l'un les défauts et les qualités de l'autre. Or, il s'en faut que l'écrivain coïncide avec l'homme et n'en soit que le prolongement. L'individu est autrement complexe. Ce qu'on écrit n'est que fort rarement ce qu'on dirait ; si on l'écrit, c'est précisément qu'on ne veut, qu'on n'ose, qu'on ne peut le dire ; ce qu'on écrit est plus rarement encore ce qu'on fait. Et le rapport de l'homme à l'auteur est le plus souvent un rapport inverse et de contradiction. Le rêve est d'autant plus profond, la vie est d'autant plus intense qu'ils se contredisent davantage et qu'en se contredisant ils se complètent. L'harmonie est d'autant plus grave que la corde est plus tendue entre deux extrêmes plus distants. Si l'œuvre m'intéresse, elle me suffit et ce que vous m'apprendrez de l'auteur n'ajoutera pas grand'chose à mon plaisir ; si l'œuvre ne m'intéresse pas, ce n'est pas ce que vous m'apprendrez de l'auteur qui y changera rien. L'intérêt que je prends à l'œuvre, ce n'est pas, bien entendu, un intérêt purement technique, portant sur la forme et le métier; c'est un intérêt humain, mais au sens large et complet du mot ; c'est un intérêt humain tel que nul humain particulier ne saurait l'inspirer. Pour des raisons un peu différentes des siennes, j'arrive à conclure avec M. de Gourmont : « Arrière l'anecdote et la « petite histoire » et qu'on nous laisse seuls avec les œuvres ! » Il n'y a rien d'étroit ni de sec dans la façon dont M. de Gourmont accueille les œuvres des grands hommes d'hier et d'aujourd'hui. S'il met de moins en moins de lyrisme dans l'aveu et dans l'expression de ses émotions littéraires, cela n'est dû qu'à sa réserve naturelle qui va croissant avec le temps ; cela tient aussi peut-être à ce que d'autres émotions sont plus favorables à son lyrisme que celles que lui procurent les livres. Le poète que nous trouvons plus rarement dans ces nouvelles Promenades que dans les précédentes, nous le retrouvons, aussi discret, et plus ardent que jamais d'un feu secret, d'une flamme tour à tour sombre et claire, dans ses Lettres à l'Amazone, de même que le moraliste ironique, cynique et tendre reprend ses droits dans les réflexions qu'il prête à son ineffable Croquant. L'humanité, au sens le plus plein de ce mot, a dans cet humaniste le plus fidèle et le plus dévoué défenseur. C'est ce qu'on ne saurait trop rappeler, c'est ce qui fait l'unité et la grandeur de cet esprit si divers, si riche et que sollicitent en tous sens des tendances dont il ne sacrifie aucune et qu'il se plaît, en dépit de la discipline si chère à la plupart de nos contemporains, à encourager également. Après tout, la polyphilie est une discipline elle aussi, et peut-être la plus salutaire, de toutes. C'est à ne rien mépriser que l'on risque le moins de devenir aveugle, exclusif et victime de l'un quelconque de ces fanatismes, de ces phobies que tant d'auteurs commencent par chérir, par affecter avec une sorte de coquetterie pour finir par en être les prisonniers dans toute opinion qui s'étale avec indiscrétion, dans tout sentiment qui revient avec insistance, craignons la vertu redoutable d'un opium et les effets d'un vice invétéré. Quoi qu'on en pense et qu'on en parle pour la blâmer ou pour la louer, la polyphilie est la disposition la plus digne de l'homme. Et l'humanité de M. de Gourmont ne cesse de s'affirmer avec une autorité, avec des exigences de plus en plus impérieuses. Elle s'affirme surtout par le respect qu'il témoigne de ces deux grands besoins de liberté et de bonheur qui sont la base même de toute égalité, de toute fraternité humaine et qu'il n'est permis de railler ou de mépriser dans aucune de leurs manifestations depuis la plus sublime jusqu'à la plus humble. Il s'en faut, hélas ! que les conditions du bonheur s'accordent toujours avec celles de la liberté, et M. de Gourmont semblait pencher dans ses premières années à subordonner celui-là à celle-ci. Il y avait dans son humanisme une certaine dureté hautaine, une âpreté, et il allait dans l'expression qu'il lui donnait jusqu'à une férocité qui faisait penser à Nietzsche. Si vous voulez être libre, eût-il dit volontiers, apprenez à renoncer au bonheur, et que si ce renoncement vous coûte trop ou ne vous est pas possible, sachez et avouez que vous n'êtes pas fait pour la liberté. Il n'en dirait plus autant, aujourd'hui. Ce n'est pas que la liberté lui paraisse moins précieuse ; mais, au lieu de prendre en pitié et en dédain ceux qui ne savent la conquérir, il s'indigne de préférence contre ceux qui en rendent la conquête si douloureuse et la jouissance si inquiète. Il a moins de raillerie pour les esclaves et plus de colère pour les tyrans. Ses sarcasmes, il les réserve aux esclaves volontaires, aux intelligences paresseuses ou hypocrites, aux cœurs lâches et hésitants, et quand il fait claquer le fouet, c'est pour les enhardir à rompre leurs chaînes. Sarcastique, amer et impitoyable, il l'est chaque fois qu'il soupçonne quelque duperie, quelque servitude acceptée et voulue, et son zèle parfois peut paraître intempestif. Mais il suffit que l'on résiste à quelque tyrannie, il suffit que la volonté s'affirme quelque part d'être libre, de goûter les biens et de courir les risques de la liberté pour que, d'un mouvement généreux, il écarte tout ce qui pourrait refroidir sa sympathie et ralentir son enthousiasme. Je doute que la sentimentalité verbeuse et diffuse de Mme de Staël provoque son admiration ; mais il ne la marchande pas à la femme qui tint tête à Napoléon et qui sauva sous l'Empire la dignité des lettres. Mme de Staël fit à la liberté le sacrifice de ses habitudes les plus chères et de tout ce que signifiaient pour elle Paris et le fameux ruisseau de la rue du Bac. Eût-elle été femme à lui immoler son bonheur, l'amour d'un amant et la jouissance de cet amour ? Je ne sais, mais je crois que, l'épreuve l'eût-elle trouvée trop faible, M. de Gourmont ne l'en aurait pas moins respectée, et peut-être l'en aurait-il aimée davantage, car l'amour est toujours fait en partie de pitié. Ce qui m'incline à le croire, ce sont les pages émues que M. de Gourmont consacre à Abélard, c'est le cri d'indignation que lui arrache le crime du chanoine Fulbert, c'est la généreuse pitié que ce Gaulois, si sensible au ridicule mais qui en repousse ici les suggestions et se refuse à rire, accorde libéralement à l'infortuné amant d'Héloïse. Il faut entendre de quel ton ému et pénétré M. de Gourmont flétrit le bourreau et s'attendrit sur la victime ! Nul respect humain ne le retient, et le procès se serait plaidé aujourd'hui, le méfait serait d'hier, son jugement ne saurait être d'une plus humaine rigueur ni d'une dureté plus pitoyable. Il n'est que trop vrai, les Abélard prêtent à rire, aujourd'hui plus que jamais, et tandis que nous rions de la ridicule victime, nous oublions trop facilement que le bourreau est odieux. Nos oreilles sont assiégées du bruit des ciseaux que nos Fulbert repassent, fourbissent et manient, partout résonnent les enclumes où l'on forge des fers pour la liberté, des entraves à notre bonheur; le sort d'Abélard d'un moment à l'autre peut devenir le nôtre. Et nous rions ! Nous rions, quand nous n'applaudissons pas ! Sachons gré à M. de Gourmont de n'avoir pas applaudi, de n'avoir pas ri, d'avoir froncé les sourcils et prononcé des paroles graves et tendres d'indignation et d'humanité. Il ne tiendrait qu'à lui d'être un Fulbert parmi tant de Fulbert. Sachons-lui gré de détester tous les Fulbert. |