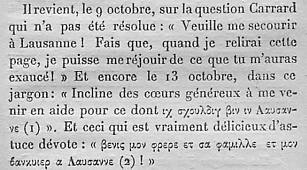|
La Fin des Boers. — Elle semble enfin passée de mode, l'antienne Gloria victis. Dès qu'ils ont été vaincus, les Boers ont cessé d'être populaires en France. Ils tenaient une carte sur laquelle nous avions joué de vieilles rancunes ; ils ont perdu et nous aussi : cela serait une explication, mais il y en a une autre que je voudrais meilleure. Ce qui nous plaisait dans les Boers, c'était leur force tenant en échec une force très grande. Ils représentaient une puissance ; ils excitaient l'admiration non pour leurs vertus ou la justice de leur cause, mais pour leur énergie dans la lutte. On les aimait parce qu'on les croyait déjà vainqueurs. Vaincus, c'est à peine s'ils font pitié. Il y aurait donc, en France, une meilleure santé morale et moins de sensiblerie que ne le feraient croire certaines déclamations politiques. Nous avons encore du goût pour la vie, pour la force, pour les attitudes de domination. Le mot d'ordre, en cas de conflit grave, ne serait peut-être pas : La paix à tout prix. L'animal aurait peut-être quelques ressauts qui contusionneraient son adversaire et le feraient réfléchir. Je ne dirai point ma vraie pensée là-dessus : elle est trop pessimiste. D'ailleurs, que le fond de la nation ne soit pas tout à fait corrompu, cela éloigne la nécessité d'une conclusion décourageante. On lisait dans le Times du 21 mars 1871 : « La Commune est soulevée contre l'Assemblée. Il y a entre les deux adversaires une question de force aussi bien qu'une question de droit, et c'est la solution de la première qui décidera des mérites de la seconde. » Voilà un langage très beau, parce qu'il est scientifique. La Commune avait tort, puisqu'elle a été vaincue, et durement. Les Boers avaient tort, puisqu'ils ont fini par consentir à devenir Anglais. Si cruelle que soit cette conclusion, si pénible qu'elle soit pour notre sentimentalisme chrétien, il faut prononcer résolument et l'accepter comme définitive et irréfutable. On le fera plus volontiers après avoir relu, dans Thucydide, l'émouvant dialogue entre les Athéniens et les Méliens. Avant d'attaquer Mélos, colonie de Lacédémone, Athènes lui envoya une délégation chargée de la convaincre de l'inutilité de la résistance. Les Athéniens partent de ce principe, qu'ils ont déjà évoqué contre Sparte : « C'est une loi que nous n'avons pas établie les premiers ; elle est de tous les temps, que le plus faible doit obéir au plus fort. » Aux Méliens, ils l'exposent en ces termes : « Il faut s'en tenir à poursuivre ce qui est possible, en choisissant pour base un principe sur lequel nous pensons de même et n'avons rien à vous apprendre : C'est que, dans les affaires humaines, on se soumet aux règles de la justice quand on y est contraint par une mutuelle nécessité ; mais que, pour les forts, le pouvoir est la seule règle, comme pour les faibles, la soumission. » Les Méliens n'ont rien à dire à cela ; ils répondent seulement « que ce serait se déshonorer que d'accepter l'esclavage sans combat, que d'ailleurs la guerre a des chances diverses, etc. ». Sans doute, répliquent les Athéniens, mais elles sont pour nous et contre vous. Les Méliens le reconnaissent : « Nous aussi, nous croyons difficile, n'en doutez pas, de lutter à la fois, à forces inégales, contre votre puissance et contre la fortune ; mais, du côté de la fortune, nous avons bon espoir, avec la protection des dieux, de ne vous être pas inférieurs, en défendant des droits sacrés contre l'injustice. » Les Athéniens : « Nous aussi, nous croyons que la faveur divine ne nous fera pas défaut ; car nous ne demandons, nous ne faisons rien qui ne soit d'accord avec les idées religieuses admises parmi les hommes, et avec ce que chacun réclame pour lui-même. Nous pensons en effet, d'accord en cela avec les traditions divines et l'évidence humaine, que partout où il y a une puissance, une nécessité fatale veut aussi qu'il y ait domination. Ce n'est pas nous qui avons posé cette loi ; nous ne l'avons pas appliquée les premiers ; nous l'avons trouvée établie, et nous la transmettrons après nous, parce qu'elle est éternelle. Nous en profitons, bien convaincus que personne, pas plus vous que d'autres, placés dans la même condition de puissance, n'en agirait autrement. » Les Macédoniens n'agirent pas autrement, ni les Romains, mais ils firent moins de discours, et moins beaux. Il y a bien longtemps que les hommes cherchent — comment dire ? — une force à opposer à la force. Cela ne peut pas s'exprimer, il y a contradiction dans les termes du discours. Quelle que soit la nature de la force qui triomphe, c'est la force. Les Boers auraient mieux fait de lire Thucydide que la Bible. Un peu de prudence leur eût permis d'échapper à leur triste sort et de ne pas figurer, avec les Méliens, parmi les victimes historiques de la crédulité religieuse. pp. 113-117 Le Divorce par fantaisie mutuelle. — On propose l'admission de deux nouveaux motifs de divorce : le consentement mutuel, la volonté d'un seul des conjoints. Pourquoi pas ? Seulement, autant décréter l'abolition pure et simple du mariage légal. Ce serait peut-être fâcheux. Le mariage indissoluble a une valeur particulière ; il promet des joies qui sont presque toujours déçues et des ennuis qui le sont rarement. Ce contrat signé pour la vie entière serait presque un acte d'héroïsme si les associés le consentaient de sang-froid : ils sont presque toujours dupes des illusions dont les grise le génie de l'espèce. Malgré cette inconscience des parties, et pour cela même, peut-être, un mariage définitif, absolu, a quelque chose de tragique. Il se joue un coup. C'est la rouge qui va sortir, ou la noire. Le geste du destin est impérieux. Il n'y a pas de revanche. Sans doute, l'usage civilisé admet des circonstances où il est permis de corriger le hasard. II faut une hardiesse et une habileté dont peu sont capables : l'adultère, d'un côté ou de l'autre, ne fait souvent, après un bref sourire, qu'enténébrer des vies déjà crépusculaires. On s'arrange parfois, on se fait son coin, mais c'est l'inquiétude dans la torpeur. « Il y a de bons mariages, il n'y en a pas de délicieux.» Il y a des adultères exquis, il n'y en a pas de bons, parce qu'il n'y en a pas de durables. Le mariage indissoluble a donc cette valeur, d'être une aventure dont on ne sait à peu près rien quand on s'y engage, sinon qu'elle durera toute la vie, sinon qu'elle est éternelle : il a la beauté des départs pour l'inconnu, des entrées en campagne, des prises de voile. Le divorce, en corrigeant une grande partie de ces hasards, détruit toute cette beauté. Celui qui va être heureux ou malheureux émeut par la chance de tragique que contient sa destinée. Si la tragédie peut se couper à tout acte, à toute scène, son intérêt s'évanouit. Tel est le point de vue esthétique. Qu'il n'intéresse pas les acteurs c'est fort possible ; je répondrais que, pour moi, je m'intéresse à la beauté de la vie bien plus qu'au bonheur de l'humanité. Vraiment, que ce monsieur, fatigué de sa femme, la veuille répudier pour en prendre une nouvelle, qui va s'émouvoir si cette fantaisie trouve quelques obstacles ? Ou que ce couple, reconnaissant l'inutilité de leurs efforts de pénétration dans le réciproque néant de leur sensibilité, se résolvent à de nouveaux nœuds transitoires, qu'est-ce que cela peut nous faire qu'un magistrat s'oppose à ce désir ? Les trois quarts des divorces actuels ont pour mobiles la basse recherche des plaisirs sûrs, la peur d'une souffrance, la lâcheté, en un mot. Des facilités plus grandes y ajouteraient le goût du dévergondage, le plaisir du changement, le caprice. On ne change pas si facilement, dans la vie, d'amant ou de maîtresse. Une volonté doit compter avec une autre volonté. Des femmes qui n'étaient plus aimées ont prolongé très longtemps une liaison qui leur plaisait. Le mariage aurait dorénavant cet avantage sur l'amour libre qu'on mettrait la force publique au service des « béguins ». Cela m'est égal. Je n'ai ni la superstition, ni même le respect du mariage ; mais tel qu'il est, il a son utilité. Les variétés de divorce que la jurisprudence autorise sont les plus défendables ; même avec la possibilité de tourner la tragédie à la blague et au badinage, même avec la liberté du mariage laissée aux « complices », le mariage reste la seule solution sexuelle pour l'immense majorité des hommes civilisés. Il serait bien plus habile, au point de vue social, de faciliter l'entrée que la sortie du mariage. Abolir des formalités surannées, telles que le consentement des parents, vaudrait beaucoup mieux que de diminuer encore la sécurité d'un contrat dont la durée fait presque toute la valeur. Et, après tout, ceux que le mariage effraie n'y sont pas contraints. A Paris, plus du quart des naissances sont illégitimes, très souvent près du tiers. L'union libre est une solution bien plus intéressante que le mariage tempéré ; elle est franche, du moins, tandis que le divorce par fantaisie mutuelle est un expédient hypocrite où la morale évangélique voudrait se concilier avec le caprice sexuel. pp. 117-120 Découverte du sucre. — La Science vient de découvrir le sucre. Sans doute, le sucre n'était pas un mystère pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes mêmes, non plus que pour les petits chiens qui savent faire le beau, mais ces différentes catégories d'être plus ou moins humains usaient du sucre au petit bonheur, sans principes, sans méthode. Alors la Science est intervenue, elle a cherché, elle a pesé, elle a mesuré et elle déclare sans rire : le sucre est un aliment. Il ne faudrait nullement être surpris si la même Science, celle qui s'amuse, découvrait un jour que le pain est un aliment, que le vin est un aliment, que la viande est un aliment. Attendons-nous à tout. Un Monsieur, qui a pour excuse, il est vrai, d'habiter l'Afrique du Sud, où les distractions furent rares, ces dernières années, nous a même informés que le sucre mélangé à la sciure de bois forme une nourriture des plus agréables et des plus saines non seulement pour les hommes, mais aussi pour les lapins. Puis-je insinuer qu'on savait depuis longtemps que le sucre est également une nourriture très profitable aux femmes et même qu'il les engraisse ? Un autre Monsieur a dessiné de menaçants graphiques en dents de scie par quoi il est prouvé clairement que l'eau sucrée n'est pas de l'eau pure et que les bonnes gens qui se ravigotent avec un verre de ce breuvage n'accomplissent pas un rite superstitieux. En somme, la Science a mis un siècle environ à constater qu'un repas fait avec du sucre, de la farine, du beurre, des œufs, est aussi nourrissant que s'il se composait de pain et de viande, tandis que les femmes qui dînent chez le pâtissier savaient cela depuis les temps les plus reculés. Il n'est pas mauvais cependant que des expériences précises viennent justifier une si vieille habitude. Ces justifications prouvent que l'homme peut, jusqu'à certain point, s'en fier à son instinct quand il s'agit de satisfaire ses besoins élémentaires. L'instinct du sucre n'a pas trompé l'homme ; est-il trompé par l'instinct du vin, l'instinct du café, l'instinct du tabac ? Il faudrait faire ces recherches sans aucune préoccupation morale ni hygiéniste. Cela serait très utile, et, en tout cas, très amusant. Aux précédentes découvertes sur le sucre, j'en puis ajouter une qui m'est personnelle et qui m'a donné les plus grandes satisfactions : je veux parler de la découverte du sucre de canne. Le sucre de betterave ressemble au sucre de canne, à peu près comme le vin de l'Hérault ou du Gard ressemble aux grands crus du Bordelais ou de la Bourgogne. Ici et là, c'est du vin, c'est du sucre, et pourtant ce n'est pas la même chose. Et dire qu'on a ruiné les colonies qui produisaient le vrai sucre pour encourager sa contrefaçon ! pp.120-123 Les espèces humaines. — Les sciences naturelles reconnaissent toujours l'autorité de la Bible. Elles ont rejeté Aristote, elles ont conservé Moïse. Récemment, M. Haeckel, en un livre testamentaire, se croyait tenu d'affirmer avec force : l'homme est un mammifère ! Notion rude qui froisse les âmes pieuses. Les animaux furent créés à la volée, comme on sème le blé ; pour l'homme, il fallut des gestes particuliers et minutieux. L'œuvre est si forte qu'elle épuise la puissance créatrice. Après l'homme, c'est le repos. Ouvrez le premier livre d'histoire naturelle, vous y trouverez, religieusement embaumée, la parole de Moïse. Moïse la tenait de Jéhovah, et Jéhovah la tenait d'Eloim, dieu multiple dont le nom ouvre la Bible : Bereshith bara Eloim... C'est une généalogie émouvante. Elle l'est au point qu'elle fait trembler la main des savants et qu'ayant lu dans la vie l'antiquité de l'homme, [entoilage prévu] Nietzsche et la princesse Bovary. — On a dit qu'elle lisait Nietzsche, cette lamentable princesse dont l'idéal fut de ressembler à nos petites bourgeoises détraquées et bêtement perverses, et que son mari déplorait cette fréquentation chez un moraliste débilitant. Ce mot fut écrit ; s'il fut dit, le prince Bovary est un sot. Mais sans doute qu'il n'a pas lu Nietzsche, lui, et certainement que si sa femme l'a lu, elle n'y a rien compris. Sinon, elle serait restée chez elle, aurait caché ses vices, offrant à son peuple du moins l'apparence d'une supériorité aristocratique. Nietzsche n'a jamais conseillé la lâcheté à personne ; mais aux princes et aux maîtres, c'est la dureté qu'il prêche, et envers eux-mêmes tout d'abord. Si elle avait lu Nietzsche, elle aurait appris que la recherche du bonheur (le bonheur des romances et des romans) est le signe évident d'une sensibilité serve et que, de toutes les déchéances, la pire est celle du privilégié qui abdique sa puissance ou seulement en renie les signes extérieurs. La puissance de Nietzsche n'est pas débilitante ; mais, comme l'alcool, c'est peut-être une nourriture trop riche pour les organismes débilités. p.131 Le Bavardage anti-alcoolique. — Sait-on à quoi aboutit l'action des ligues contre l'alcool et les discours des médecins moralistes, et tout le bavardage des marchands de thé et de bibles ? A ceci, qu'une pharmacie connue, placée sous le patronage de l'Académie de médecine, distribue des calendriers ornés d'une vignette représentant les « plantes utiles » et parmi ces plantes l'absinthe ; comme explication de l'utilité de cette plante, l'image nous montre encore une terrasse de café où des messieurs, avec soin, « battent leur absinthe ». p.132 L'Obscénité. — M. le sénateur Bérenger vient de faire voter par le Sénat une nouvelle loi pour « la répression des outrages aux bonnes mœurs ». C'est le même personnage qui donne son nom, malgré lui, à une loi d'indulgence. Il avait remarqué que les juges acquittaient souvent les prévenus vierges, se réservant, s'ils les retrouvaient, de les saler. Ces acquittements parurent scandaleux au sévère bonhomme, et il fit passer la loi que l'on connaît. C'est dans le même esprit qu'il a travaillé la matière des bonnes mœurs. « Une des raisons, dit-il, de l'inefficacité des lois qui visent ces outrages semble provenir de leur excessive sévérité. » Et il propose des adoucissements, en même temps qu'il réduit la largeur des mailles du filet. On pourra ainsi, dit-il avec son sourire à la Torquemada, poursuivre non seulement les directeurs et les gérants de journaux, mais les écrivains, les dessinateurs, les porteurs, les vendeurs, les imprimeurs, et sans doute aussi les marchands de papier, les fondeurs de caractères et les propriétaires des forêts de pins, des mines de cuivre, de plomb, d'antimoine et d'étain. La nouvelle loi requiert principalement contre les images, proscrivant toutes celles qui sont obscènes ou contraires aux bonnes mœurs ; mais elle n'oublie pas que les images sont rarement toutes seules ; les conteurs, les poètes, les fantaisistes sont menacés du même opprobre. Cependant, qu'est-ce que l'obscénité, ou, si l'on veut, qu'est-ce que les bonnes mœurs, ou encore, qu'est-ce que les mauvaises mœurs ? Questions que nul sénateur ne s'est posées à lui-même, questions que nul sénateur ne saurait résoudre. Pour discerner ce qui est permis de ce qui est défendu en matière sexuelle, les casuistes ont rédigé des centaines d'in-folios contradictoires. Liguori accorde ce que prohibe Escobar, et Sa, qui est sévère, se voit contredit par la mansuétude de Sanchez, l'indifférence de Soto, l'ironie de Caramuel. Au moins chez eux on s'instruit, puisqu'on dispute ; conscient de sa responsabilité, le casuiste termine presque toutes les discussions par un doute : il veut que le juge, qui sera, en l'espèce, le confesseur, tienne compte de toutes les circonstances, des mœurs locales, de la mode régnante, de la physiologie des races. Ils subordonnent volontiers, dans leur sagesse opportune et sceptique, le péché à la loi, déclarent grave en France et véniel en Espagne le meurtre survenu dans un duel. Ces subtilités n'ont plus de prise sur les hommes d'aujourd'hui, courbés sous un christianisme uniforme. Il y a les bonnes mœurs ; il y a les mauvaises mœurs : tout le monde, tous les honnêtes gens ne comprennent-ils pas ces mots de la même manière ? Hélas ! oui, les honnêtes gens sont unanimes dès qu'il s'agit de détruire une liberté. Mais il s'agit d'une question précise : Qu'est-ce que l'obscénité ? Les jeunes filles japonaises pétrissent et servent à la table de famille des gâteaux en forme de phallus ; les albums de plusieurs Jules Romain japonais sont très répandus, on s'amuse, en visite, à les feuilleter, on rit de la diversité, de l'imprévu des poses. Les dames romaines portaient des colliers phalliques ; dans l'Inde, le linguam est un bibelot pieux ; le catholicisme a conservé et sanctifié le culte de Priape. Tout le christianisme d'ailleurs repose sur des questions sexuelles : une vierge se refuse à son mari, se donne à un dieu, devient grosse et accouche sans perdre sa virginité. Les protestants n'admettent pas la continence conjugale de Marie et lui donnent des enfants « naturels » : excellent point de départ pour une controverse épicée sur les avantages et les désavantages de la virginité. Un chrétien doit faire de l'acte sexuel le sujet permanent de ses méditations. Omne vivum ex ovo : les religions aussi. La vie entière des hommes et des femmes, dans toutes les conditions sociales, tourne autour de la jonction des sexes comme autour d'un pivot. N'y pas céder est le souci de ceux qui ont fait vœu d'être chastes, et ce vœu lui-même est cause qu'ils pensent davantage à l'amour, ne le faisant pas, que ceux qui le font. L'allusion au geste provocateur, la description des jeux qui le provoquent, depuis le regard jusqu'à la pression de la main, la caresse, l'enlacement vêtu, le frôlement, le baiser, c'est presque tout l'art, toute la littérature. Les moralistes veillent à ce que ces représentations soient décentes ; mais pour dessiner les limites de la décence, il faut qu'ils aient l'indécence sous les yeux : ils entrent dans le penetrale et c'est du dedans qu'ils ferment la porte au nez du profane. Les danses les plus calmes et celles que l'on tient pour les honnêtes n'amusent que parce qu'elles représentent le simulacre des jeux de l'amour. Dans les cérémonies du mariage, le simulacre s'incarne et joue au naturel. Tout le monde, en voyant la mariée, voit le lit nuptial. Le voile, ici, est un transparent qui accentue la nudité. On regarde avec soin ceux qui vont coucher ensemble, on voit les gestes qu'ils vont faire ; les matrones, contentes, s'indigneraient au même signe d'intelligence que se font des amants. Cependant, il est convenu secrètement que toute cette mimique matrimoniale n'est que mimique. La grossesse, jadis, s'étalait ; on la cache, car elle représente l'aveu de relations charnelles dont il est entendu qu'elles sont ignorées des gens délicats. Dans les romans anglais, il n'est jamais question de possession, on échange des baisers, comme de papillon à lys. De même, la littérature populaire a remplacé par des expressions d'une banalité bizarre le mot net de jadis : « pucelage » est devenu dans nos chansons : « avantage », « cœur en gage », etc. Du haut en bas de la société de tous les pays repeints à neuf en christianisme, on retrouve ce double souci : de ne penser qu'à l'acte sexuel, de n'agir que pour le préparer, de le mimer du matin au soir, — et de feindre une parfaite ignorance quant à l'existence de cette pensée dominante, quant à la signification de tous ces jeux, de cette perpétuelle comédie. On conçoit la fureur de tant d'inconscients sycophantes, quand un indiscret ou un étourdi prononce tout haut le mot de l'énigme. Le moyen âge, qui ne connut pas la pudeur, ignora nécessairement l'obscénité. En art plastique comme en poésie, il est naïvement réaliste ; soutenu d'ailleurs par les Pères de l'Eglise catholique, par Clément d'Alexandrie qui disait : Comment aurai-je honte de nommer ces parties que Dieu n'a pas eu honte de créer ? En ses ivoires, en ses bois, le sexe féminin est soigneusement figuré ; les premiers graveurs suivirent cette tradition ; Clodion la continue : à une de ses terres cuites, au Louvre, une fillette accroupie, il fend la grenade, sans honte. Si les marbres féminins des Grecs sont épilés, c'est que la femme grecque s'épilait ; les mâles ont leur frisure. Il vaudrait mieux voiler d'une écharpe, à la manière protestante, le sexe des femmes peintes ou sculptées que de les tondre comme un menton ; cela serait moins fâcheux. Lisez « le Monstre » de Jules Renard. Lisez aussi le « Musée secret » de Gautier : Que mon vers dans la rouge alcôve, Car il faut des oublis antiques Qu'est-ce que l'obscène ? On n'en sait rien. La genèse de l'idée peut cependant s'expliquer. Il est convenu que l'acte sexuel n'est qu'une hypothèse physiologique ; on peut y faire certaines allusions ou purement scientifiques ou nettement risibles, ce qui est de la gauloiserie. Dès qu'on a ri, on n'est plus choqué, car on vient de donner la preuve que l'on considère ces choses comme de nulle importance, des bagatelles qui ne retiennent pas les gens propres, et, en même temps, comme des choses étrangères, dont on n'a que très vaguement entendu parler, des pratiques dont la singularité surprend et excite la bonne humeur. Tout le monde se fâche au contraire et se ligue contre le mal élevé qui se met à parler sérieusement de ces futilités : l'obscène c'est le fait sexuel traité sérieusement. Quant à l'idée d'obscénité verbale qui fait que certains mots sont proscrits, elle est bien plus facile à exposer. Ces mots sont obscènes en partie parce qu'ils sont rares ; ils sont rares, parce qu'on n'a pas à nommer en public les parties extérieures couvertes par le vêtement. Le reste de leur obscénité vient de ce qu'ils représentent, et cela rentre dans le paragraphe précédent. Un enfant a des fesses ; elles sont dodues, elles sont roses. Une jeune fille n'en a d'aucune sorte pareille à la reine d'Espagne qui était vide sous ses paniers. Mais elle a des hanches, quoique le mot embrasse certainement les fesses dans sa signification, qui s'est étendue et grossie, ces temps derniers. Les noms des différentes parties du corps ne sont pas aussi fixes qu'on le croirait : il se produit un glissement. L'usage qualifie les mots ; il qualifie aussi les actes et aussi les représentations esthétiques. Un marbre nu est obscène dans les pays calvinistes. Telle image qui fait frémir une famille de province ne retient pas un instant le regard curieux d'une jeune fille parisienne. C'est une remarque vulgaire qu'il y a un rapport étroit entre le lieu, la saison, l'heure et le costume féminin : le bal permet des nudités que n'admet point une petite soirée. Les femmes, qui font parade de pudeur, et qui réellement en sont dépourvues, obéissent : elles montrent docilement ou cachent leurs épaules ou leurs jambes, leurs genoux ou leurs seins, selon qu'il est louable de le faire. La mode qui les convierait à la nudité édénique ne leur suggérerait aucune objection. Le Directoire les vit revêtues de robes transparentes : au dix-huitième siècle, elles avaient la gorge à l'air. La mode, qui fait la mode, régit aussi l'art plastique et d'abord celui qui nous est le plus familier, la peinture. Oserait-on peindre ce tableau : une jeune femme couchée sur l'herbe en robe légère d'été ; un passant s'approche, relève la robe et regarde ? C'est l'Antiope. Quant à la Vénus de la Tribune, Baignant avec indifférence elle est la démonstration vivante et admirable, que nul geste, nulle pose de la femme ne peut être ni impudique, ni obscène, ni laide, si la femme est belle. L'obscénité n'est que dans le mâle : et encore, les peintures de Pompéï prouvent que cela est affaire d'appréciation. Qu'est-ce que l'obscène ? une notion fugitive, changeante, comme la morale elle-même, cette face triste de la mode. pp. 132-141 L'Homme et la Loi. — On n'a peut-être jamais tant parlé de la loi, de son utilité, de sa beauté, de sa fécondité, des merveilles qu'elle engendre nécessairement, du bonheur qu'elle doit semer parmi les hommes, d'un geste noble. La Loi, c'est la Loi : il semble à d'aucuns qu'on ait tout dit, quand on a dit cela. La Loi parle, il faut s'incliner. Elle parle mal et dit des bêtises : il faut s'incliner. Elle écrase les passants : il faut sourire avec bienveillance, car c'est la Loi. Est-elle bonne et conciliante, profère-t-elle de sages et douées paroles, par hasard : il ne faut témoigner de sa joie que par un applaudissement discret. On ne lui doit ni injures, ni compliments. Sa noblesse est si haute et si antique qu'il est également malséant de la vanter ou de la mettre en doute. Qui a fait la Loi ? On ne doit pas le dire. C'est, je crois, un philosophe du dix-huitième siècle, le célèbre physiocrate Quesnay, qui trouva cette belle formule : « Les hommes ne doivent pas être gouvernés par l'Homme, mais par la Loi. » Excellent prétexte à un petit dialogue socratique. SOCRATE. — Voilà une noble pensée, mais, dites-moi, mon cher Quesnay, de quelle Loi entendez-vous parler, de celle qui veille dans le cœur de l'homme, antérieure à sa volonté, dépôt sacré des dieux, ou de celle qui est l'œuvre de l'homme, et que l'on inscrit ensuite sur des tables ? QUESNAY. — J'entends la loi telle que la fixe le législateur honnête et prudent. Ses décisions ne devront jamais contredire la loi naturelle, mais elles sont autre chose, les sociétés ayant depuis longtemps, et pour toujours, dépassé l'état de nature. SOCRATE. — Voilà qui est sagement pensé. Cependant je vous prierai de répondre à ceci. Votre législateur sera-t-il un homme ou un dieu. ? QUESNAY. — Il devrait être un dieu, mais vous savez bien, Socrate, qu'il sera nécessairement un homme. SOCRATE. — Bien. Croyez-vous que l'œuvre d un homme soit dépendante de son auteur ? QUESNAY. — Je ne comprends pas bien. SOCRATE. — Une statue de Phidias pourrait-elle avoir été faite par l'esclave qui ébauchait ses blocs de marbre ? QUESNAY. — Non assurément. SOCRATE. — Tant vaut l'homme, tant vaut l'œuvre, n'est-ce pas ? QUESNAY. — Sans aucun doute. SOCRATE. — L'œuvre d'un homme n'est donc pas autre chose que l'homme même. QUESNAY. — J'en conviens. Je l'ai ouï dire à M. de Buffon qui avait là-dessus des idées bien intéressantes. Il disait vrai et vous aussi, Socrate. Ainsi je crois bien que je suis tout entier, avec mes lumières et mes erreurs, ma sagesse et ma déraison, dans mon Tableau économique. SOCRATE. — Je le crois aussi, Quesnay. L'abeille ne peut faire que de la cire et du miel, l'homme peut faire les choses les plus diverses, mais quel que soit le travail de ses mains ou de son esprit, ce travail porte en toutes ses parties l'empreinte humaine. Si vous trouvez un rayon, de miel vous ne direz pas : voici l'industrie des fourmis ; si l'on vous fait lire les lois de Solon, vous ne direz pas : voici l'œuvre des gypaètes qui planent au-dessus de l'Olympe. QUESNAY.— Assurément. Mais où voulez-vous en venir, Socrate ? SOCRATE. — A vous faire reconnaître ceci : qu'être gouverné par un homme, ou par la loi, œuvre d'un homme, c'est la même chose. QUESNAY. — Je me suis donc mal expliqué. SOCRATE. — Il se pourrait. QUESNAY. — Je suppose un homme sage, que dis-je, une assemblée d'hommes sages. SOCRATE. — Les sages sont rares, mon cher Quesnay. QUESNAY. — Ils fixeront une fois pour toutes, sous la dictée de la raison, les principes d'une législation éclairée. SOCRATE. — La lumière d'aujourd'hui est l'ombre de demain. QUESNAY. — Quoi ! Socrate, ne croiriez-vous plus à la raison ? SOCRATE. — Je l'aime, plus que je n'y crois. La raison est humaine, elle aussi. Elle ressemble à la musique. Une mélodie est-elle la même pour notre oreille, que nous soyons tristes ou de bonne humeur, malades ou sains ? QUESNAY. — Socrate ! Socrate ! Comparer la raison à une chanson ! SOCRATE. — C'est la chanson éternelle. pp. 141-145 Les Lois de circonstance. — Je ne comprends pas bien pourquoi, sous le régime de la Loi on ne ferait pas des lois de circonstance. Faut-il qu'un chasseur, parti pour tirer la perdrix et se trouvant tête à tête avec un sanglier se laisse innocemment découdre ? Prudent et opérant en pays dangereux, il aura toujours dans sa poche quelques cartouches de précaution. Il est probable que les seules lois utiles et bonnes sont précisément les lois de circonstance, puisque les mêmes faits ne se reproduisent jamais avec une pleine similitude. Les lois sont presque toujours absurdes, passé la génération qui les ordonna. Celles qui sont très générales, lancées de très haut, tombant du ciel comme la pluie et comme la théologie, semblent éternelles. Ne s'appliquant pas à un acte précis, larges et souples, elles paraissent inusables : illusion qui dure l'espace d'une des métamorphoses de la raison. p. 145 S'il faut obéir à la loi. — Assurément, et avant même qu'elle n'ait ouvert la bouche. Il faut lui obéir, comme un homme désarmé obéit au lion qui lui barre le sentier : il faut grimper à l'arbre. C'est une des préoccupations de l'homme intelligent, de ne jamais tomber sous le coup de la loi. Il y va de son repos, mais aussi de son honneur, de sa propreté. On ne fera aucune différence entre les lois politiques et les autres : toutes sont honteuses à subir. Quelle humiliation que d'être jugé au nom de la bêtise humaine, au nom de la lâcheté sociale ! Mieux vaut obéir, obéir comme un chien. La loi est un piège à loups. L'homme intelligent les évente et les évite, même dissimulés sous d'habiles feuillages. Ce n'est pas de la loi directement dont il a peur, c'est du prétexte qui permet aux hommes de l'appliquer. Aussi sa conduite est-elle exemplaire et pieuse. L'homme intelligent offre toutes les apparences de la plus haute moralité, parce que sa conduite est guidée par la plus cauteleuse prudence. Il pense au piège. Il marche à pas de loup dans la vie. « Pour atteindre la gnose, disait un certain Carpocrate le Gnostique, la première condition est de répudier les conventions sociales et de mépriser les lois. » Je ne désire pas atteindre à la gnose, mais vivre calme et dissocier ou réintégrer des idées dans la paix de mon cœur. J'écoute Pascal : « Raison des effets. Cela est admirable, on ne veut pas que j'honore un homme vêtu de brocatelle et suivi de sept ou huit laquais ! Eh quoi ! il me fera donner les étrivières, si je ne le salue. Cet habit, c'est une force. » Il faut obéir à la Loi. pp. 146-147 Le mot Religion. — Ils sont plaisants ceux qui, pour expliquer ce que c'est que la religion, et surtout ce qu'elle devrait être, évoquent les mots anciens de la même famille. Religion religare, relier, unis dans une commune croyance après ? Y a-t-il de quoi conclure : la religion, au lieu de diviser les hommes, devrait les réunir ? Et surtout : de l'essentiel de chaque religion faisons une religion universelle dans laquelle, selon l'étymologie, fraterniseront tous les hommes ? Les mauvais esprits, les aprioristes, inclinent presque toujours à confondre la raison et la cause. Ils suivent Spinoza, sans le savoir et sans l'excuse de son ivresse panthéiste: ratio seu causa ; ils substituent les termes d'une définition aux parties d'une réalité. En linguistique, les étymologistes amateurs cherchent invariablement l'origine d'un mot dans sa raison significative, alors qu'il la faut chercher dans son histoire, c'est-à-dire dans les causes physiques de son existence présente. L'idée de religion se dirait, à cette heure, par n'importe quel autre assemblage de syllabes, que sa réalité n'en serait nullement modifiée. Et précisément si l'on veut faire entrer dans cette idée la notion purement chrétienne de fraternité, ce sera en violation de l'étymologie, car religare veut dire lier et non relier. La religion était la chaîne qui immobilisait l'objet et le rendait tabou, la clôture qui écartait du temple le vulgaire. Les mots sont des signes dociles que les besoins successifs des hommes plient à toutes besognes. pp. 147-148 Luther et saint Vincent de Paul. — Deux hommes profondément significatifs. De l'un vient tout le rationalisme ; de l'autre, toute la philanthropie. Luther affirme la religion, veut qu'elle se soutienne seule, sans l'appui des œuvres, par sa seule force de vérité. Vincent nie la religion, en la voulant active, extérieure, humaine, charitable. Sa vérité a besoin de bonté de dévouement, de crèches et d'asiles. L'affirmateur montre au peuple une providence rigide et froide comme le destin ; le négateur la peint souriante, sous les traits d'une femme qui ouvre les bras, tend des mains lumineuses. Qu'elle les ferme un jour, et la religion s'obscurcit, idole dans l'ombre. Le dieu de Luther est dieu encore au moment même qu'il torture dans les enfers les justes qui sont morts en prononçant son nom. Si l'hôpital chrétien est preuve de vérité chrétienne, l'hôpital matérialiste est preuve de vérité alliée. Ceux qui ont lié l'idée de charité et l'idée de religion ont préparé la chute de l'idée religieuse pour le jour où la charité se montrerait visible en dehors de la religion. Au peuple, qui voit lutter autour de lui les deux charités et les sent également bonnes, la religion devient indifférente. La seule méthode pour détruire les religions charitables est de dissocier aux yeux du peuple, par des actes et par des faits, les deux idées longtemps confondues. Le catholicisme cessera d'être vrai en cessant d'être utile ; son agonie a commencé le jour même qu'il s'est posé en principe d'utilité sociale. Le génie de Luther a été de séparer le temporel du spirituel. Sa religion flotte dans l'espace, inutile, mais invulnérable. On ne peut l'attaquer que par la raison ; mais comme elle est déraisonnable, le duel est absurde et vain. Il faut pour s'en détacher un effort si énergique et si profond que l'exemple en est très rare et que la lutte laisse au vainqueur de douloureuses blessures. Nietzsche, qui se libéra des serres du mauvais oiseau, en resta tout meurtri et tout saignant. En pensant au christianisme, Nietzsche, selon les jours, se met à maudire ou à chanter, pour tromper sa terreur. En pensant au christianisme, Voltaire ne sent rien, que l'envie de rire. Pascal, oui, il y a Pascal ! Mais il était protestant, étant janséniste. pp. 148-150 Les Libres-penseurs. — Si les politiciens de toutes classes qui se qualifient ainsi avaient assez d'intelligence et le regard assez sûr pour discerner leur place véritable dans le monde, ils auraient de l'effroi. Ils verraient leur incrédulité devenue religion et propagée comme telle ; ils se découvriraient « réactionnaires et cléricaux ». Car leurs adversaires, aujourd'hui, ce ne sont pas des curés, mais des athées réalistes, des disciples de Hobbes et de Nietszche, des hommes sans principes, sans morale, sans idéal, des hommes pour qui la vie est une mer inconnue où il faut naviguer à la sonde. Il n'y a plus de portulans. On ne cherche plus la vérité, ni les îles du paradis ; on cherche à éviter l'erreur, mais on sait que l'erreur n'est pas le contraire de la vérité et l'on pense volontiers, comme Voltaire (lu par Nietzsche), « qu'elle a son mérite». Est-il possible que des temps soient venus, portant des esprits auxquels le culte de la Raison semble aussi déraisonnable que le culte du Sacré-Cœur ? C'est possible. Ces temps sont là, sous vos yeux, et vous ne les voyez pas, parce que vous vivez en posture de dévots, les yeux baissés sur votre illusion. pp. 150-151 Mai [1903] Les Congrégations : cléricalisme et christianisme. — Qu'il y ait désormais en France, pendant quelques années, un millier de réguliers de moins, jésuites, dominicains et chartreux, cela changera fort peu de chose à la physionomie de ce pays et à l'état des partis en guerre. Ce qu'on appelle le cléricalisme, et qui n'est que la politique mise d'accord avec la foi, n'en continuera pas moins de dominer, en certaines régions, sous son vrai nom et son véritable habit, en d'autres sous un pseudonyme et un masque. Il y a en France cinq ou six cléricalismes tout aussi fâcheux les uns que les autres un de plus ou un moins, cela n'est pas une grande affaire. Ils évoluent tous d'ailleurs autour du christianisme dont ils sont les fils, et ils existeront nécessairement, les uns ou les autres ou tous à la fois, tant que le christianisme sera le principe moral de l'humanité. Foi dans le passé, foi dans le présent, foi dans l'avenir, c'est toujours la foi ; or, la foi engendre la tyrannie. Un concile s'assemble pour décider si M. Millerand a mérité l'excommunication. Et c'est grave ; les conciles d'aujourd'hui sont aussi graves que ceux du quatorzième siècle. Je ne pense pas qu'on devienne clérical. Des hommes naissent cléricaux comme ils naissent respectueux, naturellement destinés à s'incliner devant une broderie d'or ou devant une période oratoire. On change de cléricalisme. Cela ravigote la foi, comme la transplantation active la vie de certains végétaux. De fanatique clérical, on devient fanatique anti-clérical, — pures épithètes : c'est le même principe, c'est la même besogne, et la même chanson, et qui inspire aux gens sérieux et froids le même dégoût ou la même pitié. Oui, ils sont bien bêtes, ces dévots qui croient que saint Antoine de Padoue va leur faire retrouver leur chien perdu ; mais ils sont bien bêtes aussi, et d'une bêtise identique, les électeurs qui croient que le monsieur qu'ils élisent député réalisera les promesses dont il les comble. Il ne faut pas rire des superstitions; elles sont la marque même de l'esprit humain. Tout n'est que croyance. Si le catholicisme disparaît de France, on le regrettera un jour. Les superstitions qu'il détient et qu'il propage ont une forme auguste, comparées à celles que l'on voit naître et qui prendront sa place. Cela est peu visible pour le vulgaire, mais il est certainement un obstacle au christianisme. Or, et cela sera évident un jour, le pire ennemi de la civilisation pleine et libre, ce n'est pas, ou ce n'est plus, le cléricalisme catholique, c'est le christianisme. Le cléricalisme n'attaque que les intelligences malades et sans valeur pour la civilisation ; le christianisme corrompt les plus superbes volontés. Le cléricalisme n'est peut-être qu'un fruit du sol ; le christianisme est un fruit étranger, auquel nous n'avons jamais mordu qu'avec beaucoup de répugnance. Depuis plus de quinze siècles, la politique romaine a travaillé à ne nous le présenter que bien confit et macéré dans le miel païen ; même sous cette forme, il commence à nous sembler fade ; et des messieurs venus exprès de Genève voudraient nous le faire avaler tout cru ! Le seul résultat, évident obtenu jusqu'ici par la propagation protestante a été de forcer certains aveux. Tel qui ne demandait qu'à vivre en paix avec la religion de sa race s'est vu forcé d'affirmer son éloignement pour le christianisme, base de cette religion. Tel autre, qui ne possédait même plus de sympathie traditionnelle pour le catholicisme, est sorti pour le défendre contre une secte plus hargneuse, plus tyrannique et, momentanément, plus puissante. Mais tous ces efforts convergent, et, avec l'aide de Nietzsche, c'est le christianisme même qui va être attaqué. Je ne crois pas qu'il soit en état de se défendre dans la région intellectuelle. C'est dans cette région seulement que, sous le nom de protestantisme, il est en ce moment dangereux. A la faveur de la philosophie de Kant, qui parut à un certain moment très hardie, il s'est insinué dans les esprits, ayant pris ce pseudonyme, Rationalisme. Véritable religion de poche, ce christianisme raisonnable tient peu de place et s'emporte partout. On voit des messieurs, qui se disent révolutionnaires, se mettre tout à coup à parler comme S. Paul. Des journaux semblèrent pendant deux ans rédigés par des apôtres ou des pères de l'Eglise. La manie de parler sans cesse de la justice et de la vérité est toute paulienne. On ne peut regarder une épître du tisseur de tentes sans tomber sur un de ces deux mots. La Vérité, c'est l'argument constant des protestants dans leurs polémiques. Ils prouvent facilement que le catholicisme n'est pas conforme à l'évangile, qu'on y a introduit une quantité de pratiques condamnées par Jésus ou par Paul. Un petit tract intitulé « Pourquoi votre curé vous défend-il de lire la Bible ? » démontre malicieusement que c'est pour que les fidèles ne s'aperçoivent pas des contradictions qui se sont développées entre les commandements de l'Eglise et les préceptes de l'Evangile. Mais de telles remarques ne peuvent troubler que des âmes fort naïves, car il est de toute évidence qu'une religion ne vit qu'en se modifiant, qu'en s'adaptant constamment à des besoins, à des milieux nouveaux. Une religion vraie est celle qui est, qui remplit un rôle d'utilité sociale. Pourquoi, au fait, n'en pas croire le pape régnant aussi bien que saint Paul ? La vérité avant tout et malgré tout : qui a dit cela le premier ? Un père de l'Eglise, S. Grégoire : « Si la vérité cause du scandale, il vaut mieux le permettre que de manquer à la vérité. » Parole bien digne d'un fanatique désintéressé du monde et qui n'a de souci que la vie éternelle. Pour en comprendre toute la gravité, il faut se souvenir de la signification forte qu'avait alors le mot scandale, et le traduire par honte, ruine, catastrophe. Tel est l'esprit chrétien originel, oriental. Il n'est vraiment tolérable qu'adouci par la sérénité romaine. Mais il ne faut pas s'imaginer que les hommes les plus nettement chrétiens, ce sont toujours ceux qui fréquentent les églises ou les temples. Il n'y a pas chrétien plus féroce que le chrétien incrédule, celui qui, ayant rejeté tout le dogme, a gardé toute la morale. Une des fables de la Bible, celle de Noé et de ses fils, explique ingénieusement la diversité des races humaines en même temps qu'elle tend à démontrer leur égalité originelle. De cette fable, en déclarant que le Christ est mort pour tous les hommes, l'évangile a tiré une morale dont les apôtres, imités par les missionnaires, ont assuré l'exécution. Que penser des incrédules qui, rejetant la fable, en admettent les conséquences, alors que la science la plus élémentaire leur crie la différence profonde observée non pas seulement entre un nègre et un blanc, mais entre un indigène du midi et un indigène du nord de la France ? Il faudrait vraiment abandonner les querelles basses dont vivent les chefs-lieux de canton, ces luttes ignobles de curé à instituteur, pour considérer enfin les seuls intérêts pratiques. Il faudrait, si dur que cela puisse paraître à quelques-uns, renoncer à toute idéologie, abolir la politique et troquer contre la liberté de l'homme et la liberté de l'animal, la liberté humiliante et factice du citoyen. pp. 151-157 [Mai 1903] Les Grèves : la théorie de l'insatiabilité. — L'homme n'a jamais cru que sa condition présente fût normale. Il a toujours cherché, en arrière ou en avant, un paradis terrestre. Jadis, tout en rêvant à un âge d'or aboli, il faisait sa soumission à la réalité ; c'est la civilisation païenne. Le christianisme, à la notion maintenue d'un âge d'or écoulé, paradis terrestre, ajouta la vision d'un âge d'or futur. On le plaça d'abord sur la terre, puis, pour plus de sûreté, dans les au-delà, paradis céleste, invention d'une astuce merveilleuse. Les hommes, pendant plusieurs siècles, n'en demandèrent pas davantage. Cependant l'espérance, comme si elle était tissée de matière et non de chimère, a des limites d'extension. Le fil cassa. L'un des bouts remonta si haut qu'on ne l'a jamais revu ; celui qui traînait à terre, les philosophes le saisirent et le rajustèrent à une autre idée, à la première forme de l'idée chrétienne: décidément le paradis futur est terrestre et non pas céleste : il se réalisera très prochainement dans le temps et dans l'espace. Cette promesse fut une grande imprudence sociale. Depuis cette époque le peuple attend, ne voit rien venir, et parfois se fâche. En 1789, la France entière se persuade qu'elle vient d'entrer dans l'ère du bonheur universel ; une partie de l'Europe fit le même rêve. Les brutalités de la Révolution ne furent pas autre chose que la colère d'un enfant déçu. En ce moment (1903), les ouvriers sont assurés que « si l'on proclamait la République sociale » tout le monde serait heureux immédiatement. Je ne discute pas ici l'idée de progrès, ni surtout l'idée de progrès social. Au contraire. Ce qui suit sera d'autant moins contestable que le progrès sera considéré comme plus réel, plus matériellement tangible. Admettons qu'il y a progrès. Ce progrès est vain, parce que l'homme, doué d'une infinité d'aptitudes, est nécessairement insatiable. Nulle amélioration, réellement réelle, dans la condition des hommes n'est possible, parce que : 1° Elle ne porte pas sur les mêmes hommes qui, au cours de leur vie, ne peuvent comparer que des quantités ou des qualités incomparables. Ce qui augmente le plaisir de vivre à trente ans souvent le diminue à cinquante ; 2° Les hommes, quelles que soient leur position, leur richesse, leur autorité, ne sont heureux que rarement et pour peu de temps. Le bonheur est un état physique qui ne peut ni se prévoir, ni s'ordonner, ni se fixer. Sa propre durée le détruit. C'est un fait fugitif parce que c'est un fait relatif ; 3° Même traités de plus en plus favorablement les hommes ne sentiraient pas cette progression. La moindre souffrance présente domine et annihile toutes les joies passées. Le parvenu ne jouit pas du pain blanc en songeant à la masure où il grugeait des pommes de terre. II le mange en se plaignant qu'il est mal cuit ; 4° Tout le monde sait par expérience qu'un besoin satisfait est aussitôt remplacé par un autre besoin. Un progrès accompli donne aussitôt le besoin d'un progrès nouveau, et ce besoin est une source de peine, tant qu'il n'est pas réalisé. L'ignoti nulla cupido n'est plus exact : il y a une anxiété de l'inconnu qui corrompt l'usage même des agréments de la vie civilisée. L'homme est insatiable : rien ne le contente parce que rien ne le remplit. Ce caractère, dont les poètes et les philosophes font un argument spiritualiste, n'est point particulier aux espèces humaines. On en observe les rudiments dans les animaux domestiques ; des chiens gâtés exigent une nourriture toujours plus délicate et plus variée : la sensibilité est d'autant plus impérieuse qu'on lui obéit; l'abstinence l'engourdit, l'abondance la surexcite. Condorcet, rêveur géométrique, contemplait les développements d'un « progrès indéfini ». Cette idée ne peut s'admettre que si on donne ici au mot progrès le sens plus modéré de changement. Tout progrès comporte une perte, la perte de ce qui est remplacé par une forme nouvelle, par un usage nouveau. Même dans le cas le plus favorable, ce n'est donc qu'un changement. D'autre part, le nombre des combinaisons, illimité verbalement, est limité réellement, d'où le retour, sous le nom de nouveautés, d'états anciens et oubliés. Un progrès n'est donc qu'un changement ; mais un changement devient un progrès, dès qu'il est senti comme tel. Tout est relatif et doit être considéré du point de vue subjectif. Il est absurde de raisonner sur des qualités absolues. L'idée du progrès en soi est une inanité. La civilisation, tout en croyant progresser, pourrait rétrograder lentement vers un état ancien, sans que les hommes en eussent conscience. Il y a des moments de l'histoire où l'humanité paraît immobile ; c'est que nous les voyons mal, de trop loin et que leurs mouvements nous échappent. Le changement est la loi ; s'il est parfois plus fréquent ou plus soudain, il ne manque jamais. Son absence serait un signe de mort prochaine, non de longue décadence, de mort immédiate et raide. Il est perpétuel, et cette constance est la raison de son inutilité pour le bonheur individuel. Le progrès que l'on a désiré, on ne le sent plus, dès qu'il est réalisé. Entré dans les habitudes de la vie, il s'y fond et y disparaît. Et ainsi l'humanité marche sans trêve, vers rien, pour rien, par nécessité de marcher ou de périr. pp. 157-162
Juin [1903]. Persécutions : Galilée. — Toute foi implique persécution ; là où il y a persécution, il y a croyance religieuse, il y a foi. On a vu un rudiment de la religion dans l'amour dévot et dévoué (ce sont mêmes mots) du chien pour son maître. Ce n'est pas déraisonnable. Le dévouement des hommes à une idée ou à un homme, à une vérité ou à un sentiment, c'est toujours religion. Les naïfs veulent s'affranchir et pensent avoir réussi, quand ils ont changé de collier. A quoi bon ? Il faut croire, puisqu'il faut vivre, et il faut persécuter ses ennemis, puisqu'il faut vaincre. Il y a la tolérance. Elle n'est praticable que pour des esprits d'un scepticisme féroce à force d'être méprisant, ou d'une bêtise invulnérable à force d'être épaisse. C'est tout de même un signe de supériorité qu'on ne voie pas en France bayer sur la même place les portes de cinq ou six temples rivaux : cela donnerait, selon les jours, des rixes, des huées ou des batailles ; cela donnerait surtout des batailles, ainsi que l'histoire nous l'apprend avec surabondance. Quand un peuple n'est pas assez bête pour supporter l'exercice simultané de deux ou trois religions, l'Etat intervient, les supprime toutes moins une seule, ou bien édicte une loi de mépris, une loi de tolérance. Alors on peut traverser la place publique sans craindre les ricanements du délire religieux, ses injures ou ses coups. La tolérance est très estimée. C'est une grande vertu, disent ceux qui voudraient être tolérés. Traitez-nous avec pitié, avec mépris, c'est-à-dire avec tolérance, nous n'en demandons pas davantage. Donnez-nous la vie rien que la vie, la vie toute nue et toute froide, monsieur le bourreau. La force qui tolère est sotte ; la faiblesse qui se veut tolérée est lâche. Il faut mourir noblement et savoir souffrir sans se plaindre l'injure dont on aurait accablé ses ennemis, si on avait été plus fort. Bonne ou mauvaise, utile ou néfaste, la tolérance a toujours une fin, c'est quand le parti toléré a refait ses muscles et reposé ses nerfs. Il se réveille, attaque ses anciens vainqueurs. Ainsi il se forme une véritable loi de persécution alternative. Parfois, elle est simultanée : cela s'appelle guerre civile ou guerre religieuse, extrêmes déploiements de la folie humaine. Le christianisme, cette religion d'amour, renferme une grande force persécutive. Il est persécuteur au point de se dédoubler pour permettre, hydre, à ses tronçons de se mordre les uns les autres, dans leur rage de vérité. Les Romains, ignorant la vérité, ignoraient le plaisir de molester ceux qui ne la possèdent pas. Ils ne devinrent persécuteurs qu'au contact des religions asiatiques et sous la pression d'une insolence qui mettait l'empire en péril. Devenu la force à son tour, le christianisme persécuta longuement et savamment ses ennemis ; vaincu après des siècles de domination, il a légué sa manie à une force nouvelle, née, comme lui, de l'évangile, la Révolution. Les procédés chrétiens et les procédés révolutionnaires sont identiques, et cela se comprend, puisque les deux sectes ont les mêmes principes et qu'elles se croient pareillement en possession de ce talisman chimérique, la vérité. Dès que les chrétiens ou les révolutionnaires sont au pouvoir, ils allument des bûchers, dressent des échafauds. Qu'elle opère en Angleterre, ou en France, qu'elle soit franchement ou hypocritement chrétienne, la Révolution procède aux sacrifices qui font partie de son culte. En Angleterre elle brûle la maison et les manuscrits de Harvey ; en France, elle abat la tête de Lavoisier. Sa seule excuse est que l'Eglise lui avait légué d'illustres exemples, et d'abord celui de Galilée. Mais les hommes grossiers qui imitaient l'Eglise la dépassèrent de beaucoup en cruauté et en obscurantisme inconscient. Ils brûlèrent et tuèrent sans savoir, au hasard, incapables d'ailleurs de soupçonner ce qu'il y avait dans les papiers de Harvey, dans la tête de Lavoisier. L'Eglise ici est fort supérieure ; elle savait ce qu'elle faisait. Elle se montra d'ailleurs bien plutôt rusée que cruelle ; elle fut même courtoise. On n'a jamais persécuté avec une telle politesse. Galilée n'a pas souffert en proportion de la gloire que lui a valu sa captivité. Son grand titre, en effet, à l'admiration des sots, c'est d'avoir été victime de l'Inquisition, comme s'il était jamais glorieux d'être victime, c'est-à-dire vaincu ! Galilée ne se jugeait pas victime ; il aurait eu honte d'être victime. Son attitude vraie est fort différente : loin de se plaindre, il loua les procédés de l'Inquisition à son égard, fâché de ses travaux interrompus, satisfait qu'on le traitât dignement, qu'on lui assignât pour résidence durant le procès, non une prison, mais un palais, et que les discussions fussent décentes. Il se vante peut-être d'avoir moins souffert qu'il n'a souffert : admirable orgueil ! Suspect à l'université impériale, Taine avait été exilé à Briançon, humilié dans son intelligence, frappé dans ses intérêts : quelle belle occasion de se plaindre plus tard ! Nullement : « Taine, dit M. Sorel, n'avait pas de goût à parler de ces temps douloureux. » Signe de grandeur. Comparer cette attitude à celle des humbles politiciens victimes du Deux-Décembre. Ce serait déjà énorme que Galilée eût risqué le martyre ; il est défendu de supposer qu'il ait réclamé la pitié de ses contemporains ou de la postérité. Non, il avait même pris ses précautions pour ne pas être martyr ; et on ne l'accusa point, on lui demanda des explications. Il répondit sans faiblesse et sans vanterie. Dut-il se rétracter ? On n'en sait rien. C'est peu probable, car ses affirmations avaient été indirectes et de pure hypothèse. On sait qu'il ne proféra point la phrase de mélodrame : E pur si muove. Il dédaigne d'insister. On n'avait pas, en ces temps-là, le prosélytisme de la science ; et bien au contraire, la tendance était de cacher au vulgaire les secrets de la nature. Que le peuple sache ou ignore les véritables mouvements des astres, cela n'a aucune importance, une vérité ou une erreur étant également inertes aux mains du peuple. « Après, vous m'apprendrez l'Almanach pour savoir quand il y a de la Lune, et quand il n'y en a point. » M. Jourdain est fort raisonnable. Galilée était un véritable savant. Il n'a donc affirmé qu'avec doute et avec dédain. Les dialogues contiennent le pour et le contre. Il croyait au système de Copernic et ses calculs en avaient augmenté la vraisemblance. Obligé de dissimuler, il le fit en souriant, cédant noblement à la bêtise, cette force, donnant une preuve mémorable du désintéressement des fiers esprits. Se désintéresser de la vérité, n'est-ce pas le suprême effort ? La grandeur de Galilée est là, et non dans son état légendaire de victime, et non dans un mouvement de colère, dans un mot de femme qui veut toujours avoir raison. Voilà une belle histoire de persécution, et qui ferait penser que la civilisation n'a peut-être pas beaucoup gagné quand on substitua la justice du peuple à la justice de l'Eglise. Enfin, cela fait toujours plaisir de changer de tyrannie : il ne faut pas espérer davantage. pp. 162-167 [Juin 1903]. Pensées de printemps : 1. Le mois d'octobre. — Ce qui dégoûte de l'utopie, de la petite comme de la grande, c'est sa facilité. Les mots sont si obéissants. Heureusement, l'homme résiste. L'homme est celui qui résiste. Quand M. Flammarion, astronome, dit à Homo qu'il serait plus heureux, si on le délivrait de cet illogisme, octobre, et que plomb ou zinc, vérité ou justice nommeraient mieux un mois qui est le dixième et non le huitième de l'année, Homo ne comprend pas. Il répond qu'octobre est un mot comme juin ou mars, qu'il y associe non des idées de numération, mais des idées de température. Octobre est le mois des lumières douces, des feuillages pourpres, des derniers sourires et des premiers frissons. C'est la jeunesse de l'automne, la seconde jeunesse de l'année. « Une rose d'octobre est plus qu'une autre exquise. » p.168 [Juin 1903]. 2. Le Mariage. — Le peuple est moral, par convoitise et aussi par crédulité. Il hait et envie les grands dont les mœurs sont impures. Madame de Lamballe passait pour tribade ; c'est pour cela que fut coupée et insultée sa tête charmante. Aujourd'hui le socialisme, parti populaire, déclame volontiers contre la prostitution, conséquence, rêvent ces pauvres cervelles, du régime capitaliste ! C'est de la prostitution, en somme, du libertinage, de l'irrégularité, qu'est née presque toute notre littérature, notre art. La prostitution c'est le « lac sacré », le marécage divin où fleurissent les beaux et blancs lotus. Mais il faut de l'adresse à les cueillir ; les lourdauds se mettent à l'eau, remuent la bourbe, font monter à la surface la vase et les mauvaises odeurs, souillent les nobles fleurs. pp. 168-169 [Juin 1903]. 3. La Passade. — Ce que les hommes soumis à l'opinion nomment, d'un terme de mépris, passade, ou, légèrement, fantaisie, caprice, est au contraire la forme la plus pure de l'amour, étant celle où il entre le moins de calculs sociaux. Se rencontrer, se plaire, se le prouver, fuir. Pas de noms échangés, pas de paroles vaines où l'on se vante : une évaluation réciproque purement physiologique ; le mâle choisit la femelle dont il est déjà le choix muet. Nulle tromperie, nulle promesse, une attitude immédiatement agressive, une lutte unique, un seul baiser. C'est l'espèce elle-même dans sa nudité, dans son délire sexuel, dans son désir d'éternité. Tous les mâles et les femelles s'étreignent dans les replis de ce couple seul, et si les têtes se retournent, pendant la fuite, si les regards ont du regret, cet acte aura toute sa beauté puisqu'il a joint à la prompte certitude animale un peu de l'incertitude humaine. pp. 169-170 [Juin 1903]. 4. Anxiété morale. — Quelqu'un prononce : « Qui oserait dire sérieusement que l'anxiété de l'âme contemporaine puisse trouver son remède dans les doctrines de Nietzsche ? » Et je réponds : Qui oserait dire que cette anxiété contemporaine n'est pas d'ordre physique, comme toutes les anxiétés ? Les tissus mollissent, les nerfs se détendent, les hommes inclinent à trouver leur labeur de plus en plus lourd, leurs plaisirs trop rares. L'anxiété contemporaine se réduit à de la paresse engendrée par de l'anémie, et mère de la lâcheté. S'agirait-il d'anxiété religieuse ? Cherchons alors au chapitre des névroses. Il y a aussi des gens qui ont des « phobies » ; on les traite par le brome. Il est très probable que de sages doses de cette drogue auraient un salutaire effet sur l'anxiété religieuse, le scrupule moral, la maladie de la vérité, le délire de la justice. pp. 170-171 [Juin 1903]. 5. Alcoolisme champêtre. — De vieux livres et des traditions chantent les plaisirs du dimanche à la campagne. Filles et garçons, hommes et femmes s'assemblent et jouent. Il y a des danses ; il y a des violoneux et des meneurs de bêtes ; on abat les quilles et on tire à l'arc. Jadis... Mais la Réforme a passé par là. Les protestants ont fait honte aux papistes d'employer si mal le jour du Seigneur, et le concile de Trente a enjoint aux curés de surveiller les mœurs et d'abolir les jeux. L'Église a mis trois siècles à ne pas vaincre la danse, qui n'a été vaincue que par le cabaret. L'alcool, enfin, a remplacé les violons. Que faire à la campagne, à moins qu'on ne boive, un dimanche ? Lire ? L'œil du paysan, comme celui du marin, accommodé au plein air et au lointain, ne se plie pas aux longues lectures. Il faut boire. La religion et la morale commandent de boire. pp. 171-172 Juillet [1903]. La Tragédie serbe. — Le cinquième acte de la tragédie serbe a satisfait pleinement les instincts littéraires et le goût classique de la vieille Europe. Tel que cet événement apparut dans les premières dépêches, sobres, nettes, hautaines, il était beau, mais d'une beauté puissante, irrésistible, de cette beauté qui rend muet qui suspend les gestes, contracte un peu le cœur. Depuis cela, les journalistes, qui sont peintres, ont badigeonné de phrases sentimentales le masque pâle et fatal, déployant tout leur talent à travestir en faits divers ce « récit du messager », digne peut-être d'Eschyle. Ici, le télégraphe fut un grand poète et d'obscurs politiciens, d'honnêtes soldats furent des héros dignes de la scène et du laurier. Quelle simplicité d'action ! Quelle décision dans le mouvement des conjurés, dans ce jeu des bras qui se lèvent et qui retombent ! On pourrait encore louer cette tragédie de s'être savamment pliée aux préceptes d'Aristote et d'abord à la « purgation des passions ». Jamais les rois et les reines qui ne savent pas plaire à leur peuple n'auront été mieux « purgés », dans la personne d'Alexandre et de Draga, de leur bêtise et de leur mauvaise volonté. Les tyranneaux danubiens, et d'autres aussi, vont rouler des yeux plus doux. Nos mœurs sont différentes ? Sans doute, mais les mœurs ne sont pas immuables. Il y a des périodes de lâcheté et de bénignité ; puis, tout à coup, des idées singulières, des idées dures se promènent dans le monde... pp. 172-173 [Juillet 1903]. Pensées d'été. — Ces pensées, ou ces remarques, telles qu'elles suivent, ont leurs racines dans la réalité la plus immédiate. Si on n'indique pas le fait qui les a suggérées, c'est afin d'éviter les paroles inutiles et aussi parce que les faits, décidément, n'ont de valeur que par ce qu'ils soulèvent d'idées, de poussière. p.173
1. Recherche de la vérité. — Les Astronomes, en certains de leurs calculs y considèrent volontiers la terre immobile et le soleil gyrovague. Une simplification pareille s'impose aux idéalistes. Ils parlent et s'occupent du réel, comme si le réel existait réellement. C'est une forme de langage ; mais il faut savoir que le réel des idéalistes, en même temps qu'il n'est qu'une condescendance à l'erreur générale, devient, relativement au sujet sentant et pensant, une indéniable vérité. Le réel ne peut être atteint que nié objectivement et, tout à la fois, affirmé subjectivement. Le monde étant connu par l'esprit, non tel qu'il est, mais tel que l'esprit se le représente d'après les données des sens, autant de cerveaux, autant de mondes différents, malgré les apparences et les concordances générales. De là, la diversité des opinions, et de là l'inanité de la notion vérité. En dehors des sciences exactes qui sont des affirmations ou des explications du principe d'identité, rien n'est vrai ou faux que par le besoin que nous en avons, puisque rien n'est comparable. Les nombres purs s'additionnent, non les nombres chargés de contingences. Toute science qui mérite ce nom se résout, il faut le redire éternellement, en ceci : 1 = 1, proposition qui devient absurde, en dehors de l'utilité sociale, dès qu'on incorpore aux chiffres des qualités. Ainsi 1HO3, n'égale pas 1HO3, sinon dans l'abstrait, parce qu'un verre d'eau quelconque n'est pas égal à un autre verre d'eau. C'est donc l'abstraction qui est la matière de la science ; la réalité est la matière de l'idéalisme. Le point d'appui de l'idéaliste est la sensibilité ; il ne procède que par expériences individuelles ; il ne reconnaît pour bon et mauvais que ce qui lui a été bon ou mauvais. Sa règle, c'est lui-même. S'il généralise, c'est par approximation ; il n'édicte pas de lois, et s'il donne des conseils, il donne avant tout celui d'obéir à sa plus haute tendance et non à des règles extérieures, donc sans valeur ni morale ni expérimentale. Il donnera aussi le conseil de suivre la coutume, non parce qu'elle est juste, mais parce qu'elle est la coutume, c'est-à-dire le plus solide des liens sociaux, peut-être le seul. Sa morale est empirique, parce qu'il ne connaît que des faits. Les prétendus cris de la conscience universelle ne sont pour lui que l'écho des paroles éducatrices ; il peut les admettre comme tradition utile, non pas comme principes. Il ne voit rien de sûr en dehors du désir individuel de vivre, de l'affirmation de chaque force particulière et de ce besoin de continuité qui se satisfait par l'œuvre de la génération. pp. 173-176 2. La Femme et le Roman. — Objet du désir, matière de l'art, passive en amour et en art, la femme qui veut ajouter quelques fleurs à l'antique tapisserie doit travailler à l'envers comme au métier de haute-lisse. L'homme, dans ses poèmes, ses romans, dessine la femme, avant tout ; la femme aussi ; mais cela est gauche, étant fait à l'aveugle. Peinte par elle-même, la femme n'intéresse plus les hommes, qui ne la voient plus telle qu'ils ont l'habitude de se la représenter; ni les femmes, qui ne s'aiment que dans les yeux des hommes, même méchants. Ou bien les femmes créeront un art nouveau qui évoluera autour de l'homme, — et on n'en a connu encore que d'agréables tentatives ; ou bien elles continueront à piétiner derrière l'homme, copiant à l'envers et à rebours ce qu'il vient de peindre à l'endroit. La cause : c'est qu'on ne peut être à la fois sujet et objet. p.176 3. L'Œuvre et l'homme. — C'est tellement la même chose, au fond, nécessairement ! Mais l'œuvre de l'homme supérieur n'a pas toujours la valeur de l'homme lui-même. Elle est moins riche, moins complexe, moins contradictoire ; elle est plus finie, plus impérieuse, plus tyrannique. On y gagne cependant qu'elle est dépouillée, en cet état abstrait, de tout ce qu'il y a, en physiologie, de commun à toute l'humanité, à toute l'animalité. C'est dans leur œuvre, non dans leur vie, qu'il faut étudier les hommes supérieurs, car leur œuvre représente les actes par quoi ils diffèrent, et leurs amours, par exemple, représentent les actes par quoi ils ressemblent. Les jeux de l'instinct de reproduction ne sont pas plus curieux chez Napoléon ou chez Gœthe que chez ce passant obscur qui s'en va en bonne fortune. pp. 176-177 4. La Perspective en littérature. — M. Zola a mal vu le paysan, mais surtout il a mal traduit sa vision. Il ne s'est pas rendu compte de ceci : que ce qui est naturel, en grossièreté, pour un individu grossier, devient répugnant pour un civilisé. En nous montrant les paysans aussi sales qu'ils le sont vraiment, il nous les fait pires ; nous les comparons à nous-mêmes et, pour les juger, il faudrait, ce qui est difficile, ne les comparer qu'à eux-mêmes. Les choses prennent, par l'écriture, qui est trop explicative, un aspect définitif, une importance immobile qu'elles n'ont point dans la vie, où leurs rapports sont en perpétuelle modification. Loin d'appuyer sur les contours, il faudrait les noyer dans l'atmosphère ; il faudrait trouver le point optique où la vision transposée deviendrait conforme à la relative réalité des choses et des êtres observés. Il faudrait beaucoup d'art ou une grande naïveté. pp. 177-178 5. La Glèbe. — Il est très probable que l'expression de serfs attachés à la glèbe exprimait tout autant un état de servitude géographique qu'un état de sujétion sociale imposé par des vainqueurs. Aujourd'hui, les mineurs représentent toute une population attachée à la glèbe. La servitude n'est pas imposée ; elle n'est pas volontaire ; elle est de fait. Serfs de la glèbe, parce qu'ils ne peuvent vivre que là. Il n'est pas besoin de liens ni de clôtures pour fixer un troupeau dans une oasis. Le maître des hommes, ce n'est pas un homme ; c'est le sol. pp. 178-179
6. Le Diabolique Basedow. — C'était un pédagogue. Nul peut-être, si ce n'est son maître Comenius, joliment raillé par Bayle, n'a poussé aussi loin le délire de l'artificiel, la démence du rationalisme. Reprenant, à rebrousse-poil, les théories de l'éducation, au moment où Jean-Jacques, dans l'Emile, débute, il insinue que l'enfant à la mamelle en doit recevoir les bienfaits. La mère, donnant le sein à son petit, dira : sein, sein, tette, tette, répétera sans se lasser les mêmes sons, afin de faire entrer dans la tête innocente de précoces verbes. Ainsi, dit Basedow, la vérité présidera aux premières manifestations de la vie, et la voix de la raison se fera entendre à la place des niaiseries maternelles telles que : mon petit bébé, petit amour, petit cœur, chéri, mignon, etc. « Que les mères sont coupables de n'observer dans leur tendresse aucune méthode ! » Basedow fut un homme diabolique ! p.179 Sur l'Instruction. — D'une lettre : « Que voulez-vous dire au sujet de l'instruction qui vous manque ? je ne pensais pas à cela. Croyez-vous que l'instruction variée et dispersée soit bien utile ? Un peu de tout ? Cela dépend du métier que l'on exerce dans la vie. L'instruction, c'est la mer et ses poissons. C'est immense et énorme. On a, on n'a pas, une intelligence capable de comprendre. Si on l'a, qu'on s'en serve selon les besoins de la vie. Jetez à tout instant votre ligne ou votre filet. Celui qui ne s'instruit pas en vivant ne s'instruira pas en étudiant. La vraie science comme la vraie nourriture est celle que l'on broie soi-même avec des dents saines. » p.180 Marché de la morale. — Après avoir décrit un grand cercle autour du néant des philosophies et des religions, la morale retrouve son point de départ. Les hommes se demandent les uns aux autres, tout bas : l'immoralité, ne serait-ce point la souffrance ? p.180 Religions reconquises. — La religion en Espagne est tyrannique, à l'égal d'un protestantisme ; Cela a l'air d'une objection contre la bénignité relative du catholicisme ; c'en est la confirmation, car le catholicisme d'Espagne est, de même que le protestantisme, une religion toute récente. Il y avait encore des musulmans dans la péninsule au seizième siècle. Une victoire religieuse, une réaction religieuse, voilà de graves périls pour la liberté. Les religions reconquises sont bien plus nocives que celles du même âge historique, qui n'ont pas eu à lutter, qui n'ont pas eu à vaincre. p.181 Sang de religionnaire. — Un politicien écrit (M. Pelletan, je crois) : « On nous a appris dans notre jeunesse qu'il y a eu en France autrefois un régime si abominable qu'un prince du sang pouvait pour rien, pour le plaisir, simplement pour voir s'il visait bien, tirer sur un couvreur qu'il voyait sur un toit, et l'abattre comme un gibier. » Quel style, mais, surtout quel aveu ! Quelle éducation il a reçue, le malheureux ! Sent-on assez la haine traditionnelle du religionnaire contre la royauté créatrice de la France ? p.181 Les injures. — Tous les mots nobles, les mots qui qualifient une supériorité, une beauté, deviennent des injures dans la bouche du peuple et de la classe qui, née immédiatement du peuple, en garde longtemps les instincts envieux. Deux exemples historiques : aristocrate, intellectuel. C'est d'ailleurs une tendance générale : les mots propres se salissent, les mots sales se nettoient, à mesure que s'accentue l'état démocratique. Les termes galants d'aujourd'hui sont : prolétaire, ouvrier, travailleur, les petits, les humbles. Ces fluctuations ne sont pas nouvelles. Toutes les langues en contiennent de très nombreux exemples. C'est un des chapitres importants de la linguistique psychologique. p.182 Août [1903]. La Mort du Pape. — La mort du pape a semblé un événement très important, parce que c'est un événement que deux longévités extrêmes ont rendu très rare. Mais une série peut revenir où les papes se succéderont rapidement, et l'émoi serait fort modéré. La succession au trône pontifical est d'ailleurs réglée par une tradition si ancienne et si solide, le mécanisme en est si ingénieux qu'aucune de ces surprises ne sont possibles qui se rencontrent soit dans le système héréditaire, soit dans le système populaire. Ce Sénat de cardinaux, continuation indirecte, mais réelle et voulue, du Sénat romain, cette assemblée d'hommes, qui ne possède pas le pouvoir et qui cependant le délègue, ces électeurs nommés par un élu et qui vont en élever un autre, quel merveilleux système ! On ne comprend pas qu'aucun état politique ne l'ait adopté, car il serait pour une nation un puissant principe de vie et de perpétuité. Il réunit à peu près tous les avantages que l'on peut demander à une constitution, et si ses inconvénients sont sensibles, ils sont moins graves que ceux que l'on voit dans les monarchies ou dans les autres républiques. Cependant, c'est nécessairement un gouvernement de vieillards, et voilà le défaut. Il suffirait peut-être d'établir une limite d'âge, de prévoir des cardinaux honoraires, en même temps qu'on accroîtrait un peu leur nombre ; quelques remaniements nécessités par le passage de l'état ecclésiastique à l'état politique, et l'on aurait un gouvernement excellent. C'est d'ailleurs celui qui a joué le plus grand rôle dans l'histoire du monde, puisque son modèle est l'empire romain. Son grand principe, de faire abstraction du peuple, serait probablement goûté comme un insigne bienfait par la plus grande partie du peuple, celle qui, s'oubliant dans le travail, est aujourd'hui évincée des faveurs. pp.183-184 Carte intellectuelle de la France. — Au moment où Paris s'en va en province, il est peut-être utile de rappeler Paris au respect de la Province. Paris est producteur de force à la manière d'une machine à vapeur ; mais il faut de la houille à la machine et des hommes à Paris. Les hommes viennent de province ; Paris n'en suscite que fort peu, et ceux qu'il offre à la France sont, en général, des Parisiens récents. Moins la population est dense et plus belle est la plante humaine, plus belle au sens de plus forte, plus riche en sève. Paris est donc dans de mauvaises conditions pour produire l'homme de génie ; cette variété vient de la campagne ; elle naît directement, dirait-on, de la terre arable et de la terre forestière. Un savant anglais, M. Havelock Ellis, a essayé, il y a quelques années, de dessiner une carte de France sur un plan nouveau et très original. Les noms de lieux y sont remplacés par des noms d'hommes. Chaque homme est placé à l'endroit, qui n'est pas nécessairement celui de sa naissance, d'où l'on suppose qu'il a tiré ses qualités héréditaires les plus caractéristiques. Quand le père et la mère viennent de régions différentes, le nom est inscrit en deux endroits différents. Ainsi en est-il pour Victor Hugo. Il n'est inscrit nulle part, soit que les origines du héros se mêlent en un inextricable écheveau : Molière, Saint-Simon ; soit que ces origines soient nettement étrangères ; soit enfin qu'il s'agisse d'un Parisien né de Parisiens, car, dit M. Ellis, « qu'un homme soit né dans une grande capitale, que ses parents y soient nés aussi, cela ne vous dit rien de précis sur sa race véritable. » C'est là, malgré les erreurs inévitables, un travail intéressant et utile, mais peut-être s'appuie-t-il trop exclusivement sur l'idée abstraite de race. Je voudrais qu'une telle carte fût géologique et climatérique en même temps qu'ethnographique : l'homme est un produit du sol. La craie de l'Artois ne peut donner les mêmes caractères que les roches primaires de la Bretagne, ou le terrain jurassique de la Bourgogne. Les poètes semblent naître en abondance dans les terrains primaires ; cela demanderait des recherches précises. Elle porterait moins sur la géologie souterraine que sur les produits du sol et la composition même du tuf qui nourrit les racines. On noterait aussi les rapports entre le genre des esprits supérieurs d'une province et la boisson coutumière. Le vin semble très favorable à la formation du génie, témoin la riche Bourgogne ; mais le cidre ne lui est pas défavorable, témoin le riche Nord-Ouest. Tout est obscur dans cette question qu'un patient travail suffirait cependant à résoudre, au moins extérieurement. Le groupement des faits matériels, s'il donnait des contradictions, comme cela est probable, on aura recours, pour l'établissement définitif de la théorie, à l'examen de la force de réaction contre le milieu qui possède à un haut degré tout être humain supérieur et, à un degré variable, tout homme sain et conscient. Le milieu éducateur laisse toujours une empreinte. L'athéisme de Renan s'enveloppe de religiosité ; la religiosité est le milieu, l'athéisme est la réaction. Mais pourquoi une seule des unités du milieu se dresse-t-elle en opposition au groupe resté homogène ? Là est le mystère. Mais chaque fois qu'il y aura supériorité intellectuelle, supériorité vraie, on pourra supposer que le milieu producteur était imprégné d'un esprit très différent de celui qui se manifeste dans cet individu isolé. C'est le vice de la théorie de Taine, qu'excellente pour déterminer le caractère moyen d'une race, d'un homme ordinaire et soumis, elle échoue complètement à expliquer l'homme extraordinaire, celui qui contrarie les traditions de la famille, qui crève le milieu d'un coup de poing, qui s'élève en souriant au-dessus du moment. Mais, faute de biographies très précises, de généalogies détaillées et motivées, on peut s'en tenir provisoirement aux données ethnographiques et géologiques. L'abondance des génies dans une région signifiera toujours la puissance de la race qui la peuple, son pouvoir supérieur de réaction, sa tendance à l'individualisme. C'est dans cet esprit qu'on peut étudier la carte de M. Ellis. En l'examinant, on s'aperçoit d'abord que la plupart des noms sont écrits à la périphérie et que le triangle formé par Paris, Bordeaux, Lyon est à peu près vide. On doit, il est vrai, y placer Rabelais, Régnier, Pascal mais tout près des côtés : le centre est un bon argument pour ceux qui croient que les hommes supérieurs sont très souvent le produit des races croisées, car il est bien évident que plus on s'éloigne du centre de la France, moins la race est pure. A cela on opposerait la stérilité, au moins relative, de Paris ; mais le compositisme, la promiscuité conduisent à des croisements multiples dont les produits sont instables. Autour du triangle, voici des archipels de noms, voici le groupe breton, le groupe normand, le groupe belge ou flamand, le groupe lorrain, le groupe bourguignon, le groupe dauphinois, le groupe provençal, enfin le groupe du sud-ouest, qui comprend presque toute l'ancienne Aquitaine. La Bretagne donne des poètes : Chateaubriand, Hugo, Villiers, Leconte de Lisle, Brizeux, Corbière, Loti se rattachent tous à la Bretagne, au moins par une de leurs racines. La philosophie exige également de l'imagination. La Bretagne est aussi un pays de philosophes : Abélard, Descartes, Maupertuis, La Mettrie, Broussais, Lamennais, Renan, Th. Ribot. Ses artistes, assez rares, sont d'une originalité particulière : Michel Colomb, Odilon Redon. Rêveur en Bretagne, l'homme est positif et individualiste en Normandie. « Moi ! » crie la Médée de Corneille. La Normandie, quand elle produit des poètes, leur donne des qualités solides, un esprit constructeur : c'est Corneille, c'est Malherbe. Elle est riche en écrivains sérieux : Saint-Evremont, Fontenelle, B. de Saint-Pierre, Flaubert, d'Aurevilly, Maupassant ; en savants : La Place, Le Verrier. Beaucoup de peintres : Poussin, Millet, Géricault, Jules Breton, Cazin. La Picardie est un pays de métaphysiciens religieux ou politiques : Pierre l'Hermite, Suger, Calvin, Malebranche, Robespierre, Daunou. Ses écrivains sont : Sainte-Beuve et Paul Bourget, esprits critiques ; ses poètes sont médiocrement poètes : Voiture, Gresset. Un seul grand artiste : La Tour. Le groupe flamand est au contraire producteur de poètes : Racine, Desbordes-Valmore, Verlaine, Coppée, Samain, H. de Régnier ; d'artistes : Jean de Bologne, Watteau, Pater. Son grand historien est à la fois un rêveur et un curieux, Froissart. Beaucoup de rêve aussi en Lorraine ; rêve religieux : Jeanne d'Arc ; rêve fantaisiste : Callot ; rêve coloriste : Claude Gellée. Et quel plus grand rêveur que Hugo ? Peu d'écrivains, mais solides : Joinville, les Goncourt. La Lorraine est très pauvre de savants. C'est le contraire en Bourgogne, où l'on trouve Jussieu. Ampère, Claude Bernard, Pasteur, Monge, Buffon, Lalande, Bichat, et un écrivain à tendances scientifiques, Diderot. Elle donna aussi des mystiques, poètes ou religieux : saint Bernard, Bonnet, Quinet, Lamartine ; des conteurs sans préjugés, Bonaventure des Perriers, Piron, Crébillon fils. C'est aussi un verger d'artistes : Rameau, Greuze, Prudhon, Rude, Courbet, Clésinger. Entre la Bourgogne et le Dauphiné, il y a le Lyonnais. Ce pays, qui fut le premier centre chrétien des Gaules, est demeuré un laboratoire d'hérésies religieuses et philosophiques. Ballanche et Puvis de Chavannes ne représentent pas médiocrement les Lyonnais. Il y a en eux quelque chose de mystérieux qui se devine et qui ne s'est jamais nettement formulé. Bien supérieur en vitalité, le Dauphiné produit avant tout les hommes raisonnables. Ses artistes mêmes ont de la sagesse : « La prudence et l'énergie, disait Berlioz, dauphinois pur, voilà les deux moyens du succès. » Les grands Dauphinois sont Lesdiguières, Barnave, Mounet, Condillac, Mably, Condorcet, d'Alembert, Champollion, Vaucanson, les Perier, et Stendhal, ce parfait résumé d'une race où la logique tempère facilement la fantaisie. En passant à la Provence, on entre dans une région toute différente. La pensée s'extériorise en paroles, et souvent la parole est toute la pensée. Pays d'orateurs : Mirabeau, Massillon, Guizot Thiers, Gambetta ; d'improvisateurs : Mistral et les felibres ; de conteurs : Gautier, Daudet, et Silvestre, pays capable cependant de force artistique ou philosophique : Puget, Daumier, Gassendi, Vauvenargues, Rivarol, Chénier. La région des Pyrénées et la Gascogne, c'est la terre des capitans et des capitaines : Lannes, Murat, Soult, Bernadotte, pays aussi des capitans littéraires, tels que Cyrano de Bergerac, La Calprenède, Brantôme, et des capitans de la sainteté, Vincent de Paul, François Xavier. Mais l'Aquitaine est encore capable de philosophie et de science : Montaigne, Montesquieu, Bayle, Fermat, Dupuytren. Balzac, qui est un psychologue, se rattache, par sa mère, à cette région assez féconde. En remontant vers la Bretagne, on traverse une région fort pauvre en esprits supérieurs puis on trouve le groupe Angevin-Tourangeau, qui nous donne des poètes, Ronsard, Du Bellay. Rabelais vient de là, d'entre Tours et Poitiers. Enfin, produit unique de la région des volcans, voici Pascal, qui remplit à lui seul le grand désert du centre plutonien. De cette rapide et incomplète revue, quelle conclusion ? Y a-t-il vraiment une région des poètes, une région des savants, une région des philosophes ? Malgré quelques apparences, non. C'est probablement que le régime géologique est fort varié en France, sauf en certaines régions. On serait cependant tenté d'attribuer au terrain primaire une certaine productivité en poètes non musicaux mais de pensée, en poètes à la manière de Chateaubriand et de Renan : la Bretagne et l'extrémité ouest de la Normandie sont de roches primaires. Un des terrains les plus féconds en hommes de forte intellectualité serait le jurassique : c'est celui de la Bourgogne et de partie de la Lorraine. Le terrain tertiaire, qui règne en haute Normandie et dans une large partie du sud-ouest, semblerait également apte à de belles productions humaines. Le crétacé donnerait volontiers des mystiques soit en poésie, soit en religion et en politique. Enfin le terrain volcanique représenterait la stérilité, une stérilité tempérée par quelque rare floraison : Pascal. Je livre à quelque patient chercheur cette idée d'un rapport entre la nature géologique du sol et la nature intellectuelle de l'homme. On s'occuperait alors non plus seulement de l'homme de génie, mais de l'homme moyen, bien équilibré. Le rapport est certain ; il est nécessaire. On le trouvera, si on le cherche. pp.184-193 Septembre [1903]. Choses religieuses. — Nous sommes donc en pleine guerre de religion, en pleine guerre héroï-comique ; les temps du Lutrin sont revenus. On ferme les chapelles visitées par les touristes, et on laïcise les écoles qui allaient fermer, faute d'élèves. Rien d'amusant comme cette opération : une religieuse en cornette est remplacée par une religieuse sans cornette ; pour le reste, mêmes sentiments moyens, même intelligence moyenne, même moralisme, — et la messe ! La laïque va à la messe par ordre ; l'autre y allait par goût. Gain immense ! On ferme les couvents. Les expulsés persistent, rentrent ; seize francs d'amende. On recommencera dans six mois. Cela occupe la magistrature et procure aux journaux de la copie gratuite. Des gens se croient persécutés ; d'autres persécuteurs. Chacun, à peu de frais, satisfait à sa manie, — et des trains qui n'en finissent plus charrient les badauds vers les plages. Y a-t-il vraiment un public qu'amuse cette monotone comédie ? Il est rare. Les journaux qui en vivent le cultivent. Dans la réalité sociale, une grande indifférence règne. Cependant, les libres-penseurs, ces derniers dévots, exultent ; mais ce sont des âmes simples, faciles à satisfaire. Ce paysan, à qui je parle de cela, me répond qu'il a pu rentrer ses foins, malgré le temps, et que le blé, versé par la pluie, se redresse. Le paysan est d'un grand intérêt : il a le sens du réel. Il distingue aussitôt entre l'utile et l'inutile, ce qui est de profit et ce qui est de jeu. Mais le paysan n'est pas tout, même dans les labours qui sont son œuvre et notre vie ; dans la bourgade, il n'est presque plus rien, et plus rien du tout dans la ville. Là règne l'idéaliste, le penseur. On pense beaucoup en France : on repense les journaux : belle matière à ruminer. On surveille la civilisation, on la défend contre le cléricalisme avec des arguments cléricaux. « Ne croyez pas, dit M. Lavisse, qu'on néglige la morale dans les écoles. Au contraire. On y enseigne la morale avec soin, et la morale traditionnelle, la morale chrétienne. » M. Lavisse pourrait même ajouter, avec Nietzsche : « Plus la morale est émancipée de la théologie, plus elle devient impérieuse. » Que les braves gens se rassurent : plus on laïcise les écoles et plus les écoles sont morales, c'est-à-dire chrétiennes, puisque la seule morale connue aujourd'hui est la morale chrétienne. Ce qui peut arriver de plus bête au voyageur, c'est de tourner joyeusement sur soi-même, et de repasser toujours au même endroit, en croyant avoir fait un long- chemin vers le but. Son excuse parfois est que la route trompeuse qu'il a prise est la seule route. L'état des esprits est tel en France que toute guerre au christianisme tourne en faveur du christianisme. Alors, il vaut mieux, lorsque l'on n'est pas chrétien, demeurer tranquille, attendre. Et puis, les questions religieuses sont vraiment dénuées d'intérêt. La question est résolue. Passons à autre chose et laissons les Eglises se partager les derniers fidèles. Les espèces en train de mourir sont presque toujours inoffensives ; elles songent à ne pas mourir, et ne songent plus qu'à cela. Il est sot de les provoquer, de les éveiller de leur torpeur, de les forcer à se souvenir qu'elles ont des muscles et un appareil de défense. pp.193-196 [Septembre 1903]. Curiosités théologiques : la superstition dans le protestantisme. — Plutôt que de combattre les religions, il faudrait les étudier, pendant qu'il est temps, comme phénomène humain, et peut-être passager. Certes la superstition est aussi vigoureuse aujourd'hui que jadis, et rien ne fait présager sa fin : mais tout a une fin, cependant, et des deux, la science et la religion, l'une périra. Gageons pour la survivance de la science, sans nous dissimuler que, très probablement, la partie immuable de la science passera à l'état de dogme et s'incorporera à la vieille sentimentalité religieuse. Les antiseptiques commencent à jouer, dans les familles, un rôle pas très différent de celui de l'eau bénite au moyen âge ; on les emploie à tort et à travers, sans aucune notion exacte de leur mode d'utilité : acte de foi, acte religieux. Une religion ne peut être autre chose qu'un système de superstitions. Ce système est plus ou moins compliqué, plus ou moins logique, voilà tout. Le protestantisme ne saurait échapper à cette définition. Entre lui et telle autre religion, le catholicisme romain, par exemple, il ne peut y avoir que des différences extérieures et de méthode. Voici un des traits par lesquels les prédicateurs protestants expliquent le « salut par la foi ». Cela est pris dans un livret de propagande intitulé les Chèques du Seigneur : « Quand je vais réclamer le montant d'un chèque, me disait un vieux missionnaire qui a, durant quarante années, en Chine, fait l'expérience de la fidélité de Dieu, le banquier ne s'informe pas si je suis un homme de mérite, mais il regarde soigneusement la signature de mon chèque, et si cette signature lui paraît bonne, il me donne mon argent sans difficulté aucune. Or, Dieu est votre banquier, les Promesses dont sa Parole est remplie sont autant de chèques qu'il vous permet de lui réclamer, et quand nous lui apportons une pétition signée du nom de son Fils, il ne peut que nous l'accorder, car cette signature-là est bonne. » Cette petite parabole, si remarquable par sa logique, est fort caractéristique. Prise au hasard entre un millier d'autres de même ton, elle permettra de faire comprendre la superstition protestante. Comme le paganisme romain, dont il est l'héritier, le catholicisme possède une quantité de petits dieux, les saints, auxquels la piété populaire assigne des offices particuliers. Cela n'existe pas dans le protestantisme, qui s'est modelé de son mieux sur le monothéisme sémitique ; mais il faut que la superstition se retrouve : quelle est la forme que prend la superstition dans les sectes protestantes ? Avant d'avoir parcouru plusieurs centaines de petites brochures de dévotion protestante, je ne me l'expliquais pas bien ; le tract m'a éclairé, et je sais. Toutes les fonctions spéciales que les catholiques ont partagées entre leurs saints, les protestants en chargent un dieu unique, Jésus. C'est la mentalité sémitique opposée à la mentalité aryenne. On se trouve en présence d'une cervelle enfantine qui, ayant trouvé une cause, en fait la Cause. A un degré plus haut d'intelligence, on cherche les causes multiples et variées de la vie ; et au degré supérieur, celui de l'esprit scientifique, on ne s'occupe plus du tout de la Cause, que l'on considère comme le produit d'un arrêt dans le raisonnement, et on admet un nombre indéfini de causes qui sont en même temps des effets : il n'y a plus ni grands ni petits dieux, ni dieu ni saints ; il y a des faits. La croyance en une cause unique est certainement la plus dangereuse superstition dans laquelle l'humanité puisse tomber. Tout le raisonnement en est faussé ; la vue du monde en est viciée ; on ne peut rien comprendre à la vie, ni même aimer la vie. Il est très probable que la notion de la providence est le mensonge qui a fait le plus de mal aux hommes. Quand on croit à la providence, on n'a pas le droit de rire de la plus grossière pratique fétichiste ; la providence est un fétiche près duquel tous les autres sont raisonnables. L'intrusion de la providence dans la vie des protestants prend des formes bien curieuses. Cette divinité, le plus souvent appelée Jésus, revêt alors tous les déguisements de Protée. « Viens à Jésus ! » dit une de leurs feuilles pieuses ; et elle énumère tous les cas où il est suprême de venir à Jésus : quand on a trop de travail, quand on porte des fardeaux, quand on est dans une situation embarrassée (ici, le chèque s'impose) ; quand on est pauvre, triste, malade, en deuil, quand on pleure ; quand on a peur de la mort, quand on a besoin de vêtements, quand on a faim : Viens à Jésus ! Adresse-toi directement à lui. Ce dieu à tout faire est chargé par les dévots, des plus amusantes besognes. Une bonne femme demandait à saint Antoine de Padoue de lui faire gagner le gros lot et lui offrait une commission sur l'affaire ; un pasteur protestant, dont je détiens le journal inédit, demande crûment à Jésus de payer pour lui trois mille francs qu'il doit à M. Carrard, banquier à Genève (1). Tout le long du cahier ce sont des requêtes ; il demande de l'argent, de l'avancement, des faveurs. Mais, en retour, il donne à son dieu de précieux avertissements : qu'il prenne garde, car Satan dresse ses embûches à Angers et à Rennes. Espérons que Jésus a désintéressé M. Carrard. Les deux religions diffèrent surtout par le mécanisme ; dans la plus ancienne, et qui n'a jamais été réformée, il est très compliqué et très souple ; dans l'autre, il est simple et dur. Comme système de culture, les deux cléricalismes sont également exécrables, mais je crois que le plus simple est aussi le plus tyrannique et aussi celui qui pénètre le mieux jusqu'au fond de l'intelligence. Mais il y a des intelligences et non une intelligence à force unique ; les unes ou les autres craindront davantage l'un de ces deux poisons, selon qu'elles se sentiront disposées à se laisser séduire soit par la complexité, soit par la simplicité. (1) Voir plus loin, page 214 [273e épilogue]. [Septembre 1903]. Le Métropolitain. — L'idée de la rançon du progrès n'est pas du tout familière aux hommes. C'est d'ailleurs une idée fausse dans ses termes, comme celle, de même ordre, contenue dans l'expression, que des sots ont voulue lapidaire, « justice immanente ». Il n'y a pas de justice ni manente, ni immanente, ni absolue, ni relative. Il y a dans la marche des choses une logique qui nous est difficilement accessible, à cause de l'immense complexité, du mécanisme vital dont nous faisons partie. Les courbes se coupent et se recoupent à l'infini ; tout arrive et rien n'arrive ; il se peut que la chose prévue n'arrive pas et que l'imprévue se manifeste. Le Métropolitain aurait pu fonctionner pendant de longues années sans accident grave ; mais il y avait autant, sinon plus de probabilités, pour que cet accident se produisît. En général, une invention nouvelle, si elle est chargée de risques, ces risques éclatent dans la période qui suit la première application, alors que, rassurée par le succès, l'attention se repose un peu. On peut aussi affirmer que plus l'accident tarde à paraître, plus il sera sérieux, le matériel ayant eu le temps de se détériorer. Le Métropolitain a été heureux, car il n'a fait parler de lui que deux ans après sa mise en marche, et ce premier accident grave n'a pas dépassé, en importance, ce qui était à prévoir logiquement. Car personne de sensé n'a jamais cru, je pense, qu'on provoquerait chaque jour par milliers des cours-circuits au milieu de matières inflammables sans qu'il en résultât jamais que d'inoffensives illuminations. L'incendie devait se produire, et il se reproduira, à moins d'une invention nouvelle — comme se reproduiront les déraillements et les abordages. Et ces choses fâcheuses arrivent, non parce qu'il faut que « tout se paie », idée qui n'a aucun sens, mais parce que deux lignes droites se coupent dès qu'elles cessent d'être parallèles, — et que la parallélité absolue et indéfinie est une chimère. Une barre de fer se détache : il y avait une paille dans l'écrou, dans celui-ci, précisément, et non dans un autre. L'attitude des hommes devant l'accident est intéressante. Ils le considèrent comme un illogisme, et se fâchent. L'accident est logique. Octobre [1903]. [ Octobre 1903]. La superstition dans le protestantisme pièce justificative (1). — Une petite revue de littérature suisse a bien voulu contester l'authenticité du principal document cité au sujet de la superstition protestante dans les derniers Epilogues. Si c'est une feinte pour en apprendre plus long, je vais satisfaire cette curiosité légitime. Aussi bien, ce sont là des études psychologiques d'un certain intérêt ; des chercheurs désintéressés me l'ont assuré : je poursuis donc. Mais une remarque préjudicielle est nécessaire. Ce serait une erreur de croire, comme le suppose cette même revue genevoise, que je suis animé d'une haine fanatique contre le protestantisme. Le fanatisme m'est inconnu. Je n'ai pas plus de haine contre le protestantisme qu'un médecin contre la malaria ; et précisément je considère le protestantisme comme une malaria spirituelle des plus fâcheuses. Ce n'est pas que je professe une tendresse beaucoup plus vive pour le catholicisme, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui ; mais il me choque moins, c'est un fait, sans doute parce que j'y suis acclimaté. En des études de ce genre, il faut toujours tenir compte de la religion initiale du critique, car elle peut avoir un double effet, et contraire, soit qu'elle le rende plus indulgent, soit qu'elle augmente sa sévérité : cela dépend des tempéraments, des tendances psychologiques, de certains principes généraux adoptés par l'esprit. Quant aux religions critiquées, et c'est le même phénomène s'il s'agit de systèmes philosophiques ou de méthodes morales, elles imaginent toujours que le critique est mu par une animosité particulière et même personnelle. Les coléoptères, dirait un fabuliste, supposent une grande haine de leur race dans le chasseur d'insectes qui les poursuit ; mais le chasseur cependant n'éprouve que de la curiosité et n'a que le désir d'enrichir ses collections. Je ne pense pas non plus qu'à l'Institut Pasteur on ait de la haine contre les microbes de la fièvre paludéenne. La superstition m'intéresse beaucoup ; tant, que je supporte difficilement qu'une religion s'en prétende dépourvue. J'ai donc cherché, sûr de trouver, la forme qu'elle prend dans le protestantisme, et j'ai démontré que la croyance superstitieuse, au lieu de s'éparpiller sur une multitude de dieux secondaires, se concentre et se fixe sur un dieu unique appelé Jésus ou Christ. J'en ai donné quelques exemples, j'en aurais pu donner beaucoup, si je n'avais craint d'ennuyer en insistant trop. Mais, la méthode étant connue, tout le monde peut maintenant corroborer mon hypothèse en compulsant la triste littérature que j'ai feuilletée moi-même. Ainsi se trouverait vérifiée absolument une petite découverte dont je suis assez fier, car elle confirme cette loi générale que rien ne se perd, mais que tout se transforme. Le prophète juif ou le piétiste protestant qui ramènent tout à Dieu suivent une méthode qui ne diffère qu'en apparence de celle du dévot païen ou catholique qui distribue à des dieux différents des fonctions limitées. Prier Jésus ou prier S. Antoine de Padoue, ce sont des superstitions équivalentes, et la seconde n'est pas plus déraisonnable que la première, car s'il existe un Dieu tout-puissant, conscient et volontaire, entouré d'élus, on ne voit pas bien pourquoi il n'utiliserait pas ces élus oisifs en leur conférant certains pouvoirs. Le culte des saints est d'une logique merveilleuse, aussi inattaquable, le surnaturel admis, que le polythéisme lui-même dont il dérive et dont il n'est qu'une modification. Transportée sur le terrain philosophique, la question serait celle de l'unité ou de la multiplicité des forces. Il est facile, en théorie, de ramener toutes les forces à une force unique et tous les corps à un corps unique ; mais c'est là une pure conception de l'esprit et dans la pratique scientifique il faut compter avec la multiplicité des forces et la multiplicité des corps. La croyance à l'unité n'est sans doute qu'une illusion synthétique. Nous prêtons au monde cette unité que nous nous attribuons à nous-mêmes et qui n'est qu'une chimère. L'homme n'a qu'une âme, son âme ; le monde n'a qu'une âme, Dieu ou la Force unique. Rêveries où il est sage de ne pas participer, car le monde n'est pas qu'une représentation humaine : il y a autant de mondes qu'il y a sur terre d'espèces animales, de systèmes nerveux différents. En redescendant aux religions, on trouvera donc qu'il y en a, vues sous cet angle, de deux sortes : les religions analytiques et les religions synthétiques. C'est à une religion d'un synthétisme rigoureux qu'appartenait le pasteur protestant dont j'ai cité la méthode simplificatrice. Je n'ai pu découvrir le nom de ce brave homme qui semble avoir été malheureux (2). En 1837, il était à Lausanne ; en 1840, à Wahern ; en 1842 à Genève ; en 1849 à Lyon ; puis successivement, jusqu'en 1870, à Thiat, à Lens, à Mazamet, à Rennes, à Cherbourg, à Angers, tantôt pasteur, tantôt professeur. Il parle de son Eglise, de la Cène qu'il a ou non célébrée. Son état de pasteur est indéniable. Une partie du journal que je possède est rédigée en allemand, parfois sous des caractères grecs ; mais le français domine, parfois aussi dissimulé par des lettres grecques. Ce journal ne se rapporte qu'à l'année 1870, mais les premières pages présentent un résumé mystique de sa vie, un rappel des grandes dates religieuses qu'il ne peut oublier. On y trouve, à la date du 4 septembre, une allusion aux événements : « O Dieu, sauve la France et délivre ses habitants des mains de la guerre. » Presque partout ailleurs, il ne s'occupe que de lui-même, de sa famille, de son Eglise. Ce sont des prières ; ainsi écrites, elles prennent l'apparence comique de lettres adressées à Dieu. Et ce sont en effet des lettres, car il note la réponse, qu'il croit s'être manifestée sous la forme d'un don, d'une grâce. Dieu lui est familier et il est familier avec Dieu. C'est un client qui s'adresse à un patron bienveillant, mais un peu dur d'oreille et qui, d'ailleurs, a mille et mille affaires en tête. Aussi faut-il lui répéter souvent la même supplique. L'impétrant, pourvu d'une foi inébranlable, ne perd jamais confiance : si Dieu ne pense pas à lui aujourd'hui, ce sera pour demain. N'ont-ils pas des intérêts communs ? N'est-il pas le ministre de sa religion ? Ses demandes sont presque toujours précises, quoique emmêlées dans un fâcheux verbiage. Le 25 juin, il dit à Dieu : « Veuille m'envoyer le nécessaire en argent, en vêtements et en nourriture pour nos enfants et pour nous. » Le 29 mai, c'était une requête analogue : « Donne-moi : 1° la foi et la prudence de la charité... 2° des ressources pécuniaires pour faire largement face aux exigences d'Angers, de Rennes et de Vaud... » Vaud, c'est Lausanne, c'est le banquier Carrard (3). Voici la plus grande partie de cette lettre adressée à Jésus, où il est question de M. Carrard : « Le 13 septembre. Mardi. 1870. O Jésus ! Avant toutes choses, je viens me jeter à tes pieds, les embrasser, les arroser de mes larmes et les essuyer de mes cheveux. Hélas ! L'aiguillon de ta lumière m'a pénétré d'outre en outre d'une telle vue de mon péché que jamais je n'ai été si pénétré ! Si je suis à l'abri du blâme humain, je n'en suis que plus coupable dans le secret ! Guéris, renouvelle et sauve ma pauvre âme. Mais avant tout, applique-lui par ton Esprit une seule goutte de ton sang précieux pour la purifier et la justifier... Tu sais le mal qui m'a été fait en 42, en 49, en 52. Tu sais comment j'ai été circonvenu à Angers et ailleurs ! L'Esprit de contradiction a demandé la ruine de toutes mes relations, la ruine de ma femme, de mes enfants et de mes sœurs ! La ruine de mon ministère ! Tu sais que j'ai emprunté 3.000 fr. à M. Carrard, banquier à Lausanne, pour répondre à l'appel du frère Robineau à Angers ! Vois maintenant comment j'ai été traité ! sans affection ! sans bonne foi ! sans délicatesse !! à la merci de gens qui ne te connaissent pas !... Délivre-moi de l'agonie de la dette de 3.000 fr. à M. Carrard. Délivre-moi de l'horrible position morale et matérielle qui m'est faite à Rennes ! Rends-moi la joie du cœur, la santé du corps et de l'âme, la voix pour chanter tes louanges et veuille me secourir ! Envoie-moi des secours de mon frère !... Oh ! Jésus ! Que je ne t'aie pas invoqué en vain ! O Dieu, pour l'amour de ton Fils, sois apaisé envers moi qui suis pécheur et fais que, quand je relirai ces lignes, je puisse admirer ta bonté dans l'exaucement de ma supplication. Amen ! » Il revient, le 9 octobre, sur la question Carrard qui n'a pas été résolue : « Veuille me secourir à Lausanne ! Fais que, quand je relirai cette page, je puisse me réjouir de ce que tu m'auras exaucé ! » Et encore le 13 octobre, dans ce jargon : « Incline des cœurs généreux à me venir en aide pour ce dont ***(4) ». Et ceci qui est vraiment délicieux d'astuce dévote : « ***(5) ! » En voilà assez, je pense, pour rassurer sur l'authenticité du document que je signalais. Il n'est pas sans valeur psychologique. C'est la sensibilité toute pure qui parle dans ce fragment de journal ; c'est un cœur simple de croyant qui s'ouvre — ou s'entr'ouvre, car le personnage est prudent et même rusé, comme le montrent ses déguisements d'écriture. C'est dans l'âme des simples qu'il faut chercher la vraie religion, comme le pensait M. Renan, de même qu'il faut regarder la nature là où elle a été le moins gâtée par l'homme. Regardons dans l'âme de ce bon ministre du Saint Evangile : est-il tant que cela supérieur, je ne dis pas à un dévot catholique, mais à un nègre pieux qui interroge son fétiche ? ***
(l) Voir plus haut, page 196. Novembre [1903]. [Novembre 1903]. La Libre-Pensée. — Mais il faut revenir sur cette locution et voir ce qu'elle contient. Renan était libre-penseur. Loin de rejeter cette qualification, il la revendiquait comme un titre. Mais il n'est pas le libre-penseur type. M. Homais, non plus. Le type libre-penseur est moyen, comme tous les types. Il n'est ni tout à fait intelligent ni tout à fait stupide. Son intelligence consiste dans un certain sens critique, fort limité, mais assez droit à l'intérieur de ses limites. Sa stupidité, ou plutôt sa bêtise, n'est, le plus souvent, qu'un mélange d'ignorance et d'entêtement ou de fatuité. Ignorance parce que : ou il ignore ce qu'il rejette, ou il ignore ce qu'il admet ; sa critique ne porte jamais que sur un côté. En quoi il ressemble singulièrement au croyant. Autre ressemblance : il possède la vérité, soit qu'il l'ait cherchée en conscience et nécessairement trouvée, soit qu'il la détienne de naissance, soit qu'il l'ait « gagnée », comme on gagne la fièvre. On pourrait peindre le croyant et le libre-penseur par des traits communs ; aucun de ces traits ne conviendrait ni au savant, ni au philosophe, ni à l'homme d'un métier, qu'il fût un peintre comme Millet, un conteur comme Maupassant, ou le premier artisan venu et qui n'est que cela. Cela veut dire que, chez le libre-penseur comme chez le clérical, le métier est de croire, tandis que, chez le maçon, le métier est de maçonner. Shakespeare, en somme, maçonnait, et Spinoza aussi. Car la différence que je cherche, je ne la trouve pas dans le fait de manier des abstractions ou de manier des réalités ; elle réside plutôt dans le fait d'une activité utile opposée à une activité inutile. Un homme pauvre, indemne de la mentalité cléricale ou libre-penseuse, que désire-t-il, s'il est malade ? De bons soins donnés par un médecin habile et des infirmiers adroits et patients. Le libre-penseur exige d'abord que ce personnel soit laïque, c'est-à-dire libre-penseur; et le clérical, qu'il soit religieux, c'est-à-dire clérical. « Chacun, dit Spinoza, ne peut s'empêcher de désirer que ses semblables vivent à sa guise, approuvent ce qui lui agrée et repoussent ce qui lui déplaît (1). » Le libre-penseur et le clérical exercent cette tendance avec acharnement, faisant porter leurs efforts sur le genre de prosélytisme qui embrasse les activités les plus vaines, les plus enfantines. Disputer sur les croyances, c'est, selon le mot de Nietzsche, disputer des goûts et des couleurs, et pire, car il n'y a là pour l'homme sage matière à aucune sensation, à aucune impression. La délibération du sénat romain sur la sauce du turbot est un modèle d'activité utile, si on la compare (même sans la connaître) aux discours qui peuvent se tenir dans un concile ou dans un congrès de libres-penseurs. Malheureusement, ces enfantillages ont une influence immense sur la marche générale de la civilisation humaine et même sur la destinée des turbots, car l'église favorise la cuisine, cependant que la libre-pensée est spartiate. Il faut donc effacer tout ce que nous venons de dire, ou, du moins, ne le considérer que comme une analyse provisoire faite aux lumières trop vives de l'indifférence. Pascal a posé l'ignorance comme condition de vie : « Le monde juge bien des choses, car lui est dans l'ignorance naturelle, qui est le vrai siège de l'homme. » Nietzsche indique la bêtise. C'est la même idée. Le troupeau, en somme, est meilleur juge que le berger de l'herbe qui lui convient. Si les hommes s'intéressent si fort aux questions religieuses, c'est qu'après tout rien, peut-être, ne leur est plus utile. Or quand il s'agit de distinguer ce qui leur est utile d'avec ce qui leur est inutile, les hommes sont infaillibles. Notre raison a beau se révolter, il faut en venir là. J'appelle cela le Principe d'utilité. On en ferait la clef de toutes choses. Avec cette clef, on ouvrirait des portes qui n'ont jamais cédé (2). Rien donc n'est plus raisonnable, d'après le principe d'utilité et aussi d'après les axiomes cités, de Spinoza, de Pascal et de Nietzsche que la présente lutte entre les cléricaux et les libres-penseurs puisque c'est une lutte entre deux autorités de même ordre, de même essence, basées sur les mêmes assises, la croyance. Ici comme toujours, le contenu de la croyance, qui importe pour nous, est d'une valeur considérable pour chacun des deux partis ; mais eux seuls peuvent en juger. Il y a des fleurs séchées, de vieilles lettres, des jarretières que des hommes de sentiment ne donneraient pas pour une fortune. La croyance des libres-penseurs ou des cléricaux contient des trésors du même ordre : qui oserait les évaluer ? Que la croyance fasse ou non appel à la raison cela est indifférent. Le monde se fait de la raison, comme du reste, l'idée qui lui est le plus utile. On a parfaitement démontré que le mystère de la Sainte Trinité ne blesse nullement la raison ; et les libres-penseurs sont généralement d'accord pour affirmer, au nom même de la raison, l'égalité absolue de tous les hommes. Nietzsche n'a pas écrit « Par delà le vrai et le faux ». C'est un livre à faire. Par delà le vrai et le faux, on trouve l'utile. Je pense que la distinction entre le vrai et le faux rentre dans ces essais de classifications primitives si bien analysées par MM. Durkheim et Mauss (3). Ces classifications qui nous semblent purement arbitraires, étant tout à fait différentes de la classification technique (animaux marins, animaux terrestres, le solide, le liquide, etc.), semblent explicables par le principe d'utilité. Ainsi les Chinois classent toutes choses selon les quatre points cardinaux et leurs divisions et leurs subdivisions. Cette classification « est le principe même de la fameuse doctrine du Fung-Shui, et, par là, elle détermine l'orientation des édifices, la fondation des villes et des maisons, l'établissement des tombes et des cimetières ; si l'on fait ici tels travaux et là tels autres, si l'on entreprend certaines affaires à telle ou telle époque, c'est pour des raisons fondées sur cette systématique traditionnelle ». Remarquez ceci : pour des raisons. C'est très bien dit. La raison affirme au Chinois que la terre est au nord-est et au centre alternativement. C'est pour eux une vérité ; et c'est une vérité pour les Zunis, peuplade californienne, qui usent d'un système analogue, qu'à l'est appartiennent la terre, les semences et les gelées ; et c'en était une pour les Grecs que le feu était sous la dépendance de Mars, et l'eau, sous celle de Saturne. L'utilité de ces classifications, réside dans le fait même qu'elles sont des classifications. Il y a des personnes simples, ou très pratiques, qui classent leurs livres d'après le format. Cela paraît absurde : que l'on réfléchisse, et l'on verra que cela peut être fort commode si le nombre des volumes est restreint. Ces mêmes livres, on les trouvera encore classés selon le meuble qui leur est assigné comme résidence ; Virgile appartient au placard de la chambre bleue et Racine à la vitrine du salon. Les peuples de civilisation européenne, depuis les temps de la philosophie grecque, semblent avoir usé avec prédilection du système de classification binaire ; c'est la classification par antithèse : Bon-Mauvais ; Vrai-Faux ; Jour-Nuit, etc. Sous ces chefs, qui vont toujours deux par deux, ils ont rangé le monde entier, choses et notions, êtres et idées, et nous en sommes toujours là. Cependant, l'analyse sous chacun des deux termes associés reconnaît partout et toujours cette idée sous-entendue : Utile-Nuisible. Le bon, le vrai, le jour (le clair), c'est l'utile ; le mauvais, le faux, l'obscur, c'est le nuisible. Les progrès du langage et de la pensée ont permis d'établir des divisions qualitatives dans le primordial Bon-Mauvais et de le nuancer selon toutes les catégories de la sensibilité, tellement que son sens véritable, qui est Utile-Nuisible, semble impossible à découvrir sous la formule binaire Vrai-Faux. Il y est cependant ; ce qui est vrai, c'est ce qu'il nous est utile de considérer comme vrai. Comment les hommes, dupés par les mots ont-ils fini par ériger toute une science de la beauté, une science du bien, comment de cette duperie primitive est sortie toute la civilisation intellectuelle, c'est ce qu'un historien des idées établirait facilement. Mais il ne devrait jamais perdre de vue que ces mots superbes, outre leur sens idéal, en possèdent un autre, plus ancien et toujours vivant : utilité. La lutte actuelle pour la vérité, pour la raison entreprise contre une autre forme de la vérité une autre forme de la raison, n'est donc que la lutte entre une utilité ancienne et une utilité nouvelle. Très peu d'hommes peuvent vivre dans la liberté ou dans le doute, ce qui est la même chose. II faut au peuple une foi ; il le sent, et il veut croire. Il s'enquiert même de la qualité de la croyance, qui n'a aucune importance réelle pour lui, car ce qui lui est utile dans la croyance ce n'est pas, comme il se l'imagine, son contenu, mais la méthode qu'elle implique. Le peuple a besoin d'un principe d'action ; or, le doute n'est pas un principe d'action ; ni la formule politique du doute, qui est le libéralisme. Il faut au peuple, et par peuple j'entends tous les hommes qui vivent pour vivre, un catéchisme universel : comment manger, comment s'habiller, comment penser, comment aimer. Ceci est-il bien ? Ceci est-il bon ? Ceci est-il vrai ? Ceci est-il du nord ? Ceci est-il de l'ouest ? La liberté le jette dans un embarras immense. Ou bien, plus ahuri que l'âne de Buridan, il louche éternellement vers les deux picotins ; ou bien il se jette en des actes contradictoires et burlesques. Que l'on regarde le seul pays où existe vraiment la liberté religieuse, les Etats-Unis : c'est un amas de sectes dont le seul but semble la culture intensive de la bêtise humaine. De toutes les libertés inutiles au peuple, la plus inutile est la liberté religieuse, et c'est la plus dangereuse aussi. Plus sérieux, étant plus anciennement et plus profondément civilisé, le peuple de France n'en veut pas ; il le manifeste aujourd'hui aussi nettement qu'au jour de la Saint-Barthèlemy. Les uns ou les autres, les cléricaux ou les anti-cléricaux désirent également, au fond de leur cœur, une religion ou une irréligion d'Etat. Ils ne voient nul milieu. Les libéraux, cependant, contemplent, effarés, cette lutte qui leur semble démente et qui est, au contraire, infiniment raisonnable. Leur politique d'amateurs, de voyeurs, est tout à fait incompréhensible pour le peuple ; le peuple veut jouer des reins. La cause de l'explosion de l'anti-cléricalisme, il ne faut donc pas la chercher, comme les libres-penseurs le croient avec une naïveté qui les perdra, dans les excès d'autorité du cléricalisme. C'est, au contraire, parce que le christianisme s'est désintéressé de l'exercice de l'autorité, quand il la détenait, qu'il a suscité contre lui une secte rivale. La lutte, il faut le redire, n'est nullement entre la liberté de penser et la non-liberté de penser; elle est entre une secte qui ne sait plus imposer aux hommes sa vision du monde, et une secte qui semble décidée à tout faire pour gouverner strictement les esprits. Tout l'avenir de l'anti-cléricalisme est là, dans la fermeté avec laquelle il saura établir et maintenir sa tyrannie. Les persécutions sont rarement fructueuses contre les idées nouvelles ; elles le sont presque toujours contre les idées anciennes. Que de complicités la libre-pensée ne va-t-elle pas rencontrer pour l'établissement de sa domination ! Elle flatte les instincts les plus récents, c'est-à-dire les plus sensibles, du peuple : la confiance toute neuve qu'il a dans la raison, la vérité, la justice. Ils doivent réussir. Ils ont déjà, ce qui est énorme, partagé le pays en deux factions rivales et enragées, et ils sont la plus forte. Combien je regrette de ne pouvoir me faire libre-penseur ! Mais je ne puis. Cela serait, pour moi, rétrograder. Je désire me maintenir au delà du vrai et du faux, dans la région d'où l'on peut observer les actes des hommes, non sans passion, ce qui serait fort ennuyeux, mais sans parti pris, — ce qui ne laisse pas, d'ailleurs, d'avoir ses inconvénients. (1) Traité politique, I, 5. (2) Cela diffère de la théorie des « attitudes d'utilité » de M. de Gaultier, en ceci que, pour moi, l'attitude universelle et permanente d'utilité est la seule possible. Mais les utilités sont diverses et engendrent des conflits. Il y a aussi l'imitation de l'utilité. (3) Année sociologique (1901-1902). — Cf. aussi un compte-rendu méthodique de cette étude dans l'Œuvre nouvelle, oct.1903. Si l'on peut penser librement. — C'est une question que les hommes ne se posent pas. Elle est pour tout le monde, ou presque, résolue par son énoncé même. S'il y a quelque chose de libre au monde, c'est la pensée. La pensée est immatérielle ; elle évolue en dehors des contingences. Un homme qui pense, pense librement. C'est au point que, si la pensée d'un homme intelligent diverge trop de la raison, il y a présomption d'hypocrisie. Et l'on peut continuer ainsi très longtemps. Le sujet prête aux belles phrases. Aussi les orateurs l'ont-ils raboté avec prédilection, faisant jaillir éperdument les copeaux de leur éloquence. Le barreau non moins que la tribune, l'académie de même que la chaire sont propices à ces exercices dilatoires, l'éloge de la liberté de la pensée étant le meilleur des prétextes à ne point penser du tout. Si l'on veut être sérieux, il faut bien avouer que la pensée est matérielle, si l'on conçoit la matière comme substance unique ; ou bien c'est la matière qui est spirituelle, et cela revient au même. On ne peut pas concevoir le corps et l'esprit, le corps soumis à la loi de causalité et l'esprit passant librement à travers les mailles du filet. La pensée est un produit physiologique. Elle est si peu immatérielle qu'elle ne se peut manifester que sous une forme particulièrement sensible : la parole, l'écriture, les combinaisons du dessin et de la musique. La pensée n'existe qu'à condition de se faire plastique. Mais, avant même qu'elle ne sorte, on sent sa matérialité ; elle bourdonne dans le cerveau comme l'essaim dans la ruche. Son travail est si peu immatériel qu'on attrape fort bien la migraine à force de penser et même une inflammation des tissus cérébraux. C'est une bien curieuse illusion que celle de la liberté, et très utile à l'homme ; on peut la garder, tout en sachant fort bien que c'est une illusion. Cela n'a d'ailleurs d'importance que pour les gens qui écrivent et qui tiennent à limiter le nombre des sottises sur lesquelles on les jugera. Que l'homme et sa pensée soient ou non considérés comme libres, cela ne peut avoir aucune influence ni sur l'homme total, ni en particulier sur sa pensée. Les croyances philosophiques ou religieuses ne sont pas des principes ; elles sont des résultats. La sensibilité nous mène ici ou là, vers ce qui nous convient, comme la soif mène le cerf à la fontaine. Parfois nous ne savons quel désir nous tourmente et nous errons, mais que le ruisseau luise sous les roseaux, et nous ressentons presque du même coup les affres du besoin et la joie du réconfort. Voyez ces Anglo-Saxons d'Amérique, si fort tourmentés de la faim religieuse, avec quels cris d'assentiment ils se précipitent vers la grosse caisse de l'Armée du salut, vers la caisse du nouvel Elie ! Et parmi nous, ne suffit-il pas d'agiter une banderolle où il y a écrit Raison, pour que des milliers d'alouettes sentent le besoin de la glu qui va les clouer ? Il y a des appeaux moins grossiers, il y en a de délicats : les uns et les autres sont tels que se les crée l'âme qui veut être prise. Chacun se tisse son filet, construit sa cage, compose son philtre, selon sa force, sa taille, son goût. II est impossible de trouver en tout cela une place pour la liberté de la pensée, attendu qu'il s'agit de pur sentiment, où le raisonnement n'intervient que pour ratifier, nécessairement, une décision prise par la sensibilité toute seule et sur laquelle ne peut avoir aucune influence la logique intellectuelle. C'est pourtant aux faits de cette catégorie que l'on applique à l'exclusion de tous les autres, et au mépris même de la vraisemblance, l'expression de libre-pensée. Penser librement, selon le vocabulaire commun, c'est avoir des opinions religieuses particulières. On ne pense librement qu'en religion, en métaphysique, en morale spéculative, c'est-à-dire quand il s'agit de matières fantasmagoriques, malléables à l'infini selon le caprice personnel. Ces matières cependant ne représentent qu'une très petite partie de l'encyclopédie sur laquelle peut s'exercer la pensée. Pense-t-on librement en physique, en biologie, en géographie, en statistique, en minéralogie ? Le diocèse de la libre-pensée est un minuscule canton, perdu dans les Alpes, ou une petite île de l'Océanie, égarée sur la mer immense. Les anciens habitants de l'île de Pâques appelaient leur radeau de sable et de roches « le nombril de la mer », car jamais aucun d'eux n'avait vu une autre terre que le médiocre îlot auquel ils étaient attachés comme des pucerons sur une scabieuse. La loi Falloux. — Elle autorisait tout indigène orné du diplôme élémentaire de bachelier à ouvrir un collège, à enseigner ou à faire enseigner les matières adéquates. Loi libérale, certes, encore que fabriquée, dit-on, dans le but de favoriser les congrégations et le clergé. On vient de la modifier ; on exigera des suppléments de peaux tannées et couvertes de signes ; quel intérêt ? Est-il si difficile de devenir licencié, agrégé ? Question de patience, d'encre et d'huile. Considérez un peu nos agrégés des journaux : qui voudrait leur confier un enfant à gaver ? Ah que les diplômes mandarins sont fallacieux ! Ce que l'on veut, en vérité, c'est écarter de l'enseignement les curés de toute robe. Soit. Mais ils ôteront leur robe. Ils se marieront même, comme les protestants, — et n'en seront pas moins des curés. Un curé et sa femme, cela fera deux curés, une double influence, et d'autant plus puissante qu'elle se glissera invisible ; les pays protestants sont dominés par leurs curés à un degré que la France ne peut imaginer. Supposons que les nôtres soient des malfaiteurs : ils ont un uniforme, et vous voulez le leur enlever ! Mais les fabricants de lois ont la vue courte et l'entendement bref. Ils croient d'abord que les lois sont faites pour être obéies, alors que c'est tout le contraire, et que, pour un Français, après le plaisir de tourner lui-même la loi, il n'en est pas de plus grand que de voir ses concitoyens se livrer au même jeu. Cependant le gouvernement protège les bonnes mœurs, récompense les bonnes lettres, décore la bonne conduite, encourage toutes les attitudes serviles, tient à l'écart de tous honneurs, de toutes fonctions les hommes d'esprit vraiment libre et nomme un certain M. Ehrhardt professeur de Morale évangélique à la Sorbonne ! Guerre à la guerre. — Des antimilitaristes, dans une réunion publique, rencontrant des nationalistes, leur ont déclaré la guerre, en criant (sans doute), selon le rite : guerre à la guerre ! Le sang coula avec abondance, même celui d'une jeune femme égarée parmi ces gladiateurs philanthropes. La méchanceté est toujours unie à la bêtise. Il n'y a d'attitude antimilitariste convenable, propre et logique, que celle de Tolstoï, celle qu'il prêche à ses partisans, celle qu'il encourage chez certains sectaires religieux : la résistance passive. Qu'elle soit très intelligente, c'est une autre question, mais elle n'est pas méprisable. Quant à ceux qui affirment par des coups leur amour de la paix, s'ils voulaient. démontrer la nécessité d'être le plus fort, ils n'agiraient pas autrement. Ce sont des imbéciles, en somme, et qui obligent à protester ceux-là mêmes qui sont pourvus d'un esprit fort peu militariste. Y a-t-il vraiment en France des militaristes, c'est-à-dire, si les mots ont un sens, des gens partisans de la suprématie de l'armée, du gouvernement par l'armée ? Il y en a eu. On n'en trouverait plus un seul, peut-être, même parmi les officiers. S'il s'agit de convaincre l'humanité de l'inutilité des armées et des flottes de guerre, ce n'est pas à nous qu'il faut s'adresser, mais à l'empereur allemand et à M. Chamberlain. Cette idée de lion malade : se faire rogner les griffes et les crocs pour engager le tigre à en faire autant et le taureau à raser ses cornes ! Prends garde, lion, le tigre va te manger la cervelle et le taureau va t'ouvrir le ventre. Ce n'est pas que le service obligatoire, la caserne et les grandes manœuvres me semblent le dernier mot de la civilisation. Il n'est pas beaucoup plus raisonnable d'obliger tout le monde à être soldat que gendarme, gardien de la paix, facteur ou douanier. Les Anglais, qui sont entêtés, ont persisté à faire de l'état militaire un métier. Payer le soldat, lui assurer une vie honorable, et surtout ne pas le prendre de force : il n'y a pas d'autre solution. On peut aussi supprimer la guerre, redresser l'écliptique et obliger la lune à éclairer en plein toutes les nuits. Fourier y avait songé. Cruauté des philanthropes. — On écrit à la Revue du Bien à peu près ceci : J'ai voulu placer dans un orphelinat quelconque, officiel, libre, religieux ou laïque, un enfant de trois ans né d'une fille-mère sortant de prison. Je n'ai pu, parce que, entre autres obstacles, « la mère refusait de signer l'abandon de son enfant ». Mœurs charmantes. Ce sont celles de l'Assistance publique, Moloch qui donne le ton. Une femme pauvre ne peut plus, comme dans les temps abhorrés de jadis, confier pendant quelques années à un hospice le soin de son enfant. C'est tout ou rien. Elle doit signer l'abandon absolu : et toutes les précautions sont prises pour qu'aucun signe n'en permette jamais la reconnaissance même fortuite. C'est ce que l'on appelle de la philanthropie. Mais qu'en font-ils de ces enfants ? Les vendent-ils comme esclaves ? En font-ils des pâtés ? La Monnaie de nickel. — Cette petite invasion officielle de pièces fausses a été généralement mal accueillie. On aurait tenté de s'y faire, de dresser ses doigts et ses yeux, si ce jeton avait été de quelque utilité. Malheureusement il n'en a aucune ; il ne supplée nullement la monnaie de cuivre. Cinq sous en un seul morceau, cela aurait fait la joie du Juif Errant. Les Juifs ne sont plus errants, et cinq sous, cela ne correspond à rien, ni au timbre courant, ni à la place de tramway, ni à l'achat d'un grand journal, ni aux cigares les plus connus. C'est que nous sommes restés dans nos usages très fidèles au vieux système duodécimal. Trois sous, six sous, sont les menus débours les plus fréquents. Le douze sous tend même à se substituer aux dix sous. La douzaine est restée une des unités de compte les plus usitées. Nous nous torturons bien sottement en voulant contrarier l'utilité pratique au bénéfice d'un système idéal, et notre compte par chimériques centimes est aussi ridicule, à bien réfléchir, que les mystérieux reis portugais. La Femme naturelle, l'Alcool naturel. — L'idée de la bonté de ce qui est naturel a mis un peu plus de cent ans à atteindre le paysan. C'est fait, et il y en a pour des milliers d'années. L'alcool industriel, bien rectifié, proprement fait, est mauvais ; mais l'alcool naturel, fabriqué dans une mauvaise chaudière par des gens sales, est bon, parce qu'il est naturel. Tel est le fruit de la philosophie optimiste et rationaliste des Rousseau et des Laclos. Quand on pense au ravage que font les idées chez les illettrés, on regrette vraiment qu'il n'y ait pas deux écritures, une démotique et une hiératique, comme chez les anciens Egyptiens. pp. 239-240. |