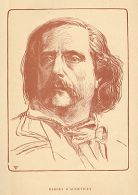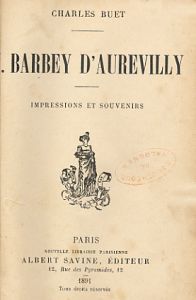|
Barbey d'Aurevilly (1808-1889) |
|
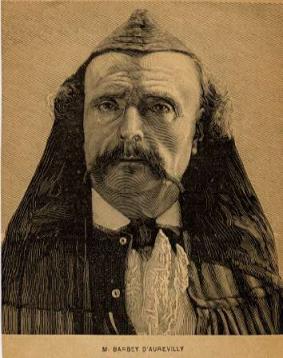 Il est plus triste pour Barbey d'Aurevilly que pour Victor Hugo que l'auteur d'une Vieille maîtresse ait écrit : « Il faut se hâter de parler des Contemplations, car c'est un des livres qui doivent descendre vite dans l'oubli des hommes. Il va s'y enfoncer sous le poids de ses douze mille vers. C'est, en effet, un livre accablant pour la mémoire de M. V. Hugo et c'est à dessein que nous écrivons la « mémoire ». A dater des Contemplation, M. Hugo n'existe plus. » Et voilà. L'histoire littéraire est quelquefois bien amusante. Je ne connaissais pas ce jugement, je l'avoue, étant peu familier avec les œuvres critiques de Barbey d'Aurevilly, mais il ne saurait me surprendre de la part de celui qui a écrit tant d'absurdités sur Gœthe. Il serait trop facile de lui retourner son mot, ce que je pense d'ailleurs qu'on a déjà fait, et de dire de la critique de Barbey d'Aurevilly qu'elle n'existe pas ou plus, depuis longtemps, sinon comme source de comique. Les contemporains furent, on doit le dire, en grande partie de l'avis du critique catholique. (« Les Ennemis de Victor Hugo », Promenades littéraires, 5e série, Mercure de France, 1913)
Barbey d'Aurevilly est une des figures les plus originales de la littérature du dix-neuvième siècle. Il est probable qu'il excitera longtemps la curiosité, qu'il restera longtemps l'un de ces classiques singuliers et comme souterrains qui sont la véritable vie de la littérature française. Leur autel est au fond d'une crypte, mais où les fidèles descendent volontiers, cependant que le temple des grands saints ouvre au soleil son vide et son ennui. Ils sont un peu dans les lettres ce que sont dans la vie les moechi de Sainte-Beuve, les adultères. On les tient à l'écart de la famille, on craint de les approcher, mais on les regarde et on est content de les avoir vus. Ce ne sont pas des monstres ; au contraire, on les trouve trop beaux et trop libres. Lentement, avec de persévérantes précautions, les ecclésiastiques et les professeurs les écartent des bibliothèques, les cachent dans les armoires : bien en lumière, en pleine poussière, brillent la morale et la raison. Mais il y a toujours un clan qui se rit de la morale et qui mésestime la raison. Ces méchants, qui nous conservèrent Martial et Pétrone, préfèrent aujourd'hui Baudelaire à Lamartine, d'Aurevilly à George Sand, Villiers à Daudet, Verlaine à M. Sully Prudhomme. Cela fait qu'il y a deux littératures, l'une qui s'accommode aux tendances conservatrices, l'autre aux tendances destructrices de l'humanité. Et ainsi rien n'est jamais tout à fait conservé, ni tout à fait détruit ; chacun gagne à son tour à la loterie et cela fournit aux hommes cultivés d'éternels sujets de controverse. Barbey d'Aurevilly n'est pas un de ces hommes qui s'imposent à l'admiration banale. Il est complexe et capricieux. Les uns le tiennent pour un écrivain chrétien, en font une sorte de Veuillot romantique ; d'autres dénoncent son immoralité et sa diabolique audace. Il y a de tout cela en lui : de là des contradictions qui ne furent pas seulement successives. On voit bien qu'il fut d'abord athée et immoraliste ; mais quand une crise l'eut rejeté vers la religion, il demeura immoraliste ainsi qu'en sa première phase, et cela parut singulier. On ne sut jamais bien, ni peut-être lui-même, si son catholicisme baudelairien coïncidait avec une foi très profonde. « Il croit croire, » avait-on dit de Chateaubriand. Barbey d'Aurevilly était peut-être au contraire tellement assuré de sa croyance qu'il prenait avec elle toutes sortes de libertés, même celle de lui être infidèle. C'est aussi qu'il avait étudié assez profondément l'histoire pour avoir appris que les meilleurs catholiques et les plus utiles à leur religion et à leur parti furent en même temps de grands païens. La race d'où il sortait est une des moins religieuses de la France, quoiqu'une des plus attachées aux pratiques extérieures et traditionnelles du culte. L'influence du sol, du climat, est ici nettement visible : les Danois demeurés dans leur pays ont incliné, avec les siècles, vers une religiosité sombre, toute repliée dans l'obscurité de la conscience ; ils portent leur foi en leur coeur comme le paysan portait un serpent dans son giron. Devenue normande, cette race naïve s'est épanouie au scepticisme avec une prudente lenteur. D'une incrédulité intime, elle manifeste une foi publique, presque uniquement sociale. Elle tient peu au prône, mais beaucoup à la messe, qui est une fête ; elle aime ses églises et se désintéresse des curés. Ayant construit quelques-unes des plus belles abbayes et cathédrales de France, elle oublia de les pourvoir de moines et de chanoines, de rentes et de terres. Bien avant la Révolution, les abbayes étaient désertes. A la mise en vente des biens du clergé, encore plus que les paysans désintéressée dans la religion, la noblesse acheta, sans hésitation, sans trouble : les chefs de la race donnaient l'exemple du scepticisme. Très peu religieux, le Normand (on entend la Basse-Normandie, la région qui forma Barbey d'Aurevilly) ne supporte l'autorité que lointaine, invisible ; il est profondément individualiste, d'un patriotisme fort modéré. Aimant la terre, il s'en détache pourtant facilement, car un autre goût le porte aux aventures. Il allait volontiers guerroyer au loin ; à cette heure il y va faire du commerce. D'une assez grande curiosité d'esprit, il goûte l'instruction et toutes les activités intellectuelles ou qui gravitent autour de l'exercice de l'intelligence. La région d'entre Valognes et Granville, qui fournit quelques-uns des plus hardis imprimeurs des XVe et XVIe siècles, s'est fait du commerce des livres un véritable monopole ; parmi les écrivains la proportion des Normands est toujours énorme. Ces caractères généraux se retrouvent assez précis en Barbey d'Aurevilly. Comme le Normand moyen, il est dénué de religiosité profonde, mais attaché à certaines formes et traditions religieuses ; il est individualiste jusqu'au scandale, ne supporte de l'autorité que l'idée qu'il s'en fait ; d'abord plein de tendresse pour sa terre natale, il la quitte sans regret, pour revenir plus tard l'aimer encore ; né dans un milieu où la culture est toute de tradition, il sent le besoin de notions plus nouvelles et part à leur conquête, avec l'imprévoyance d'un chevalier d'aventure. Comme il est armé très sommairement et que son caractère est des moins souples, la lutte sera longue. Il lui faudra cinquante ans pour toucher d'une main tremblante une gloire incertaine. Barbey d'Aurevilly naquit en 1808 à Saint-Sauveur-le-Vicomte, non loin de Valognes, d'une de ces familles bourgeoises où l'ancien régime recrutait infatigablement son aristocratie. Le roi conférait la noblesse comme aujourd'hui la croix, mais avec plus de sobriété et à meilleur escient ; on décorait la famille en même temps que l'homme, on intéressait à la grandeur de l'État un groupe dont chaque année augmenterait l'importance. Des charges vénales assuraient la noblesse ; on pouvait aussi l'acheter, et c'est cela encore qui rattache le plus étroitement les moeurs d'aujourd'hui à celles d'avant-hier. La noblesse de Barbey d'Aurevilly date exactement de l'année 1765 ; il en est de plus récentes. Sa grand'mère fut une La Blaierie, sa mère une Ango (les Ango s'étaient déjà alliés avec les Barbey), elle-même petite-fille, très probablement, de Louis XV. Voilà donc une ascendance heureusement variée : de solides paysans et des aristocrates du Cotentin, les armateurs dieppois, les Bourbons. En faut-il tant pour faire un Barbey d'Aurevilly ? Peut-être. Les races pures donnent des produits plus unis. Ernestine Ango n'aimait que son mari, ne voyait que lui. Théophile Barbey, sombre, muet, vit forclos dans sa religion royaliste. L'enfant n'est choyé que par sa grand'mère La Blaierie ; elle a connu le chevalier des Touches et lui en conte les aventures. L'autre influence qu'il subit est celle de son cousin Edelestand du Méril, qui a sept ans de plus que lui. C'est de ce futur maître de l'érudition médiévale qu'il reçoit l'initiation littéraire : elle est romantique, tempérée par Corneille et par Racine que lui fait aimer son précepteur, M. Groult. Il a quinze ans, il envoie des vers à Casimir Delavigne, qui lui répond (2). Ensuite on le dépêche à Stanislas où « il perd la foi » et, excellente compensation, gagne l'amitié de son condisciple, Maurice de Guérin alors très loin du christianisme, et qui n'y retourna peut-être jamais que dans les illusions de sa soeur (3). De 1829 à 1833, Barbey d'Aurevilly étudie le droit à Caen, fait la connaissance de Trébutien, fonde une « revue républicaine », la Revue de Caen, cependant que son frère lui oppose une revue royaliste, le Momus Normand, publie son premier conte, Léa, et soutient une thèse « d'une platitude rare de pensée et de style » sur les Causes qui suspendent le cours de la prescription. A cette époque, il commence à s'intéresser à la politique ; il est républicain et communaliste : « Déployons donc la bannière municipale ! Que les communes nouvelles se lèvent, comme se levèrent, au XIIe siècle, les vieilles communes françaises !... » ; il préconise le suffrage universel, entend que l'on pousse à sa conclusion « le mouvement social commencé en 89 et continué en juillet 1830 ». Comme on veut le marier, il s'échappe, muni d'un petit héritage personnel, s'établit à Paris, voyage, revient, rêve, rime, blasphème, écrit des poèmes en prose et un roman singulier, Germaine, qui ne verra le jour qu'en 1884, sous ce titre : Ce qui ne meurt pas. La politique, qui va le reprendre, l'ennuie comme presque tout le reste ; ses seules joies sont de sensualité : un « bel animal » le console de ne plus croire à rien, de ne s'intéresser à rien. Un retour momentané à Saint-Sauveur lui prouve qu'il a même perdu l'amour de son sol natal : « La patrie, écrit-il dans son Memorandum, ce sont les habitudes, et les miennes ne sont pas ici, n'y ont jamais été. » Cependant, ses idées républicaines l'abandonnent ; lui qui, par principe, n'a voulu porter que son vieux nom tout bref, « Barbey », y ajoute maintenant le « d'Aurevilly » auquel il a droit ; il se souvient que son arrière-grand-père acheta jadis une charge et un titre d'écuyer. Etait-ce une preuve de sagesse et de raison ? C'est possible, car il faut user dans la vie de tous ses avantages, fuir la modestie comme un vice, et, si l'on veut arriver, paraître tout d'abord ce que l'on deviendra. Maurice de Guérin va se marier ; cela le fait réfléchir : « Qui n'a pas besoin d'un foyer ? Byron n'en médisait tant que parce qu'on avait détruit le sien. » Le romantique traverse une telle crise de sagesse qu'il consent à écrire dans le Journal officiel de l'Instruction publique, que dirige son ami Amédée Renée. Il se discipline : « Je crois, dit-il en août 1837, que je me refroidis intérieurement, ce serait tant mieux ; la poésie des passions ne me touche guère plus. » Dès l'automne, il collabore à l'Europe, soutenant la politique de M. Thiers. Le voilà entré dans le journalisme ; il n'en sortira qu'à sa mort, après y avoir passé plus de cinquante ans. Dès lors sa vie a deux faces : celle du polémiste, celle de l'écrivain. Elle va même se compliquer davantage, puisque sur ses idées acquises de paganisme et d'immoralisme va se regreffer la vieille maladie traditionnelle, la religion. Le premier Memorandum s'achève sur ces mots : « Mourez ici, dernières folies d'un coeur brisé ! » Un travail intérieur et sur lequel on n'a que des renseignements assez vagues se fit en Barbey d'Aurevilly de 1838 à 1846. Pendant qu'il se donne avec fièvre au journalisme, au moment même de ses plus violentes querelles avec la Quotidienne, il fait une rencontre qui semble avoir influé sur ses idées. Eugénie de Guérin est venue voir son frère ; Barbey la regarde et l'écoute avec une curiosité profonde et troublée dont on trouve la trace dans son second Memorandum ; mais, dit M. Grelé, il fut en réalité plus ému qu'il ne l'avoue. « Il n'oublia jamais la soeur de son cher Guérin. Il eut pour elle une sorte d'admiration muette, tout intellectuelle d'abord, puis très probablement sentimentale et passionnée. De son côté Eugénie –– l'adorablement laide Eugénie, dont la laideur fascinait –– ne resta point indifférente... (4). » C'est là le commencement de la crise ; elle s'accentua à la mort de Maurice, qui fut pour lui un coup très douloureux. Mais elle n'éclata pas encore. Barbey d'Aurevilly a la force de chercher une diversion et il la trouve dans le travail : il achève l'Amour impossible et commence Une vieille Maîtresse. Son Brummel l'occupe aussi ; il essaie de le placer à la Revue des Deux Mondes. Buloz « se prosterne pour refuser », mais il refuse ; c'est Trébutien qui l'éditera à Caen, en un précieux petit volume. L'Amour impossible n'avait eu qu'un succès assez vague ; l'auteur s'en console en voyant s'entr'ouvrir devant lui la lourde porte du Journal des Débats. Entre deux livres, il est allé à Dieppe, faire élire le candidat de l'opposition ; il est fier de sa victoire, se proclame pompeusement « un Warwick électoral ». La position de Barbey d'Aurevilly dans les lettres est à ce moment assez équivoque. Ce mélange de littérature et de médiocre politique déroute. Si on insistait on trouverait d'autres motifs de surprise : une collaboration trop accentuée, trop prise au sérieux à des journaux de mode. Il y a là beaucoup de souplesse, il y en a trop. S'intéresser au même moment à Brummel et à Innocent III, non pas en passant, comme dans une causerie, mais longuement, profondément, c'est singulier. Barbey était plus près de Brummel ; mais il se croyait plus près d'Innocent III. Cette méprise lui fera écrire bien des choses inutiles, sinon dangereuses pour sa réputation. Mais si son talent était, à cette époque, trop maniable, son caractère l'était fort peu. S'il se galvaude, c'est avec insolence ; il malmène le public, qui se fâche, le journal se ferme et la médiocrité de sa fortune l'oblige à s'enquérir d'une nouvelle tâche. Un écrivain n'est pas une abstraction ; il faut lui tenir compte des obstacles extérieurs que la vie lui suscite et aussi des obstacles intérieurs, des noeuds, des rugosités et des épines qui font l'écorce de certains talents. On a pris thème du dandysme qu'affectait Barbey d'Aurevilly pour le présenter tel qu'un homme surtout occupé à étonner ses contemporains. Je crois que, caractère très complexe, très sensible en même temps que très orgueilleux, il voulut à la fois plaire et déplaire. Il y a dans sa tenue une extraordinaire maladresse. Ecrivain ou dandy, il manque très souvent ses effets, par trop de fièvre, trop de sincérité. Car cet individualiste est sincère jusqu'à la folie. Ses excentricités sont invincibles. Se plier à la mode, qu'il s'agisse du vêtement, des idées ou du style, il ne le fera jamais. On vient de l'appeler, avec un dédain qui n'est que de l'étourderie, « un romantique attardé ». Quand on meurt à quatre-vingts ans la plume à la main, on est nécessairement « un attardé ». Il faudrait se demander la figure qu'aurait faite dans les lettres Théophile Gautier, s'il eût vécu et écrit jusqu'en 1892. Barbey est né six ans après Victor Hugo, trois ans avant Gautier : il a vingt-deux ans en 1830 quand Musset en a vingt. Cet attardé du romantisme est le contemporain exact des grands romantiques. La critique littéraire est fort inutile, donc fort méprisable, si elle néglige les données scientifiques élémentaires, qui sont les faits et les dates. N'est-elle pas méprisable, la diatribe contre Barbey où ce qu'il y a de successif dans sa vie est groupé en rond autour de ce point central, « romantique attardé » ? Dans ce système, un poème publié en 1830 est un argument aussi bon que le roman écrit en 1880 ; ainsi abstraits du moment et du milieu les faits disent ce que l'on veut ; leur signification n'est réelle que si on les considère dans leur ordre de causalité. Mais la méthode du « rond » est plus expéditive et plus favorable au développement de la sottise et du parti pris. Le livre de M. Grelé est cependant un bon guide pour n'y pas tomber ; il est scientifiquement construit, il est successif : chaque acte y est mis à sa place vraie dans la série. Ce n'est pas la facile dissertation critique, c'est le recueil logique et prudent des faits dont la suite compose une vie. Le Barbey d'Aurevilly d'après 1846 est très différent de celui des premières années. C'est à ce moment qu'une nouvelle contradiction s'ajoute à toutes celles qui se battent dans cet organisme violent. Il devient catholique. A l'influence obscure d'Eugénie de Guérin est venue se surajouter celle, plus certaine, de Raymond Brucker, ce prototype, sans génie, de Louis Veuillot. On a retrouvé la foi (Brucker aussi était un converti), on veut le prouver, on fonde une Société catholique pour la régénération de l'art religieux et une Revue du monde catholique pour la régénération de la pensée religieuse. La révolution de 1848, qui évoluait cependant sous les auspices du clergé, fit chavirer ces deux barques. Barbey suit le mouvement. Les vingt mille affiliés au Club des ouvriers de la Fraternité le choisissent pour président ; il prononce des discours, invective le peuple, se sauve loin de cette mascarade, va retrouver sa « vieille maîtresse ». Car, comme le note justement M. Grelé, « s'il pense en catholique, il a toujours l'imagination païenne ». Ce livre, commencé il y a trois ou quatre ans, il va l'achever selon le ton initial, mais en lui ajustant un autre cadre : c'est en Normandie que cette histoire romantique va s'enraciner. A cette époque, on trouve dans sa correspondance avec Trébutien le programme, tel qu'il le remplira, de ses contes et de ses romans sur la Basse-Normandie. C'est d'Aurevilly qui a créé en France le « roman de terroir » ; rien de pareil, ayant une valeur littéraire, n'existe avant le Chevalier Destouches, l'Ensorcelée, le Prêtre marié. La province que peint Balzac n'est pas une province particulière, et plus, un coin limité de pays connu, senti, aimé depuis l'enfance ; Balzac veut conter la Province comme il conte Paris et il place ces deux termes en un état d'opposition qui est devenu traditionnel et banal. Barbey d'Aurevilly ne regarde qu'un canton, mais il y embrasse tout, terre, mer et ciel, villages et cités, noblesse, bourgeoisie, paysans, pêcheurs. Sans doute, il ne se contente pas de ses souvenirs, il se documente, une lettre à Trébutien en fait foi, mais ce qu'on lui apportera de nouveau, il est en mesure de le juger, de le contrôler. Il dit les mots nets là où Balzac s'embrouille dans une périphrase ; il est du cru ; il n'a pas appris à quarante ans le langage de ses « poissonniers », il le sait d'enfance. Ces romans, d'abord ébauchés, n'acquièrent que lentement leur forme définitive. Barbey, qui travaille beaucoup, poursuit deux séries divergentes, ses romans normands auxquels il destine ce titre général, l'Ouest, et les Oeuvres et les Hommes, où il entend juger la pensée, les actes et la littérature de son temps. Ce n'est que bien plus tard qu'on lira sur des volumes ces mots trop orgueilleux, mais la première pierre de ce monument fragile est posée dès le mois de mai 1851 ; cela s'appelle les Prophètes du passé. La Vieille Maîtresse avait paru le mois précédent. Trébutien, homme simple, image du public candide, est surpris. D'Aurevilly réplique : « Le catholicisme est la science du bien et du mal... Soyons mâles, larges, opulents comme la vérité éternelle. » Il se flatte que le roman n'est pas une oeuvre moins catholique que le livre des Prophètes ; il voudrait faire comprendre que la peinture de la passion n'est pas l'apologie de la passion. Ce sera la théorie de Baudelaire et sa défense inutile devant une magistrature stupide. Hypocrite chez Baudelaire, cette opinion avait chez Barbey une certaine sincérité, qui garda intact son individualisme jusque dans le mysticisme religieux. Il y a décidément une différence entre sa religion et celle de Chateaubriand. Barbey d'Aurevilly ne croit que ce qu'il veut croire. La période du second Empire est assez favorable à l'auteur, toujours légitimiste, mais rallié, des Prophètes du passé. Il collabore au Pays, publie le Journal d'Eugénie de Guérin, défend noblement les Fleurs du mal (5), que Sainte-Beuve abandonna à leur sort. Très inférieur à Sainte-Beuve dans la critique, cela est l'évidence même, Barbey n'est pas sans clairvoyance. L'homme qui, en 1856, met à leur vraie place et Baudelaire et Augier (6), rend cette année-là un grand service à la pensée française. Dans le même temps, il venge Balzac que la Revue des Deux Mondes a traité à peu près avec la même équité qu'elle traitera quarante-cinq ans plus tard Barbey d'Aurevilly lui-même. On a la rancune longue dans les vieilles villes mortes. L'un de ces timides bravaches s'appelait Poitou ; celui d'hier a nom Doumic. Hélas ! rien ne change ; un sot trouve toujours un sot qui le remplace. L'histoire littéraire, comme l'autre, pourrait peut-être s'écrire une fois pour toutes. Il n'y aurait que les noms propres à changer : « J'ai reçu cette semaine, écrit d'Aurevilly, le 1er février 1857, en cadeau et hommage, un beau médaillon, en bronze, de Balzac, encadré en chêne, d'un grand style. C'est le médaillon de David d'Angers ; Mme de Balzac me l'a envoyé avec une fort belle lettre, en me remerciant de ma défense de son mari contre les ruades sans fers du Poitou. » Barbey, qui avait le premier, à propos de la Légende des siècles, si justement caractérisé Hugo, en l'appelant un « génie épique », s'indigna de l'insolente réclame qui chantait les Misérables ainsi qu'un produit industriel. Il écrivait dans le Pays ; les républicains et les royalistes, alors très unis, crurent que le fier critique obéissait à un ordre du pouvoir : il fut fort malmené. La même haine qui avait poursuivi le mysticisme précurseur du peintre Galimard (7) persécuta Barbey d'Aurevilly. L'imagination restreinte de la jeunesse républicaine l'écrivait « idiot » sur toutes les pierres disponibles. Ce fut un bon moment de popularité à l'envers. On discuta la valeur et l'opportunité des syllabes naïves. Un article fâcheux sur Goethe, mais qui visait Sainte-Beuve, augmenta l'attroupement : deux maladresses faisaient plus pour Barbey d'Aurevilly que trente ans de belle et courageuse littérature. Le procès que lui intenta la Revue des Deux Mondes ridiculisée dans une chronique parue au Figaro acheva d'assurer l'autorité d'une signature que l'on redoutait. Condamné sur une plaidoirie de Gambetta, qui demeura son ami et le lui prouva plus tard, quand il fut question de poursuivre les Diaboliques (8), d'Aurevilly se vengea du monde officiel en publiant (9) ses Quarante Médaillons de l'Académie, –– que l'Académie ne lui pardonna jamais. Au milieu de tout ce tumulte, il se justifiait en achevant un de ses plus beaux romans, le Chevalier Des Touches (1863). Les opinions littéraires de Barbey d'Aurevilly sont assez sûres quand il s'agit des romantiques ; il fut injuste pour quantité de jeunes gens. Son attitude agressive contre le Parnasse contemporain s'expliquerait peut-être par l'apparence académique ou du moins cénaculaire qu'affectait l'assemblée de ces nouveaux poètes. Le vieil individualiste, qui eût accueilli avec joie un Verlaine ou un Heredia isolés, les méconnut parmi une trop nombreuse troupe. Mais que c'est difficile ! Comment deviner Villiers de l'Isle-Adam dans le jeune homme sentimental qui balbutie ? Tout de même la conque du Parnasse avait une sonorité nouvelle ; il fallait s'en apercevoir, écouter, attendre. Quand il se produit une soudaine éclosion de trente-sept poètes, et qu'un Théophile Gautier s'est fait le guide de la poussinée, le critique, même s'il ne comprend pas, s'il ne sent pas, est tenu à quelque prudence. Barbey d'Aurevilly se fâcha, on ne sait pourquoi, et proféra des bêtises. La polémique, où se mêla Verlaine, fut ridicule ; mais il demeura, en quelques sensibilités, une rancune qui chercha et trouva sa revanche. Malgré ces erreurs, son renom de critique grandissait singulièrement, si bien qu'il hérita, en 1870, du rez-de-chaussée de Sainte-Beuve, au Constitutionnel. Mais voici un événement plus important : en novembre 1874 paraissent les Diaboliques, sur le chantier depuis plus de vingt ans. Cela, c'est la floraison du génie de Barbey d'Aurevilly : les Diaboliques, si elles étaient de Balzac, seraient le chef-d'oeuvre de Balzac. Nous avons partout la passion éloquente, expansive ; ici c'est la passion aux lèvres fermées, aux gestes nuls. Tragédies, avec quoi on ne saurait faire des tragédies, autrement que mimées, et encore ! Les défauts des Diaboliques nous sont devenus sensibles depuis Flaubert ; remis à sa vraie date, à celle de sa naissance, un conte tel que les Dessous de cartes d'une partie de whist n'a pas d'autres imperfections que celles qui nous gâtent également El Verdugo ou la Grande Bretèche. Mais il faut réagir contre une délicatesse qui n'est peut-être que de la sensiblerie esthétique et accepter, et goûter telles qu'elles sont, ces prodigieuses histoires d'amour, de haine ou de mensonge, le Rideau Cramoisi ou le Bonheur dans le crime. L'auteur des Diaboliques et de l'Ensorcelée possède le vrai caractère du romancier, caractère très rare : il s'intéresse profondément à la vie ; et cela encore le rattache à Balzac. Pour eux, les amours des hommes, leurs gestes, leurs paroles, sont des choses sérieuses, même quand elles sont bouffonnes. La société est leur absolu ; ce sont des sociologues. Flaubert est un physicien : la vie lui est indifférente ; c'est une matière qu'il mesure et qu'il pèse. Le romancier vulgaire, qui foisonne, est purement anecdotique, même quand il amalgame à ses récits, en doses immodérées, la drogue morale, sociale ou humanitaire. La sociologie peut s'occuper à classer les actes humains selon leur bienfaisance ou leur nocuité ; la physique des moeurs expose avec froideur le résultat de ses observations et de ses calculs. Barbey d'Aurevilly manque de sang-froid ; la passion le trouble et fait un peu trembler ses mains ; mais il se raidit, respire, achève l'expérience. Sa faiblesse est d'en interpréter les résultats ; mais comme la religion où il se guide n'est pas optimiste, ses admonestations du moins ne sont pas vulgaires. Il y a, en somme, deux sortes de romanciers, les prosateurs et les poètes. Je ne pense pas que l'on ait encore établi cette distinction ; elle est cependant capitale, pour qui veut comprendre quelque chose à l'évolution du roman depuis cent ans. Il est généralement admis que le plus grand romancier du dernier siècle, c'est Balzac. Oui, si l'on ne songe qu'aux écrivains qui furent uniquement des romanciers ; mais cela serait peut-être contestable, si l'on pense aussi aux poètes qui furent en même temps des poètes et des romanciers. Quelques-uns des romans modernes les plus célèbres, et en même temps les plus beaux, ont pour auteurs des poètes. C'est le Stello et le Cinq-Mars, d'Alfred de Vigny ; c'est Mademoiselle de Maupin et le Capitaine Fracasse, de Théophile Gautier ; ce sont les Misérables et les Travailleurs de la Mer, de Victor Hugo ; c'est Graziella, de Lamartine, et bien d'autres que tout le monde a lus. Cette tradition nouvelle du poète-romancier se continue jusque sous nos yeux avec les oeuvres de Catulle Mendès ou de Henri de Régnier, poètes qui sont devenus romanciers sans cesser d'être poètes. Il y a deux choses principales dans le roman, l'observation de la vie et le style. Le poète n'est pas toujours un très bon observateur, mais il prend sa revanche dans le style. D'autre part, le romancier qui n'est que romancier est très rarement un bon écrivain : témoin Balzac. Il est vrai qu'une telle affirmation est contredite par Flaubert, observateur merveilleux, écrivain merveilleux, et même par les Goncourt qui surent regarder la vie extérieure et rendre leur vision en un style curieux et neuf. Mais si l'on tenait compte des exceptions, on ne pourrait construire aucun raisonnement général ; les exceptions se traitent à part, avec un soin particulier, et, quand on sait manier les outils de la logique, on finit bien par les faire rentrer dans la règle. Au fond, Flaubert était, comme Chateaubriand, un poète qui écrivait en prose, et les Goncourt étaient des peintres qui se sont trompés sur leur vocation véritable. Il reste que les romans bien écrits sont presque toujours l'oeuvre d'un poète avoué ou caché, et que les romans des écrivains purement prosateurs n'ont, le plus souvent, qu'une médiocre valeur littéraire. Le roman prend son origine dans le poème. L'Iliade, l'Énéide sont des romans en vers, comme les Martyrs ou Salammbô sont des poèmes en prose. En somme, il n'y a qu'un seul genre, en littérature, le poème. Tout ce qui n'est pas poème n'est rien du tout, ou bien rentre, ce qui est loin d'être un déshonneur, dans cette vaste catégorie, la science. C'est dans la science qu'il faut placer les romans de Balzac ; ce sont des études de psychologie. Les romans de Victor Hugo, au contraire, sont des poèmes, et c'est tout leur mérite, car, au point de vue psychologique, personne n'en conteste la vacuité. Cette double classification serait applicable à tous les romans modernes de quelque intérêt selon leurs tendances, selon que l'observation scientifique y domine ou le souci du style. Selon leurs tendances, car il s'agit de tendances et non de réalisations absolues : la littérature se meut dans le relatif. Les romans les plus secs, comme ceux de Stendhal, ne sont pas sans aucune valeur artistique et il y a, même dans les Misérables, des pages d'une observation très exacte. C'est sur les généralités et non sur les détails que les classifications reposent, aussi bien en histoire littéraire qu'en histoire naturelle. Je crois qu'avec ces réserves la distinction entre les poètes romanciers et les prosateurs romanciers est inattaquable. On éprouvera cependant quelque embarras en voulant ranger Barbey d'Aurevilly dans l'une ou dans l'autre de ces catégories. Il fut poète, sans doute, et le demeura jusqu'à la fin de sa vie ; mais poète caché, qui n'avouait ses vers, pourtant très beaux, qu'à quelques-uns seulement de ses amis. Parmi son oeuvre, qui est considérable, puisqu'elle remplit près de cinquante volumes, sans compter ce qui est demeuré épars dans les journaux, les poèmes en vers ou en prose ne tiennent qu'un petit nombre de feuillets. Cela est vrai, mais le souci de l'art, le goût du style, se retrouvent jusque dans le plus fugitif de ses articles, jusque dans la plus brève de ses lettres. Il aimait les mots pour eux-mêmes, composait des phrases pour le seul plaisir de leur sonorité. Sa sensibilité littéraire était très vive. Il a beaucoup de peine à pardonner à Balzac, qu'il admire passionnément, la maladresse de son style, et la beauté de la forme le rend indulgent pour des idées qui, exprimées en mauvais langage, le mettraient en colère. Ensuite, c'est un imaginatif plutôt qu'un observateur. Il aime les anecdotes véritables, mais il les arrange à sa façon, les complique, les grandit. Quand il regarde la vie le plus attentivement, il y voit des choses visibles pour lui seul, c'est-à-dire qu'au moment même où il croit observer il imagine. La réalité n'est pour lui qu'un prétexte, un point de départ. C'est un poète. Barbey d'Aurevilly, comme romancier, est peut-être bien plus près de Théophile Gautier que de Balzac. Il y a cependant en lui un réaliste. Ce côté de son caractère se révèle quand il décrit les paysages et les moeurs de sa terre natale, les environs de Valognes, en Normandie. Nul mieux que lui, ni plus exactement, n'a peint sous toutes ses faces la tristesse ou la splendeur de ce pays capricieux qui, dans la même matinée, éclate au soleil comme une immense et joyeuse émeraude ou semble s'affaisser et se dissoudre dans le brouillard et dans la pluie. Mais quand il est en Normandie, il est si heureux, que la pluie elle-même ne peut le mettre de mauvaise humeur : « J'ai eu ici, écrit-il, deux jours d'un temps royal, mais à présent ce sont des pluies, superbes de caractère dans ce pays d'Ouest fait pour elles... (10). » En ces lettres qu'on vient de publier et qui sont toutes datées de Valognes, ou des environs, l'aveu de son profond amour pour ce coin de terre ne s'exprime qu'en phrases assez brèves ; il l'a réservé pour d'autres correspondants et surtout pour ses livres, pour ses romans, qui se passent presque tous dans la presqu'île du Cotentin, entre Cherbourg et Coutances. Ce poète avait une idée en peignant toujours des paysages normands, des caractères normands. Il voulait décentraliser le roman et montrer que la province, et une de celles qui passaient alors pour des plus arriérées, la Basse-Normandie, est tout aussi « romanesque » que l'Italie ou les bords du Rhin, quand le romancier a du génie. En ce temps-là, avant la guerre, les imaginations étaient romantiques et la France prenait plaisir à se mépriser elle-même, en ne montrant du goût ou de l'estime que pour les pays étrangers. Barbey d'Aurevilly a beaucoup contribué à nous guérir de cette maladie. Voici comment il parle de Valognes, de la vieille ville muette, triste et abandonnée, la ville déchue par excellence, la Bruges normande : « Le grand aspect de la rue de la Poterie n'existe plus. Les deux larges ruisseaux bouillonnant d'une eau pure, comme de l'eau de source, dans lesquels on lavait autrefois du linge qu'on battait au bord sur des pierres polies, et qu'on passait sur de petits ponts de bois mobiles, ont été détournés de leur cours. Il n'y a plus qu'un maigre filet d'eau qui coule ; seulement il a une manière de couler, en frissonnant, et l'eau est si bien de la pureté que j'ai connue, que je me suis tout à l'heure arrêté à voir frissonner cette pureté. C'étaient mes souvenirs que je regardais frissonner dans cette eau transparente et fuyante. Un temps doux et gris, entremêlé d'un soleil pâle. Hier, avant-hier, des pluies furieuses et des vents fous. La nature ressemblait à une Hamadryade qui crie. Je suis resté au coin du feu, dans ma chambre d'auberge, allant de temps en temps lever le coin du rideau pour voir les pavés flagellés par ces pluies qui ressemblent à des poignées de verges ! En face, un charmant hôtel, un élégant et blanc sépulcre, comme en a ici cette pauvre aristocratie mouvante, dort sous ses volets fermés... » Les phrases de Barbey d'Aurevilly ont cette beauté d'être vivantes, et c'est aussi la beauté de ses romans et de ses contes normands, où l'observation et l'imagination ne sont jamais que les servantes de la sensibilité. Il n'y a plus d'hésitation : c'est bien un romancier-poète et l'un des plus curieux de notre littérature. Les Diaboliques furent poursuivies sur la dénonciation du Charivari (11). Le trait est à retenir pour qui voudra peindre la justice moderne. Elle n'est plus arbitraire ; c'est convenu ; elle est pire, elle est bête. Le ministre était un certain M. Tailhand ; Arsène Houssaye et Raoul Duval d'un côté, Théophile Silvestre et Gambetta de l'autre, s'interposèrent. Il y eut, je crois, un compromis (12) ; on en trouve la preuve dans la note que l'éditeur Lemerre mit en tête du septième volume des oeuvres de Barbey d'Aurevilly. « Les Diaboliques ne pouvant être réimprimées dans une édition isolée et spéciale... » Depuis, on a passé outre et d'ailleurs les Diaboliques de Lemerre se sont toujours vendues séparément. On ne sait de qui la parole eut le plus de poids ; Tailhand céda aux deux groupes, au même moment, heureux, en bon politique, de contenter à la fois deux amis ou deux ennemis. Il est assez curieux de voir Gambetta solliciter en faveur d'un écrivain catholique un ministre réactionnaire : « Vous êtes de ceux, écrivait-il alors à d'Aurevilly, que la politique elle-même ne peut faire oublier. » Continuant à diviser ses forces, l'auteur des Diaboliques jugeait toujours « les oeuvres et les hommes », admirant les Origines de Taine, dépréciant l'Assommoir, raillant les bas-bleus, méconnaissant avec le même emportement Goethe et Diderot ; mais c'est une Diabolique, la dernière, Une Histoire sans nom, qui le fit entrer au port, par dessus le banc de sable, comme une lame puissante dont la barque est soulevée et lancée en avant. C'était en 1882. A l'âge de soixante-quatorze ans, après plus de cinquante de littérature, Barbey d'Aurevilly arrivait à la gloire. Le spectacle est beau, car dans la longue vie qui allait finir lumineuse, on pouvait relever des erreurs ou des colères, mais pas une bassesse, pas une lâcheté ; et c'est tout entier que l'opinion l'acceptait enfin, sans que ni l'écrivain ni l'homme lui eût sacrifié ni une idée ni un sentiment. En même temps que le public, les intelligences les plus diverses viennent à lui : il est admiré à la fois par Goncourt et par Fustel de Coulanges, par Caro et par Banville, par Huysmans et par Ernest Havet. M. Bourget était son miroir familier. Il passa les six dernières années de sa vie à reviser son oeuvre critique et mourut le 23 avril 1889, pendant que l'on imprimait pour la première fois son poème Amaïdée, écrit, en 1834, « sous le regard de Maurice Guérin ». Il mourut apaisé, mais encore farouche, rêvant à de profondes solitudes, ayant dit : « Je ne veux personne à mes funérailles. » (Mercure de France, novembre 1902 et Promenades littéraires, Mercure de France, 1904) (1) Eugène Grelé : Jules Barbey d'Aurevilly, sa vie et son œuvre, d'après sa correspondance inédite et autres documents nouveaux. Avec une préface de M. Jules Levallois. Première partie : la Vie. Caen, L. Jouan, éditeur, 1902, in-8. (2) Vers et réponse furent imprimés sur l'heure à Paris par les soins d'un ami de la famille : Aux Héros des Thermopyles, élégie par M. Jules Barbey, précédée d'une lettre de M. Casimir Delavigne à l'auteur ; Paris, librairie de Sanson, au Palais-Royal, 1825. (3) M. Georges Esparbès prépare à Toulouse un Maurice de Guérin qui viendra tout naturellement se joindre au Barbey d'Aurevilly de M. Grelé. (4) Page 146. Un peu plus loin, M. Grelé corrige justement Sainte-Beuve, qui semble n'avoir rien compris à l'impression que firent l'une sur l'autre ces deux âmes originales. (5) Une lettre à Trébutien nous apprend que Barbey, en mai 1854, préparait un recueil des Pensées et Maximes de Balzac. Un recueil analogue avait été publié deux ans auparavant, sans nom, préface ni notes : Maximes et pensées de H. de Balzac ; Paris, Plon frères, éditeurs, 1852. Le choix, très bien fait, donne, en son raccourci, une idée très intéressante de la pensée de Balzac. Qui en est l'auteur ? (6) Augier, dit-il, « heureux comme l'indignité ». (7) Que Chassériau et Gustave Moreau n'ont fait que perfectionner. (8) Les Fleurs du mal, Madame Bovary, les Diaboliques, ces trois titres sont aussi le nom de trois rudes victoires remportées par la liberté d'écrire sur l'autorité morale. La première fut incomplète ; la dernière fut remportée sans bataille publique, par la fuite des agresseurs. (9) En collaboration avec probablement Théophile Silvestre. (10) Lettres de Barbey d'Aurevilly. Paris, Mercure de France, 1903. –– Cf. E. Grelé, ouvr. cité. (11) Grelé, p. 350. (12) Sur lequel M. Grelé ne fournit aucun renseignement. [entoilage : Nausicaa Buat, juin 2000]
Saint Thomas d'Aquin, en sa Somme (2), examine cette question : « La Sottise est-elle un péché ? » — et, après les distinctions et les réserves que lui dicte sa théologique prudence, conclut pour l'affirmative. En tant que péché, la sottise (stultitia) provient, dit le Docteur Angélique, de ce que le sens de la spiritualité est hébété (3). Ce genre de sottise est fait de haine et de peur, de bassesse et d'ennui : haine de Dieu et de l'Art ; peur de la suprême Vérité ; infirmité mentale qui ne se plaît comme l'escarbot, que dans l'excrément ; ennui de vivre en un four sans lueur et sans espoir. A le pourchasser, ce péché quadriforme (que d'aucuns croient le Péché parfait, le Péché en soi), Barbey d'Aurevilly usa une partie de sa vie ; pour cette tâche il se fit journaliste et polémiste ; un à un, il prit les gens de son temps, les pesa par la méthode différentielle, rédigea leur « bulletin de pesée », — et sur ce bulletin on lit fréquemment : SOTTISE : Cent pour cent du poids total. C'est qu'en effet nul corps de métier ne fut en aucun temps davantage affligé par la sottise que la corporation des gens de lettres. Du moins la maladie est-elle plus visible, chez eux, car leur occupation première est d'en faire la confession publique, d'indiquer du doigt leur tare. de tirer vanité de leur bosse, de hausser au-dessus des autres têtes leur microcéphalie. Tous y passèrent : pseudo-mystiques et faux historiens ; poètes attristés par l'orgueil fades romanciers tout bêlants de sentimentalité; vaudevillistes, bas-bleus, et tous les rétameur de la vieille casserole Littérature. Cette fois, ce sont les épistoliers que le Connétable, mouchetant la pointe, bâtonne du plat de son épée, devant Balzac, amusé et complice. Plat d'épée, — mais d'aucuns reçoivent en compensation d'amicales tapes sur la joue, signe de dédain autant que d'absolution ; pour Madame Sand, une poignée de verges entortillées d'orties. Celle-là, il la fouette un peu rudement, et, lui relevant la cotte, fait voir que sous la robe de la princesse il y a le grain de peau d'une vachère : et quand on a bien vu, il refouette. De tels articles, ce dut être bien agréable de trouver cela au bas de journaux où, à cette heure ce sont les incompréhensifs Ginisty qui pérorent et qui jugent. Juger ! « Elle ne jugeait pas », dit Villiers de l'Isle-Adam en notant le caractère de la marquise Tullia Fabriana (4). Que l'actuelle critique n'a-t-elle un peu de cette pudeur ! Barbey d'Aurevilly, lui, pouvait juger, s'étant offert, lui-même, et avec une certaine témérité, aux critères des hommes. Injustes souvent, mais toujours logiques et en concordance avec ses principes, ses jugements sont légitimés par le talent et par le courage. Au lieu, comme Sainte-Beuve, de louvoyer pleutrement, entre non pas même les extrêmes, entre les moyennes, il dit crûment sa pensée, — et voilà pourquoi ces vingt volumes intitulés Les Œuvres et les Hommes resteront comme un précieux répertoire. Qu'on l'achève, cette vaste maison aux mille fenêtres, qu'on y dresse un escalier, c'est-à-dire une minutieuse table analytique, et nous avons des Causeries, non du Lundi, mais de tous les jours, — et en dépendances du palais dont les salles sont le Prêtre marié, les Diaboliques et tant de chefs-d'œuvre, elle fera très bonne figure, la vaste maison aux mille fenêtres. Un vœu secret. — Il souhaitait d'être le citoyen d'une infime république ou le sujet d'un modeste roi régentant un minuscule pays voué à la louable ignorance de l'abécédé : là, comme la littérature ne produit nul revenu, comme toutes les flores du style, asses fétides ou violettes, valérianes ou aconits, se fanent, désespérément stériles, ceux-là seuls qu'incite une violente passion entreprennent l'horticulture verbale. Là, le jardin public du Parnasse ne se dessine pas tout entier selon d'oiseuses plates-bandes, selon de ridicules corbeilles. Il y a des coins de marécage oubliés et couverts de la spontanéité des fleurs sauvages ; il y a des bois vierges, encore faunesques ; il y a des perspectives de prés renonculaires ; il y a des landes inconnues à la houe : point de hâtifs jardiniers retournant la terre avec de complexes mécaniques, ensemençant l'intégralité des surfaces, munis d'un système pour précipiter des germinations dont la maigreur attriste ; point de ces terribles gâcheurs qui, jetés en bande sur une étendue de terreau, font mine d'égratigner le sol friable pour y insérer, avec des gestes élégants, des idées volées. 1892 (1) Les Œuvres et les Hommes (IIe série : XIXe siècle) : La Littérature épistolaire, par Barbey d'Aurevilly (Lemerre, éditeur). (2) Summa totius theologiae S. Thomae Aquinatis (Cologne, 1639) : Secundae partis Volumen primum. Quaestio XLVI, Art 2... (3) Ibid., Art. 3. (4) Isis. (Promenades littéraires, septième série, Mercure de France, 1927)
« Les livres », Mercure de France, juillet 1891. J. Barbey d'Aurevilly. Impressions et souvenirs, par CHARLES BUET (Savine). – Tout plein de choses inutiles, de découpages d'articles sans rapport immédiat avec le sujet, de considérations générales ou particulières étrangères à la vie ou au talent de Barbey d'Aurevilly, ce gros volume est pourtant intéressant. Il comprend l'histoire entière du grand romancier depuis les obscures années de sa jeunesse jusqu'à ses derniers moments, dans la gloire discrète mais sûre, parmi les amitiés rares mais dévouées où il s'éteignit. M. Buet, qui est un collectionneur de papiers grands et petits, imprimés et manuscrits, en a sorti de curieux : lettres inédites, poèmes en vers et en prose peu connus. On regrette des pages comme celles où Verlaine et Mallarmé sont lourdement raillés, mais l'incompétence de M. Buet enlève, là, toute valeur à ses critiques ; puis la sorte d'esprit qui s'y étale semble si surannée ! En somme, cette compilation se parcourt avec plaisir et on doit la garder comme une sorte de Manuel-Barbey d'Aurevilly, où trouver à l'occasion le détail, le renseignement, la date dont on peut avoir besoin si l'on étudie l'œuvre de l'auteur des Diaboliques. R. G. [texte repris dans le n° 1 de la Nouvelle Imprimerie Gourmontienne et communiqué par cette revue] Une lettre de J. Barbey d'Aurevilly. — M. R. de Bury a reproduit dans notre dernière livraison (les Journaux, 16 juin) une note de M. A.-F. Bourgeois parue dans l'Intermédiaire. Mlle Read nous demande à ce propos de faire savoir à M. A.-F. Bourgeois qu'il prend le Pirée pour un homme, c'est-à-dire Une Histoire sans nom pour Page d'Histoire, et l'insertion de la lettre suivante de J. Barbey d'Aurevilly. Lundi, 28 mars 1887. Mon pauvre et cher Lemerre, vous avez donc des moustiques chez vous qui se sont abattus sur ma page d'histoire, et vous les prenez pour ce qu'ils ne sont pas. Ils sont tout simplement des Ignorants qui ne savent pas lire, même ce que j'ai écrit. Comptons leurs sottises. I° Le nom des Ravalet est le nom de famille des seigneurs de Tourlaville qui ne sont de Tourlaville que parce qu'ils sont les châtelains du château de ce nom. Et d'une ! Ensuite, — ? Le nom du mari de Mlle de Ravalet, que votre érudit appelle Ravalet (il faudrait pourtant savoir lire), est, comme je l'ai dit : le Fauconnier, seigneur de plusieurs seigneuries. Et de deux bêtises ! La troisième est ineffable, et je n'oppose à cette sottise que Bouillet, lequel n'est pas un érudit pourtant ! (Voici Bouillet) : « L'annulation du mariage de Henri IV et de Marguerite de Valois est de l599... Depuis ce temps, cette princesse vécut tantôt en Auvergne, tantôt à Paris, dans un palais séparé. Néanmoins, le bon Roi fournissait à ses dépenses, et allait même lui faire de fréquentes visites. » Ma phrase ici reste donc entière, et votre petit raton de bibliothèque qui voulait la grignoter ne l'a pas même entamée ! Nous ne sommes donc qu'à trois sottises, mais qu'il continue, le raton ! Quand nous serons à dix nous ferons une croix ! La croix, je la lui ferai sur le dos, au raton ! Mais pour cela, mon cher Lemerre, il me faut le précieux nom de cet érudit à tête d'épingle sans pointe qui vous a endoctriné. Je vous prie de me l'envoyer. Puisqu'il a critiqué ma fidélité historique, je me permettrai de gratter son imposante érudition. Donc, son nom, mon cher Lemerre, son nom ! Vous êtes un renard bas-normand à forte queue. Fustigez de cette queue-là les mouches à m.... qui vous entourent et faites-les déguerpir ! C'est le conseil de l'autre renard bas-normand qui est Moi ! J. BARBEY D'AUREVILLY R. de Bury, « Les Journaux », Mercure de France : - Un mot de Barbey d'Aurevilly , 1er mai 1905, pp. 127-128 - Le Chevalier Destouches , 16 mars 1911, pp. 421-423
DISJECTA MEMBRA Le pamphlétaire a besoin d'un style. M. Bloy a un style. Il en a recueilli les premières graines dans le jardin de Barbey d'Aurevilly et dans le jardinet de M. Huysmans (« Léon Bloy », Le Livre des masques). ce sont alors des poèmes, des contes, de petites pages où l'on retrouve, avec plus ou moins de miel, tout le poivre sensuel, toute l'audace parfois un peu sadique du disciple, - du seul disciple de Barbey d'Aurevilly (« Jean Lorrain », Le Livre des masques). Janvier [1898]. 90 Crimes. — J'aime beaucoup les histoires de crimes ; on y lit une sincère humanité ; l'homme vrai s'y montre dans toute la force de son stupide désir d'être heureux. L'assassin est fort et stupide ; l'homme commun est stupide et lâche : combien de gens qui sourient autour de nous ont rêvé de fructueux crimes, le soir, en caressant les cheveux de leurs progénitures et les genoux de leur femelle. M. Macé a rédigé un livre sur les crimes impunis ; mais qui dénombrera les crimes inconnus ? Quel Barbey d'Aurevilly doué de la seconde vue, comptera les gens qui jouissent de manier les écus du mort avec la main qui étrangla ? (« Crimes », Epilogues, Mercure de France, 1903) Avril [1898]. 99 Une Polémique sur les mœurs grecques. — [...] Très peu libre, déjà, s'il s'agit de science ou de philosophie, le professeur français redevient, en littérature, un petit écolier qui n'ose se hasarder au delà des murailles du programme. Et le programme est ordonné de telle sorte que le professeur n'apprenne que ce que les élèves devront savoir : un licencié ès-lettres n'est, en général, qu'un bon élève, et un agrégé, un très bon élève. Ils ne vont ni plus loin ni plus haut, ce qui serait d'ailleurs parfaitement inutile et même nuisible au sage exercice de leur profession; s'ils savent, et ils en savent beaucoup, des choses qu'atteindra difficilement un érudit du hasard de la lecture, ils ignorent presque tout ce qu'ils n'ont pas été obligés d'apprendre. Ceux qui, dans leurs écrits, dépassent, en un sens ou dans l'autre, les limites des programmes, se font assez vite une mauvaise réputation. Voit-on le scandale d'un étudiant proposant à MM. Crouslé, Faguet, Larroumet une thèse de doctorat ès-lettres sur Verlaine ou Barbey d'Aurevilly ou Villiers de l'Isle-Adam ? C'est cependant d'un de ces trois mémorables écrivains qu'il sera question dans la thèse qu'un jeune Finlandais soutiendra prochainement devant une université septentrionale. Quand il m'avertit du choix de son sujet, je lui demandai, sachant d'avance la réponse : A la Sorbonne ? — Il se contenta de sourire. ? (« Une Polémique sur les mœurs grecques », Epilogues, Mercure de France, 1903) la Philosophie dans le boudoir, livre où le sadisme n'apparaît qu'à la fin et sous une forme moins révoltante, puisque Barbey d'Aurevilly a pu reprendre l'anecdote et l'élever au tragique (« Sur le sadisme » , Epilogues, Mercure de France, 1903, p. 315) Claudien le disait bien, pensant à autre chose, mais les vers des poètes sont à métamorphoses : Fallax ô quoties pulvis deludet amorem. La poussière se joue de nos amours et nos amours s'en vont en poussière. Il s'agit de Verlaine. Un journaliste nommé, dit-on, Nyon l'appela « peu », un autre l'appela « honte », un autre l'appela « sans-chemise », et M. Zola, enfin, l'appela « raté ». A ce propos, cet homme de lettres bien connu énuméra quelques ratés célèbres, Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam, Jules Laforgue, et d'autres dont il ne dévoilera le nom qu'au jour de leurs misérables funérailles. (« Copeaux. La mort de Verlaine », Promenades littéraires, 7e série, Mercure de France, 1927) M. Doumic n'est pas un critique, même très médiocre ; c'est un pauvre homme qui se venge comme il peut de n'avoir aucune imagination créatrice et d'être incapable de rédiger autre chose que de confuses et prolixes bibliographies. Il peut être assuré, d'ailleurs, que ses opinions sur Verlaine ou sur Barbey d'Aurevilly ne font de mal qu'à lui-même. Le monde littéraire — Thulé que les Doumics contemplent de loin — n'en a cure. Rien ne peut empêcher que Verlaine n'ait écrit les Fêtes galantes et Sagesse. Il n'a pas eu tous les dons, il n'est pas le poète unique, qui domine tous les autres ; il est ce qu'il est, Verlaine, et tant que dureront les lettres françaises, ce nom aura un sens, comme le nom de Du Bellay, comme celui de Musset. Que cette vérité élémentaire mette en rage M. Doumic, c'est cela qui est singulier, et non la réputation de Verlaine, très normale et assez justement conforme, aventure rare, à ses mérites véritables. Il m'en coûte de conseiller la lecture d'un livre de M. Doumic ; mais pourtant, avec le dépeçage de Verlaine, l'écorchement de Barbey d'Aurevilly est à recommander. Quelle cuisinière bourgeoise comme elle désosse, comme elle dépouille, comme elle hache ! Mais c'est la cuisine du diable : les beaux animaux massacrés ressuscitent dès que le tortionnaire a fini sa besogne. Comme Verlaine, d'Aurevilly fut inégal, mais il a écrit les Diaboliques. Qu'on ne retienne que cela, si l'on veut avec quelques pages détachées : et voilà une gloire qui ne semble pas du tout absurde. Mais il n'est pas sûr que ses romans périssent beaucoup plus vite que ceux de Balzac. Ils leur sont supérieurs par le style et ils les égalent souvent par la profondeur de l'observation. Que cela gêne M. Doumic, il n'en est pas moins évident que d'Aurevilly est une des figures littéraires originales du dix-neuvième siècle. Le principal argument de M. Doumic contre le talent de Barbey d'Aurevilly est que « il ne s'appelait pas d'Aurevilly » (1). Mais si M. Doumic ne s'appelait pas Doumic, par hasard, s'il avait nom Ratapoil ou Crinquebille, en aurait-il moins de génie ? (« Les critiques du jour », Promenades littéraires, 7e série, Mercure de France, 1927) (1) C'est entièrement faux, naturellement. Voir Eugène Grelé, Barbey d'Aurevilly, Caen, 1902.
A consulter : Michel Pinel, La Lande de Lessay de Barbey d'Aurevilly à Louis Beuve |